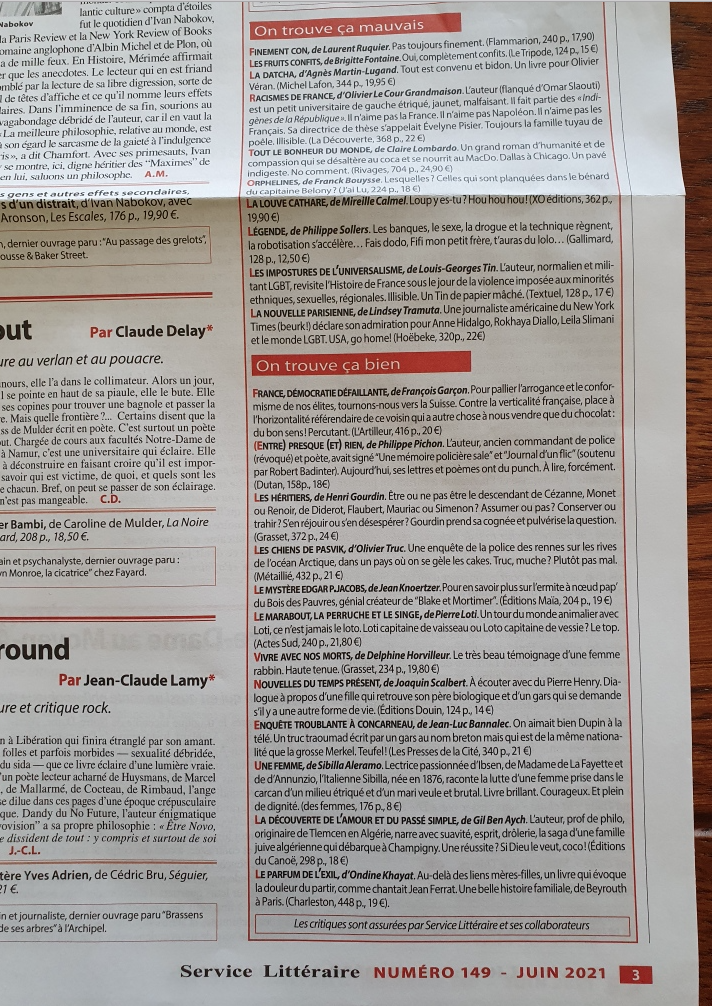Pour télécharger le pdf du communiqué 3 sur l’intelligence artificielle de l’IFESD, c’est ICI
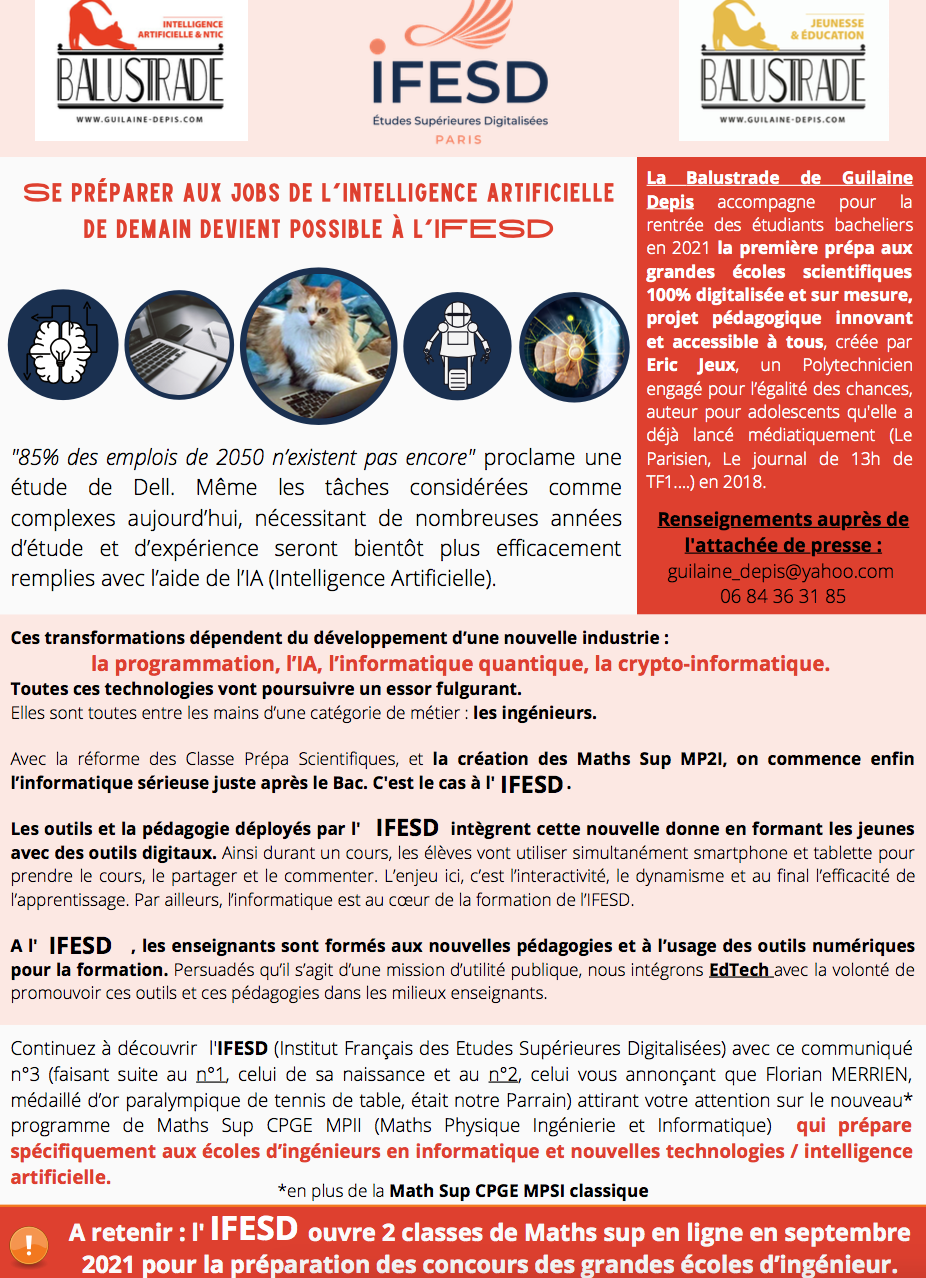
Pour télécharger le pdf du communiqué 3 sur l’intelligence artificielle de l’IFESD, c’est ICI
Guilaine Depis, attachée de presse (Balustrade)
Rampe de lancement ! Appuyez-vous sur la balustrade !

Deux nouvelles dont une courte sur l’expérience de mort imminente, pas la meilleure car trop didactique. Mais l’auteur s’en tire avec une pirouette à la fin.
La plus intéressante, Zoël et ses pères, fait 85 pages, soit 70% du recueil. Elle met en scènes les conséquences (inattendues) de l’exigence de transparence pour les donneurs biologiques de sperme.
Zoël est un garçon de 16 ans qui a des doutes sur ses origines parce que ses parents – qui l’aiment – parlent toujours de ses succès en se référant à la famille de sa mère mais jamais en comparaison avec son père, ce qui est curieux. Personne ne lui a dit qu’il était né d’un donneur de banque, à Los Angeles pour être plus précis, car la législation était plus libérale vingt ans auparavant en Californie que dans le vieux pays catholique engoncé dans son juridisme bureaucratique qu’est la France.
L’auteur élimine d’emblée les problèmes familiaux, le couple est sans histoire, avec deux filles après Zoël ; tout le monde s’aime bien. Mais la quête de l’intelligent aîné, poussée par la mode de la transparence pour tout et rien, va perturber l’équilibre longuement acquis. Le père officiel se sent diminué, renvoyé à son impuissance spermatique, fin de race d’une lignée d’aristos portant un nom. La mère se sent pousser des ailes, elle a tout décidé, choisi les critères du géniteur sur catalogue (blond, intelligent, artiste, sportif…). Le fils se découvre un nouveau père, justement dans le domaine professionnel qu’il affectionne, le cinéma, dont il veut faire son métier.
Mais qu’en dira-t-on ? Dans la famille collet monté, dans la société où les « amis » vont jaser, à l’école, auprès des filles ? D’ailleurs, le père des filles est-il leur père ? Non, bien-sûr – et elles, qui n’ont rien demandé, vont devoir vivre avec cette révélation. Du côté du père biologique, Victor, trouver un fils supplémentaire seize ans après est plutôt flatteur, une curiosité, mais du côté de sa femme et de ses fils, cela pose question. D’autant que l’épouse se sent flouée de ne pas avoir été mise au courant de ces dons de sperme aux Etats-Unis et de l’autorisation donnée aussi à ce que le géniteur puisse être un jour contacté. Journaliste d’investigation, elle veut en écrire une enquête en forme de scoop, ce qui est plutôt gênant pour tout le monde !
L’auteur, qui affectionne de façon manifeste les retournements de situation, va conclure sans conclure. Car il affectionne aussi de poser les problèmes sans les résoudre, laissant à chacun la réflexion ouverte. Il n’est certainement pas un « écrivain engagé ».
Mais il est vrai que toutes ces manipulations sociales sur la procréation, PMA, GPA, eugénisme euphémisé des banques de sperme ou d’ovocytes, opérations transgenres, obligent à la recomposition par étape des familles. Elles ne sont pas faites pour l’équilibre mental des enfants, ni pour une stabilité affective et éducative des couples. Les apprentis sorciers du « j’ai l’droit », qui savent tout mieux que tous leurs ancêtres, jouent avec la génétique et l’enfance comme aux dés. Juste pour voir. Juste pour le plaisir. Car le « droit » individuel est devenu sacré et les désirs des ordres. La société occidentale, menée par le consumérisme libertarien américain, génère des citoyens qui trépignent comme des gamins de 2 ans : « moi je », « moi d’abord », « moi aussi » ! Comme s’ils étaient sûrs d’avoir « le choix » de leur destin… Ils n’ont jamais lu Darwin, ni Nietzsche, ni Marx, ni Freud – ni même Bourdieu ! Ils sont conditionnés, ils sont cons tout court de ne pas le soupçonner à l’ère pourtant universelle du soupçon des com(plots).
Quant aux masses démographiques d’autres continents, elles guettent l’instant propice où le suicide collectif fournira l’occasion d’imposer « leur » culture, « leurs » mœurs, « leur » vision du monde. A nos dépens – mais ce sera tant pis pour nos descendants avides d’égoïstes « droits » particuliers. L’auteur se garde bien d’aller jusque-là, trop mainstream comme ancien pubard pour l’oser. Mais il pose avec ironie les bonnes questions.
Joaquin Scalbert, Nouvelles du temps présent – Archives du lendemain, éditions Douin, 2021, 123 pages, €14.00
Attachée de presse BALUSTRADE : Guilaine Depis, 06 84 36 31 85 guilaine_depis@yahoo.com
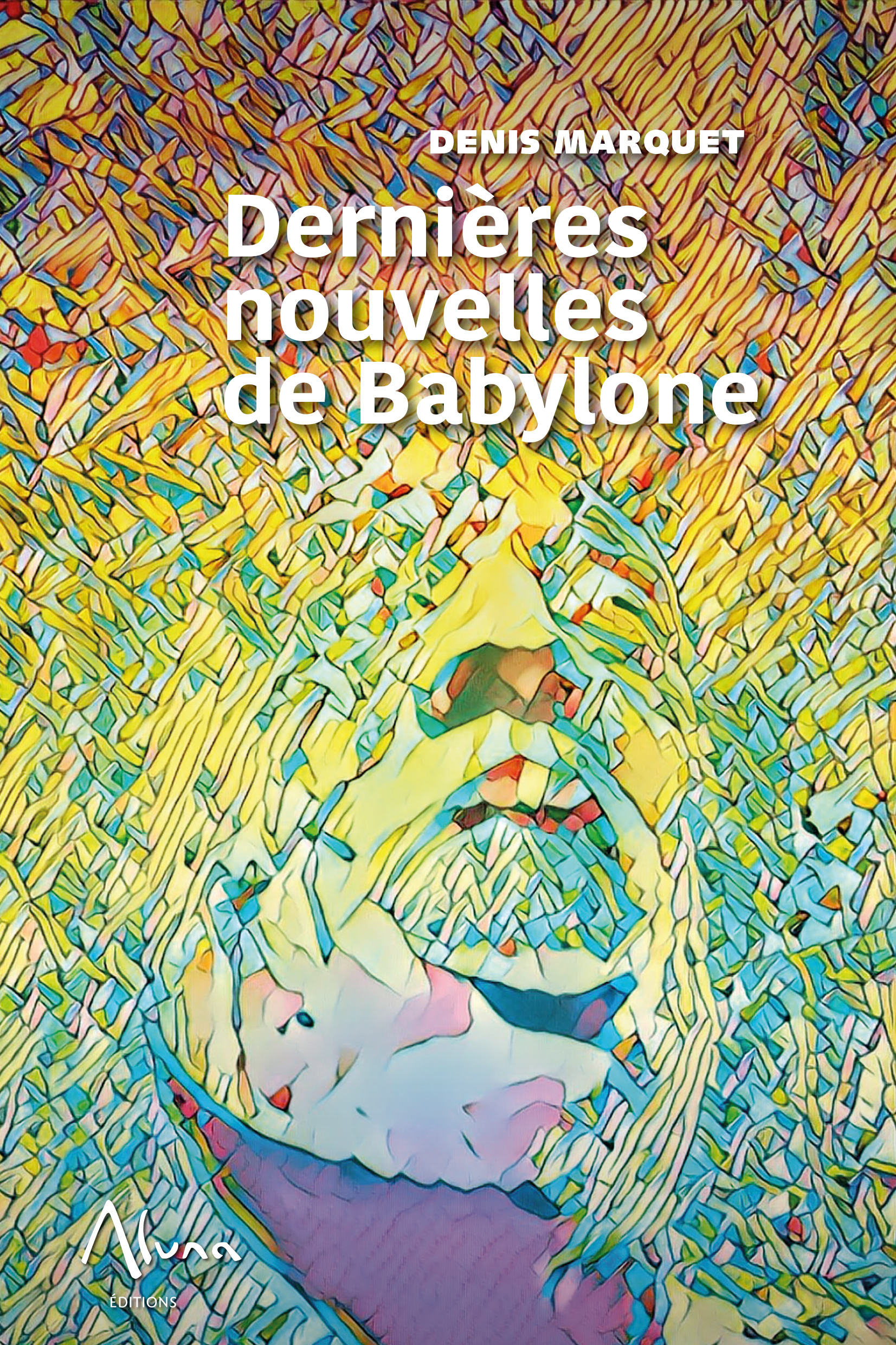 Je suis extrêmement heureuse de vous annoncer la sortie prochaine (13 octobre) de l’ouvrage de Denis Marquet
Je suis extrêmement heureuse de vous annoncer la sortie prochaine (13 octobre) de l’ouvrage de Denis Marquet Normalien, agrégé, Denis Marquet est écrivain, philosophe et thérapeute. Ayant joué dans plusieurs groupes de rock, composé des musiques de film et écrit de nombreux articles pour, entre autres, Psychologies Magazine, Libération, Nouvelles Clés, il est l’auteur de cinq romans et de quatre essais.
Normalien, agrégé, Denis Marquet est écrivain, philosophe et thérapeute. Ayant joué dans plusieurs groupes de rock, composé des musiques de film et écrit de nombreux articles pour, entre autres, Psychologies Magazine, Libération, Nouvelles Clés, il est l’auteur de cinq romans et de quatre essais. Jarnac (16) : l’éloquence à l’honneur au festival Prise de paroles
Jarnac (16) : l’éloquence à l’honneur au festival Prise de paroles
Par Alexis Pfeiffer
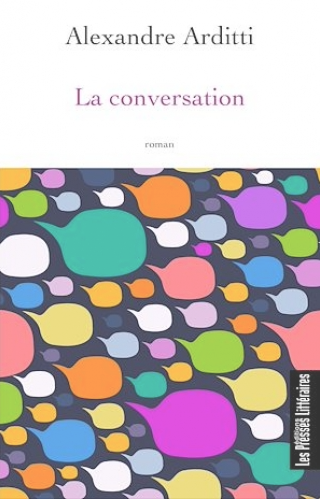 « La Conversation » le premier roman d’Alexandre Arditti
« La Conversation » le premier roman d’Alexandre Arditti Brillant, drôle, décapant.
L’histoire : Charlotte, une jeune journaliste de vingt ans interviewe Victor Esmenard, un ancien Président de la République de quatre-vingt dix ans : deux générations, deux caractères, deux visions de l’existence, deux trajectoires se confrontent. Un entretien initiatique. Les idées fusent, c’est jubilatoire.
« La vie est courte, tellement courte. Ne perdez pas de temps. »
« Lorsque la culpabilité vous ronge au moment d’acheter un morceau d’entrecôte, de partir en week- end ou de choisir un film, vous pouvez considérer que vous êtes proche de la fin d’une certaine civilisation… »
 L’auteur : Alexandre Arditti est journaliste et éditeur de presse. Après des études de sciences politiques, de droit et de marketing, il collabore à divers organismes audiovisuels ainsi qu’à de nombreux titres de la presse économique et culturelle. Passionné de voyage, il fonde les Editions Grands Voyageurs en 2003.
L’auteur : Alexandre Arditti est journaliste et éditeur de presse. Après des études de sciences politiques, de droit et de marketing, il collabore à divers organismes audiovisuels ainsi qu’à de nombreux titres de la presse économique et culturelle. Passionné de voyage, il fonde les Editions Grands Voyageurs en 2003. Christian de Moliner, long entretien avec Marc Alpozzo pour Livr’arbitres

Service littéraire préfère Joaquin Scalbert à Philippe Sollers !