Alexandre Arditti est journaliste et éditeur de presse écrite. La conversation est son premier roman. Charlotte, jeune stagiaire dans un grand hebdomadaire se voit proposer d’interviewer Victor Esmenard, ancien président de la République française, diplomate, écrivain nonagénaire, qui vient de recevoir le Prix Nobel de la paix. Cette liste suffit pour intimider la jeune journaliste qui accepte et se dirige à tâtons vers le lieu où elle va rencontrer son illustre interlocuteur. Elle n’est pas au bout de ses surprises…
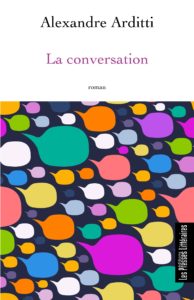 La conversation porte sur sa couverture la précision d’appartenance au genre romanesque. On aurait pu l’imaginer se dérouler sous forme théâtrale, comme un dialogue en plusieurs actes, selon les circonstances de lieu et de temps. Pourquoi avoir opté pourtant pour le roman plus que pour d’autres genres littéraires ? Quelle liberté, quel espace fictionnel vous a offert cette option ?
La conversation porte sur sa couverture la précision d’appartenance au genre romanesque. On aurait pu l’imaginer se dérouler sous forme théâtrale, comme un dialogue en plusieurs actes, selon les circonstances de lieu et de temps. Pourquoi avoir opté pourtant pour le roman plus que pour d’autres genres littéraires ? Quelle liberté, quel espace fictionnel vous a offert cette option ?
En effet, c’est un dialogue à bâtons rompus qui aurait pu s’exprimer sous la forme théâtrale. On pourrait d’ailleurs tout à fait imaginer une adaptation ! Cependant, j’ai préféré opter pour la forme romanesque qui offre à mes yeux plus de souplesse, et permet de rentrer plus en profondeur dans la psychologie des personnages, de mettre en lumière leur évolution mais aussi de faire apparaître leur part d’ombre… Des nuances beaucoup plus complexes à esquisser lors d’un face à face théâtral pur. Je suis un grand amoureux des dialogues ciselés et puissants, de ceux qui peuvent aussi bien se révéler de douces caresses ou des coups de poing dans la figure ! Il y a un côté jubilatoire dans cet exercice dont je suis un féru en tant que lecteur.
Si le personnage de Charlotte est facilement identifiable sociologiquement, celui de Victor Esmenard attire l’attention par sa complexité. Comment avez-vous « construit » le personnage de ce nonagénaire à la ressemblance physique, aux traits de caractère et au parcours si surprenants ?
Mon idée était justement d’opposer ces deux personnages que tout oppose. Deux caractères, deux visions de l’existence, deux trajectoires qui se croisent à des moments opposés de leur vie. C’est un entretien initiatique. L’une commence à peine son parcours tandis que l’autre termine le sien. Toutes sortes de sentiments sont à l’œuvre durant cette conversation où les points de vue vont se confronter : l’enthousiasme, l’idéalisme et un brin de naïveté d’un côté ; de la distance, de l’amertume et une certaine sagesse de l’autre. Victor est forcément plus complexe et il n’hésite pas à se révéler un peu provocateur, à jouer de son expérience pour guider Charlotte là où il a envie de l’emmener, jusqu’au dénouement pour le moins inattendu… Je trouvais intéressant de confronter ces personnages et ces idées qui peuvent paraître contradictoires au premier abord, et de les passer ensuite au tamis de notre époque.
Revenons au titre de votre livre, La conversation. Le lecteur attentif ne peut pas s’empêcher de penser à ce type de dialogues imaginaires assez fréquentés dans la littérature – dont un auquel j’ai moi-même pensé –, c’est le livre éponyme de Jean d’Ormesson du dialogue entre Napoléon et son deuxième consul Jean-Jacques Régis de Cambacérès. Pouvez-vous nous parler des sources que avez-vous convoqué et des auteurs qui vous ont inspiré dans l’écriture de votre livre ?
En effet, je suis un grand admirateur de Jean d’Ormesson dont j’ai lu un certain nombre d’ouvrages, mais paradoxalement pas celui-là. Et je n’ai surtout pas voulu le faire avant d’écrire, justement, pour ne pas risquer d’être influencé ou bridé par son contenu. Cependant j’ai bien l’intention de le lire un jour, et cette comparaison, ne serait-ce que par l’analogie du titre, est bien entendu extrêmement flatteuse pour moi ! (rires). En matière de dialogues décapants, j’ai bien sur pensé à l’Hygiène de l’Assassin, le premier roman d’Amélie Nothomb, dont je suis également un admirateur, ou dans un autre genre au style limpide et malicieux des répliques de Pagnol, ou encore à celles plus lyriques d’Audiard au cinéma. Mais je me suis surtout laissé guider par mes personnages, par la personnalité et le langage que j’avais imaginés pour eux, et par la manière dont ils évoluaient au fil du texte, au point que j’avais parfois l’impression qu’ils avaient pris le contrôle des dialogues. Peu importe comment vous l’introduisez, l’essentiel est que la réplique fasse mouche, qu’elle claque ! C’est une dimension de l’écriture très musicale. Pour moi, le dialogue est un élément central et indispensable au roman. Peut-être est-ce aussi parce que je suis musicien et amateur de cinéma.
Vous abordez au fil des pages plusieurs thématiques qui contribuent à construire un vrai testament censé à rendre compte des convictions et de la vie intime de votre personnage Victor Esmenard. Arrêtons-nous sur plusieurs d’entre elles. La première reflète le rapport de cet homme à l’écriture qu’il définit comme « une sorte de recréation, un exutoire salvateur, une parenthèse enchantée » ? Faites-vous votre propre opinion de cette définition ? Que dit celle-ci du romancier débutant que vous êtes ?
Oui et non. Disons que mon rapport à l’écriture est double. Je la considère d’abord comme un métier, puisque je suis journaliste en presse écrite depuis plus de vingt ans. Mais écrire un roman, c’est autre chose, c’est un peu comme partir à l’aventure ! Et c’est aussi un travail de longue haleine… Mais dans un cas comme dans l’autre, écrire a quelque chose de libérateur. C’est une sorte de récréation en effet, et cela doit le rester. Je n’envisage pas le fait d’écrire comme un carcan ou une souffrance, cela doit au contraire être un moment de liberté, où l’on se permet de changer de peau, de jouer avec les mots et les idées, d’hystériser des points de vue, de se cacher derrière des personnages, de vivre des vies que l’on a pas pu ou su vivre… C’est tout cela que j’attends de l’aventure de l’écriture. En cela, elle peut se révéler un exutoire salvateur qui peut nous sortir du quotidien, de son horizon vain, répétitif et terre-à-terre… L’écriture est un art, et l’art, c’est la vie.
Le deuxième sujet sur lequel je souhaite vous interroger tient disons de la conception politique de cette homme à l’expérience si riche et à l’âge de la sagesse. Quel sens doit-on donner à ses affirmations : « Le monde a changé très vite, les politiques sont presque tous devenus des professionnels de la communication, sans autre véritable objectif que de coller à l’air du temps. Force est de constater que les hommes d’État sont plus rares… » ?
J’ai toujours été passionné d’histoire et de politique, et forcément, lorsque l’on se retourne sur ces cinquante dernières années, on ne peut s’empêcher d’être quelque peu désabusé, voire franchement atterré par l’évolution du niveau des débats publics et de la qualité du personnel politique. Comme Victor, je ne suis certainement pas adepte du « c’était mieux avant », mais en la matière, je crois qu’il n’y a pas photo ! Le culte de la communication et le règne des sondages ont totalement sclérosé la vie politique, la complexité et l’élitisme républicain sont devenus un gros mot, et l’opinion de mon boucher sur la politique étrangère vaut celles du président de la République et des diplomates. Le niveau des débats s’en ressent, et le courage n’est pas la vertu cardinale de notre époque. Dans ces conditions, il ne faut pas s’étonner que les hommes d’Etat se fassent plutôt rares…
J’ai beaucoup aimé chez votre personnage cette vibration de l’âme concernant l’amitié. À la fragilité des relations humaines, il interpose l’impermanence, qui est elle-même une émanation de la sagesse. Qualifieriez-vous ce sentiment de scepticisme et/ou de lucidité chez cet homme ? Est-il un homme résigné ou sa carapace est plus protectrice qu’il ne se laisse pas se dévoiler facilement ?
Victor est double. Il arrive à la fin de sa vie et, je ne sais pas comment je réagirai à sa place le moment venu, mais il est pris entre des sentiments contradictoires. Il oscille entre la sagesse et la passion, il est encore dans la vie même s’il essaie de prendre congés progressivement. L’amitié, comme l’amour, est sûrement l’un des plus beaux sentiments humains, l’un de ceux qui nous font échapper à notre condition, et nous rendent heureux, mais comme en toute chose en ce bas monde, elle est aussi source de déception, de souffrance. Même à quatre-vingt dix ans, Victor n’est pas immunisé contre les passions humaines, même s’il essaie de prendre de la distance, de se résigner à une certaine sagesse. Est-ce une sagesse sereine qui l’envahit avec le temps ou qui s’impose à lui contraint et forcé, un peu des deux probablement… L’impermanence est partout, et c’est un chemin que nous sommes tous censés emprunter.
Cela me renvoie à une autre question étroitement liée à la précédente. Invité à parler de l’homme contemporain, Victor Esmenard répond : « Cruel, abject, sans pitié, mais aussi plein d’espérance, de générosité et de bienveillance ». Quelle signification prend cette phrase à la lumière qu’elle prend dans le contexte de votre livre, celui de la pandémie que nous vivons ?
Comme toutes les catastrophes qui touchent ou ont touché l’humanité, cette pandémie a révélé le pire et le meilleur de l’être humain. Tant au niveau des Etats, qui suspendent sans plus de cérémonie des libertés publiques que nous avons mis deux cent ans à installer, qu’au niveau des individus, où la divergence de points de vue quant au comportement à adopter face aux masques, à l’interruption de la vie sociale ou encore aux vaccins, sépare les gens, les familles, parfois de manière assez véhémente. La cohésion nationale est attaquée, et ce phénomène n’est pas propre à la France, mais à tous les pays du monde, en particulier occidental, même si tous n’ont pas eu la même approche face à cette situation hors du commun. Toutefois, cette pandémie nous enseigne une chose : où que nous soyons sur la planète, nous sommes tous sur le même bateau. En cela, la pandémie a rapproché les peuples, même s’ils ne peuvent plus se rencontrer tant que les voyages n’auront pas repris. Mais il y a tout de même une différence notable avec ce que nous avions connu au XXe siècle avec les guerres : si une guerre éclate, vous avez toujours l’espoir de pouvoir vous échapper. Ce n’est pas le cas avec la pandémie actuelle.
Quelques pages plus loin, l’ancien chef d’État, diplomate et prix Nobel, fait une remarque en guise de conclusion de son analyse : « En agitant la peur, on peut presque tout obtenir d’un être humain. D’un peuple et d’une société aussi ». Comment traduire ces affirmations à la lumière de l’expérience qui est la sienne ?
Victor est comme nous tous, triste et en colère depuis que cette pandémie et ses conséquences désolantes sont entrées dans nos vies. Mais il a une longue expérience, il a connu la guerre, et a même fait un séjour en camp de travail. Il a donc un certain recul sur les obstacles que nous pouvons être amenés à rencontrer dans l’existence. Mais il a aussi connu l’âge d’or des régimes totalitaires, et une époque où la liberté n’allait pas de soi. Il sait parfaitement quels sont les mécanismes destructeurs de la démocratie qui peuvent être activés pour toutes sortes de bonnes raisons, et c’est pour cela qu’il est particulièrement attaché au droit. Qu’il rappelle inlassablement que ce dernier n’est pas seulement là pour encadrer la société quand tout va bien, mais aussi et surtout pour nous protéger dans les périodes difficiles et quand tout va mal. Qu’on ne doit jamais suspendre les libertés publiques, quelles qu’en soient les raisons. Qu’il en va de notre liberté à tous.
Et, enfin, cette candide mais admirable déclaration qui revient à Charlotte. « Je suis admirative de votre parcours, mais aussi de la douceur du regard que vous posez sur la vie ». Magnifique convergence générationnelle, a-t-on envie de dire. Accordons donc à Charlotte la place qu’elle mérite dans l’économie de votre récit en vous invitant de lui dresser en conclusion son portrait. Que pouvez-vous nous dire d’elle ?
À une époque où les conflits entre générations semblent devoir devenir une question de société, il me semblait important d’établir un pont entre ces deux rives de la vie. Nous avons tous été un jour à la place de Charlotte, nous avons tous démarré dans la vie, quelle que soit la voie que l’on ait choisie. J’ai d’emblée éprouvé une grande tendresse pour elle, une vraie bienveillance en pensant à toutes les difficultés qui l’attendent dans la vie et qu’elle ne soupçonne pas encore. En me plaçant de son point de vue, j’aurais aimé avoir la chance de pouvoir poser toutes ces questions à un homme d’expérience aussi brillant que Victor. Il y a dans cet échange intellectuel quelque chose de filial entre ces deux-là, que l’on peut probablement tous transposer dans nos histoires personnelles.
Propos recueillis par Dan Burcea
Alexandre Arditti, La conversation, Éditions Les Presses Littéraires, 2021, 121 pages.
 Balustrade Littérature vous invite
Balustrade Littérature vous invite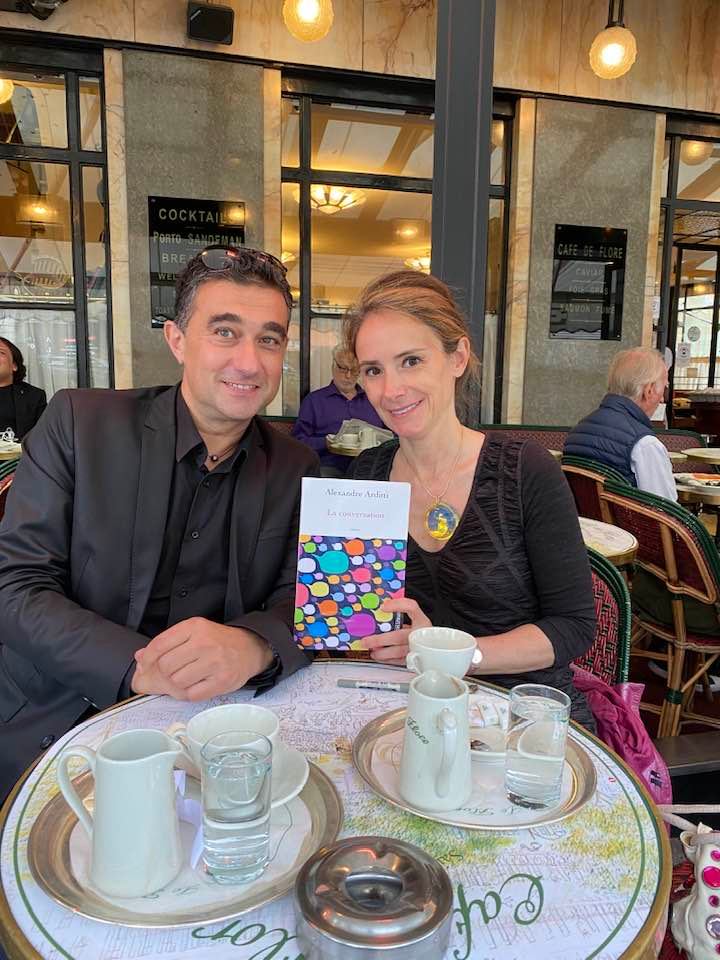



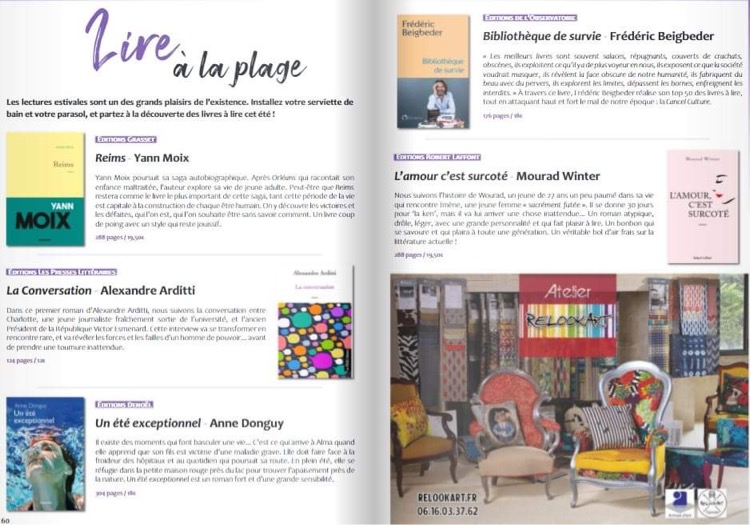
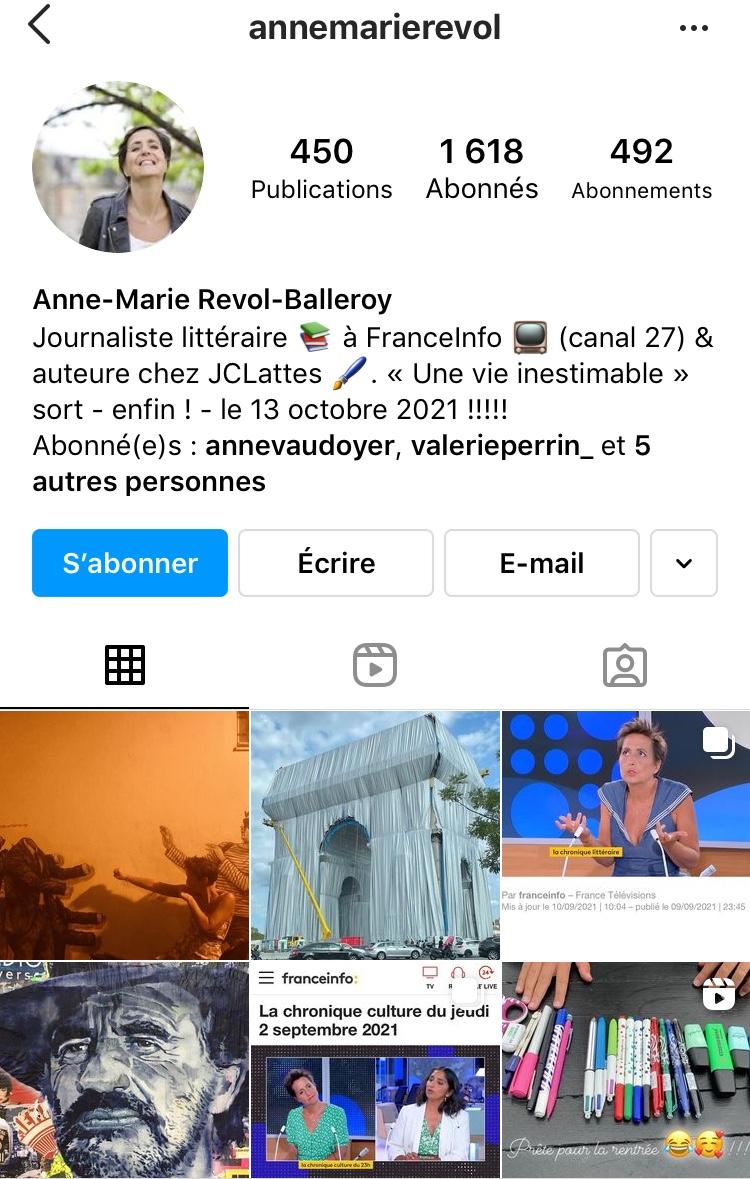

 La conversation, un roman d’Alexandre Arditti
La conversation, un roman d’Alexandre Arditti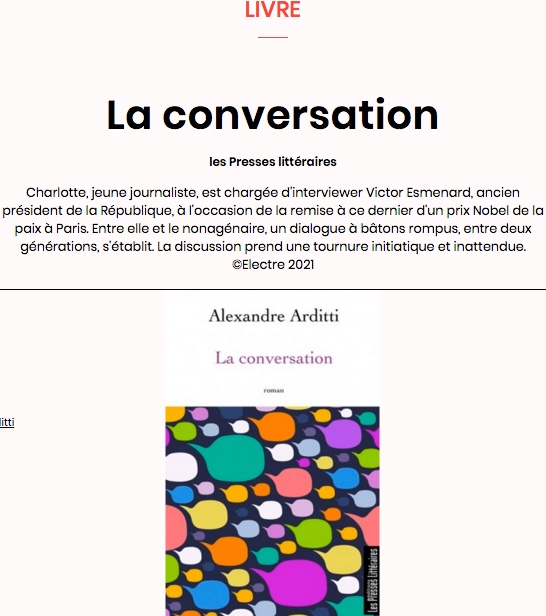

 À batons rompus…
À batons rompus…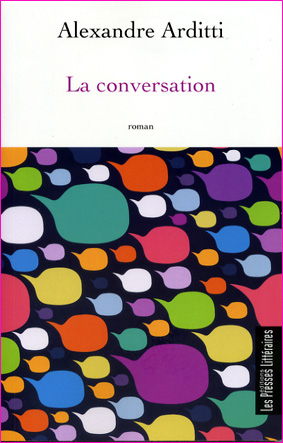
 Interview. Alexandre Arditti : « L’écriture est un art, et l’art, c’est la vie »
Interview. Alexandre Arditti : « L’écriture est un art, et l’art, c’est la vie »
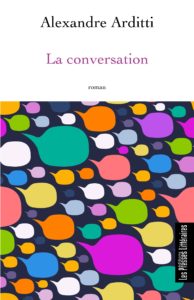 La conversation porte sur sa couverture la précision d’appartenance au genre romanesque. On aurait pu l’imaginer se dérouler sous forme théâtrale, comme un dialogue en plusieurs actes, selon les circonstances de lieu et de temps. Pourquoi avoir opté pourtant pour le roman plus que pour d’autres genres littéraires ? Quelle liberté, quel espace fictionnel vous a offert cette option ?
La conversation porte sur sa couverture la précision d’appartenance au genre romanesque. On aurait pu l’imaginer se dérouler sous forme théâtrale, comme un dialogue en plusieurs actes, selon les circonstances de lieu et de temps. Pourquoi avoir opté pourtant pour le roman plus que pour d’autres genres littéraires ? Quelle liberté, quel espace fictionnel vous a offert cette option ?