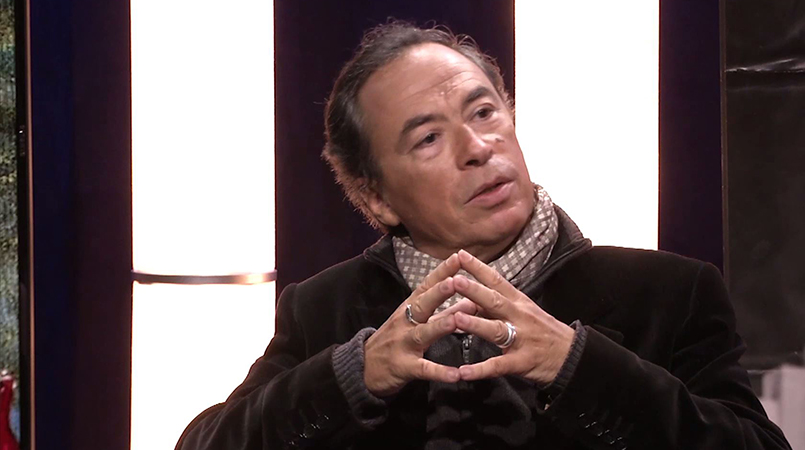 L’Ombre de la terre de Christine Fizscher – une critique de l’écrivain Luc-Olivier d’Algange
L’Ombre de la terre de Christine Fizscher – une critique de l’écrivain Luc-Olivier d’Algange
S’il appartient au récit de se remémorer le flux du temps, de remonter par la mémoire, « le fleuve où jamais l’on ne baigne deux fois », selon la formule d’Héraclite, il revient au poème de dire la royauté de l’instant.
Le recueil de Christine Fizscher qui vient de paraître aux éditions Dumerchez, illustré par les photographies sensibles et énigmatiques de Jonathan Abbou, veille sur le seuil, sur l’orée tremblante qui sépare ce qui apparaît de ce qui disparaît. L’instant n’est pas cette chose fugitive, comme le sont les vies humaines, et les civilisations mêmes, mais à l’intérieur, dans le secret du cœur, ce qui demeure, ce qui se tient.
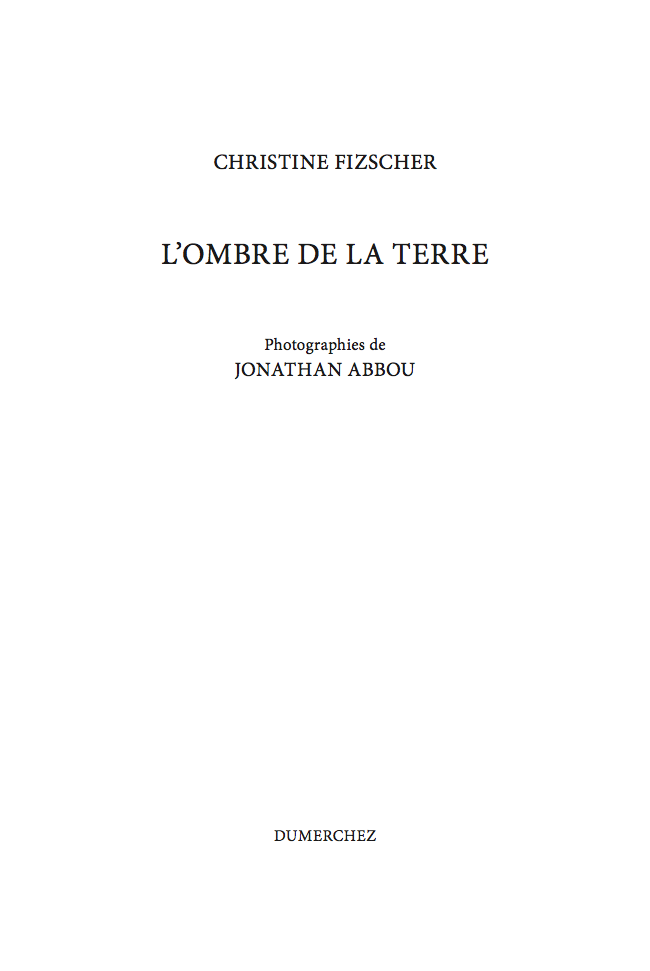 L’étymologie latine nous est ici d’un beau recours. L’instant est bien ce qui se tient, stat, – cette île immobile dans le tumulte des eaux, dans les bouleversements du temps. L’Ombre de la terrenous dit, ainsi, ce qui transparaît, comme l’étymologie dans le sens des mots, autrement dit la présence réelle. Dans le poème, ce qui passe est exactement ce qui demeure ; ce qui est devenu hors d’atteinte révèle sa plénitude immédiate ; ce qui est perdu est trouvé :
L’étymologie latine nous est ici d’un beau recours. L’instant est bien ce qui se tient, stat, – cette île immobile dans le tumulte des eaux, dans les bouleversements du temps. L’Ombre de la terrenous dit, ainsi, ce qui transparaît, comme l’étymologie dans le sens des mots, autrement dit la présence réelle. Dans le poème, ce qui passe est exactement ce qui demeure ; ce qui est devenu hors d’atteinte révèle sa plénitude immédiate ; ce qui est perdu est trouvé :
« Buissons d’odeurs
cimetière haut perché vers la mer
solitude bleue
Aluminium du jour, encre nocturne »
Le poème est ainsi en aplomb, au bord du précipice, qui n’est ni effrayant, ni sans douceur, ou suavité, au bord de la nuit, dans l’attente. La nostalgie et le pressentiment s’y accordent hic et nunc, dans leur saison propre, leur lieu circonscrit par l’ampleur du monde. Ce peut être en Août, golfe saronique, en octobre, ville d’Avray :
« La pelouse pâlit, le rosier devient transparent ;
Aux heures dorées, les dernières,
Perdre ces lieux
Et de nouveau se perdre.
Les feux de l’automne adoucissent la peau,
Un avion trace un fuseau blanc
Là-haut. »
 Dans sa royauté, l’instant laisse au lointain et au proche la chance d’être en un même regard. L’Ombre ici n’est pas l’ombre d’une chose, d’une « cause » précise, ou d’un obstacle qui s’interposerait entre ce que nous voyons et ce que nous pensons, mais l’ombre qui tamise, et précise paradoxalement la cruauté de la lumière, pour l’adoucir dans la réminiscence heureuse et dans l’éloge. Ces lieux, ces saisons, ces jardins et ces demeures, ces jours tournants et ces nuits ductiles dont on pourrait toucher la peau, sont saisies sur le vif, pour devancer leur perte et, selon la formule de Rimbaud, « tenir le pas gagné ».
Dans sa royauté, l’instant laisse au lointain et au proche la chance d’être en un même regard. L’Ombre ici n’est pas l’ombre d’une chose, d’une « cause » précise, ou d’un obstacle qui s’interposerait entre ce que nous voyons et ce que nous pensons, mais l’ombre qui tamise, et précise paradoxalement la cruauté de la lumière, pour l’adoucir dans la réminiscence heureuse et dans l’éloge. Ces lieux, ces saisons, ces jardins et ces demeures, ces jours tournants et ces nuits ductiles dont on pourrait toucher la peau, sont saisies sur le vif, pour devancer leur perte et, selon la formule de Rimbaud, « tenir le pas gagné ».
Là où nous sommes, dans cet espace entre la vie et la mort de « chaque fragment du temps qui passe » demeure la chance du poème, qui éprouve l’absence pour dire la présence, et qui songe l’exil comme la retrouvaille avec une patrie perdue. La beauté des poèmes de Christine Fizscher tient à cette attention, à l’amitié du rosier comme à la folle magnificence de Salamanque, au profond qui vient du songe comme à la hauteur d’un cèdre ou le vol de l’oiseau « entre la mer blanche et la lune noire ». Dans l’attention, le temps brûle. L’attente est ardente à l’ombre de la terre.
Luc-Olivier d’Algange