 Interview. Laurent Sedel : Ce n’est pas un hasard si j’ai intitulé le livre «petite histoire», c’est pour m’opposer à la «grande», celle des historiens
Interview. Laurent Sedel : Ce n’est pas un hasard si j’ai intitulé le livre «petite histoire», c’est pour m’opposer à la «grande», celle des historiens

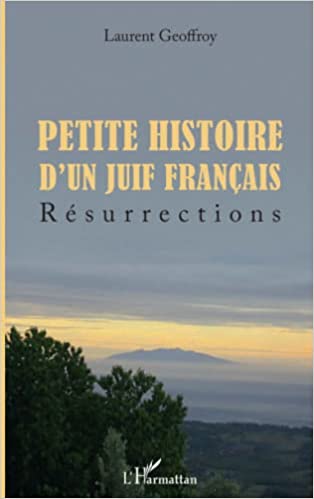 Le Professeur Laurent Sedel, chirurgien orthopédiste de renommée internationale et ancien chef de service à l’Hôpital Lariboisière, publie sous le nom de Laurent Geoffroy un livre autobiographique où l’histoire personnelle rencontre l’Histoire majuscule, Petite histoire d’un juif français – Résurrections. Derrière ce sous-titre à nuances itératives, se cachent des circonstances incroyables qui poussent l’auteur à faire l’éloge de la solidarité humaine à laquelle il doit son existence et celle de sa famille.
Le Professeur Laurent Sedel, chirurgien orthopédiste de renommée internationale et ancien chef de service à l’Hôpital Lariboisière, publie sous le nom de Laurent Geoffroy un livre autobiographique où l’histoire personnelle rencontre l’Histoire majuscule, Petite histoire d’un juif français – Résurrections. Derrière ce sous-titre à nuances itératives, se cachent des circonstances incroyables qui poussent l’auteur à faire l’éloge de la solidarité humaine à laquelle il doit son existence et celle de sa famille.
Professeur, le public vous connait plutôt grâce à vos livres sur l’état de l’hôpital et sur les techniques des prothèses de hanche dont vous êtes un des grands spécialistes reconnus mondialement. Vous venez de publier un livre à forte connotation personnelle, Petite histoire d’un juif français – Résurrections. Quel a été le ressort intérieur qui vous a poussé à écrire et publier cette autobiographie signée en plus par votre nom de naissance, Laurent Geoffroy ?
J’ai beaucoup de plaisir à écrire : je l’ai fait sur différents supports : Libération, le Monde où je m’exprimais beaucoup sur l’hôpital, la recherche. Ceci m’a conduit à écrire deux livres publiés chez Albin Michel, livres très critiques sur l’administration hospitalière, le poids des mutuelles et assurances complémentaires. Publiés il y a respectivement 13 et 11 ans, ils n’ont pas pris une ride. A une époque, vous pourriez trouver dans le courrier des lecteurs du monde des textes dont j’étais l’auteur. C’était un challenge. Ces courts écrits, que je rédigeais dans la nuit, confortaient mon ego. Je savais qu’ils étaient sélectionnés à partir de milliers d’autres textes. C’était très amusant à écrire aussi.
Ce livre : Résurrections (le vrai titre, modifié par l’éditeur), n’est pas strictement une autobiographie, c’est l’histoire à peine romancée de mes parents, de leur histoire incroyable pendant la deuxième guerre mondiale c’est aussi l’exposition d’idées fortes que je n’assume que partiellement. C’est pourquoi, j’ai préféré en laisser la paternité à un alter ego : Georges, qui me permet de me mettre en retrait en quelque sorte. J’avais aussi réalisé que l’histoire de mes parents, ma naissance ne peuvent être autobiographiques. Je m’en explique dans différents passages du livre. Signer ce livre de mon nom de naissance me permettait de faire entrer immédiatement le lecteur dans l’histoire, et aussi dans cette incroyable brutalité : obliger une mère à faire déclarer son fils de père et mère inconnus, uniquement pour se protéger elle-même de la police de Vichy. Cela permettait aussi par cette couverture de faire entrer l’histoire de cette sage-femme admirable. L’histoire de mes parents autour de ma naissance me permettait surtout de traiter des sujets que j’ai à cœur : l’un prégnant est l’utilisation qui est faite de ce massacre des juifs (sans oublier les homosexuels, les roms). Cette utilisation prend différentes formes que j’explique dans le livre. Cette utilisation, je ne l’accepte pas quand elle permet à certains humains de s’en draper pour pouvoir impunément asservir d’autres humains. L’autre sujet est une certaine compassion que j’éprouve pour les descendants des actifs de l’époque qui n’étaient pas du bon côté de l’histoire, comme moi. Ils n’y étaient pour rien mais peuvent subir toute leur vie cette forme de culpabilité qui peut d’ailleurs les conduire vers des voies politiques extrêmes.
En donnant la parole à Georges, votre alter-ego, vous avouez le laisser « raconter à sa façon » l’histoire de votre famille, et « rendre hommage à tous ceux dont l’action […] a permis qu’il existe, que sa famille survive et qu’il soit encore là […] pour raconter ». Peut-on dire que votre livre est également né de ce besoin de gratitude et de cette exigence de mémoire ?
Bien sûr, ce besoin de témoigner de cette gratitude, dont le symbole est déjà dans ce faux nom de Geoffroy, attribué par la sage-femme qui délivre ma mère ; est ce son nom à elle ? J’aime le croire. Et la remercier ainsi. Et puis tous les autres : le gendarme qui adresse la lettre retrouvée sur le quai d’une gare où passe le train pour Auschwitz et l’envoie à ma mère alors cachée et qui la reçoit, et plusieurs autres ; des gens simples, la femme de ménage de mes parents, le maire d’Igny, pas forcément des justes qui ont été encensés. Des gens bien.
« Écrire sur l’histoire de ses parents, sur soi-même, c’est plus que délicat », écrivez-vous. Comment comprendre cette phrase, surtout lorsque vous reconnaissez dans le même paragraphe avoir besoin « d’introduire une distance » dans le récit des faits ? Et pourquoi Georges « a choisi de raconter ce qui arrivait comme dans un roman » ?
C’est une question que je ne cesse de me poser. Tous les faits, les lieux, les prénoms de mes parents sont faux. Pourquoi ? je crois que c’est le désir de rester caché, pas trouvé par l’ennemi, je m’en explique vers la fin où je tente de remettre les pendules à l’heure et les lieux à l’endroit. Le lecteur intelligent qui a suivi doit pouvoir le comprendre. C’est aussi une façon d’entrer dans la littérature, avec ce que l’écrit permet, en quittant le style d’une vraie biographie.
Quelle signification porte le sous-titre de votre roman ? Qu’entendez-vous par ces Résurrections dont le pluriel a ici toute son importance ?
Depuis quelques années, il m’est venu l’idée que mon existence était une anomalie, après cette naissance improbable d’une mère qui avait passé 4 mois à Drancy l’année précédent ma naissance, et puis après ma greffe du foie. C’est cette dernière qui m’a fait penser que ces résurrections étaient la base du bonheur : la palingenèse que j’évoque et dont mon père, au retour des camps a dû souffrir (ou bénéficier) aussi. On est là dans un essai philosophique : discussion sur le bonheur que l’on trouve dans l’oubli, thème récurrent, ou bien dans la résurrection à partir d’un traumatisme fort.
À travers l’histoire de Georges, vous abordez toute une série d’aspects que souhaiterais aborder avec vous. Le premier est celui de vos origines – dont celle de vos grands-parents, de vos parents et de vous-même –, de votre naissance et de votre judéité que vous apprendrez plus tard. Quelle place occupe pour vous cette problématique ?
Curieusement, assez peu. Si j’ai quelques regrets d’être totalement incapable de remonter l’histoire de mes ascendants au-delà de mes grands-parents, je n’éprouve pas de réels besoins à ce sujet ; quand à ma judéité, elle ne m’intéresse pas. Je suis avant tout français, athée. Cette judéité m’interpelle uniquement par rapport aux autres. L’antisémitisme est un mystère que j’évoque souvent sans parvenir à en comprendre les mécanismes. J’ai aussi quelques réticences à adhérer à tous les aspects communautaires. Je sais bien que ma critique parfois acerbe de la politique israélienne participe en fait de l’exigence que j’éprouve pour cette communauté dont je me sais proche. Je suis sans doute plus exigeant avec elle que je le serai avec d’autres communautés, plus étrangères. Je place l’humain avant tout. Je l’ai beaucoup pratiqué dans mon métier, pense bien le connaître avec toute sa diversité dont je ne me lasse pas. Etant en contact avec différents milieux, je suis plus intéressé par ceux qui ne sont pas juifs, ceux qui peuvent avoir de la jalousie pour ce peuple, élu, pour ce peuple dont les souffrances sont exposées, magnifiées, presque encensées. Ces non juifs, en France peuvent imaginer leurs parents comme participants à ce crime odieux, c’est difficile. Ils s’exonèrent de différentes façons : certaines ridicules : c’est le négationnisme, d’autres plus habituelles : c’est pour moi l’explication des votes pour l’extrême droite : Marine Le Pen ou Zemmour ; ce dernier a su parfaitement jouer de ce ressentiment bien français en communicant sur ce que certains attendent : Pétain a aussi sauvé des juifs. Il y a gagné pas mal d’électeurs alors que tout son discours est contre les immigrés, symbolisant en quelque sorte une sorte de pétainisme à la française de 2021. La France est un drôle de pays où René Bousquet le haut responsable de la rafle du Vel D’Hiv a été pendant encore de nombreuses années le meilleur pote de Mitterrand.
Lié à vos origines, l’aspect générationnel est absolument intrinsèque, s’imbriquant comme des poupées russes tout au long de l’histoire du XXe siècle à travers l’immigration, la naturalisation, les affres de la guerre et des camps de la mort. Comment vit Georges toute cette épopée familiale ? Quels sont ses souvenirs, ses joies et ses peurs ?
Georges rapporte ces faits le plus objectivement possible ; il les reconstitue à partir de données qu’il a lui-même obtenues de ses proches ; il y a les écrits de son père qui avait comme lui ce gout de l’écriture. Il aurait bien aimé connaitre ce grand père Siga dont il porte le deuxième prénom : Sigismond. Les autres grands parents, il les a vraiment connus puisqu’ils vivaient ensemble dans cette grande maison de Bièvres. Comme dans toutes les familles, il regrette quand c’était possible de ne pas les avoir mieux interrogés. Georges menait sa vie comme d’autres, l’adolescence, les études ne sont pas propices à se poser des questions sur ses origines. Plus tard, on le regrette, c’est certainement mon cas. Je raconte mon voyage récent à Lviv, lieu de naissance de mon père et la surprise d’y avoir vu une belle et grande ville Mitteleuropa, lieu de naissance de mon père mais aussi du boucher de Pologne : Hans Frank ainsi que du procureur de Nuremberg, celui qui a défini le terme de Génocide appliqué aux crimes nazis. Je laisse en réalité l’histoire aux spécialistes, aux historiens. Ce n’est pas un hasard si j’ai intitulé le livre « petite histoire », c’est pour m’opposer à la « grande », celle des historiens.
Parmi ces peurs, Georges relève ce qu’il appelle « les peurs irraisonnées », en parlant de l’antisémitisme, y compris de nos jours. Selon lui, « il faut apprendre à remettre l’histoire, la vraie, au centre du débat ». Quel sens ont pour vous ces paroles qui appellent au sens de la responsabilité et de la sagesse afin d’éviter d’aviser les haines et les ressentiments ?
Là je fais un peu de politique. J’ai depuis longtemps compris que la peur est un socle de pouvoir, que la ou les peurs nourrissent les médias, et qu’il est de plus en plus difficile d’avoir un débat serein sur de multiples sujets de sociétés. Le racisme fait partie pour moi d’une certaine peur de l’autre. Le réchauffement climatique en est un : la température monte, c’est certain. Mais au-delà, le rôle de l’homme reste en débat : important pour le GIEC, plus restreint ou mal évalué pour d’autres dont je fais partie ; comme esprit rationnel je crois surtout que l’on retrouve dans cette affaite l’arrogance humaine qui se targue de régler le problème, ce dont je doute. Il faut reconnaitre notre impuissance, prendre sans doute des précautions, économiser nos ressources : soit, mais après ? Israël pour moi survit sur des peurs : peurs des arabes, des musulmans, peur d’une démographie qui n’est pas en faveur de ce petit pays qui veux à tout prix rester juif. Eliminer ces peurs, apprendre à vivre ensemble, c’est la base de toute solution, même si la prudence impose de rester armé et vigilant.
Vous évoquez vos grands-parents nés en Bucovine, appartenant à l’époque à la Roumanie. De tous les membres de votre famille, Siga, votre grand-père et sans doute la figure la plus puissante. Sa naturalisation, telle que racontée par Sara, la mère de Georges, représente pour lui un moment d’immense joie et de fierté. Décrivez-nous cette figure du grand-père. Et celle de tante Gisèle, figure pittoresque rendant visite à votre famille, de sa ville de Bucarest où elle habitait ?
Siga ou Sigismond est finalement le seul que je n’ai pas connu. Tout son souvenir m’a été rapporté par sa femme, sa fille ou son fils. J’ai pu aussi avoir quelques photos de lui déjà à un certain âge. J’imagine qu’il avait une forte personnalité, certainement très attachante. J’ai réalisé récemment qu’il a fait partie de la « rafle des notables » médiatisée par Anne Sinclair. Comme je le raconte dans le livre, il est parti à la place de sa fille qui était dentiste et que la police de Pétain avait ordre d’emprisonner. Lui n’était certainement pas un notable : représentant de commerce. Je n’ai jamais su de quels objets. Et sa fille, ma mère, jeune femme de 23 ans à l’époque était née à Paris, vivait à Montmartre. Sur quels critères la police réalisait ces arrestations ?
Sur Gisèle, j’ai simplement entendu parler d’elle par ma grand-mère ; j’avais dû la rencontrer petit garçon à l’occasion d’un de ses voyages . Elle a donc continué à voyager après la guerre. Pour le reste, j’ai brodé.
Il est temps d’évoquer les figures des parents de Georges, René et Sara. De leurs vies, on peut tracer deux périodes : celle pendant la guerre avec tous les calvaires des camps et ce que Georges appelle l’expérience de Drancy vécue par Sara, et celle plus calme d’après-guerre. Pouvez-vous dresser les portraits de ces deux êtres chers qui ont été vos parents ?
C’était un beau couple, ils avaient la même origine, avec une enfance dans la pauvreté, une complicité très forte qui explique le manque de prudence dont ils font preuve. Qui, à l’époque, pouvait imaginer la suite ? Ils avaient chacun une personnalité forte, généreuse,. Ils lisaient beaucoup, gout qu’ils ont transmis à leurs enfants. Ils étaient aussi exigeants avec nous, voulant à tout prix que nous soyons les meilleurs en tout. J’en plaisante maintenant, mais les remercie aussi de m’avoir poussé à faire du piano, ce que je continue à faire avec beaucoup de plaisir. Mon père, au retour des camps était très affaibli, mais il en parlait peu, portait beau et après ses 46 ans de vie normale dans une atmosphère sereine a certainement été très heureux.
Enfin, permettez-moi de clore notre discussion avec deux aspects que vous évoquez vers la fin de votre livre : « le sentiment de l’indicible » et « la culpabilité des revenants ». Les deux sont liés aux expériences de vie de votre père et de ceux qui sont revenus des camps, mais aussi de la mort de votre grand-père. Pensez-vous que ces sentiments ont encore un sens aujourd’hui, que l’Histoire soit encore capable de ressusciter ces peurs, ces haines et ces doutes ?
Mon père était, comme je le dis plus haut, très heureux. Cependant il gardait toujours une certaine tristesse difficile à analyser ; une partie était sans doute en relation avec cette notion d’indicible et les amalgames facilement faits entre le STO, les prisonniers militaires et les nuits et brouillards des camps de concentration. Il s’est beaucoup battu pour faire respecter cette histoire, rappeler l’état très particuliers des camps de concentrations : usines à tuer, à éradiquer. Il en a été un témoin direct. L’autre raison d’alimenter cette tristesse était cette forme de culpabilité d’en être revenu. C’est mon hypothèse, et c’est Georges qui l’exprime.
C’est aussi pour éviter que l’histoire ne recommence que j’écris. Il faut oublier ou au moins reléguer l’histoire aux historiens, sinon, nous sommes condamnés à ressasser en permanence, à monter des victimes les unes contre les autres, à susciter des haines qui peuvent, instrumentalisées, aboutir à des conflits armés. C’est pourquoi je tente de porter un message d’humanité : rappeler ceux qui se sont bien comportés, laisser les nazis et les extrémistes dans leurs marigots nauséabonds, mais aussi expliquer à leurs enfants, nés depuis qu’ils n’y sont pour rien. Et puis tous les humains ne sont-ils pas semblables ? Ce que les communautarismes tentent de réfuter.
Propos recueillis par Dan Burcea
Laurent Geoffroy, Petite histoire d’un juif français – Résurrections, Editions L’Harmattan, mars 2022, 232 pages.