Ninon a grandi. Moon est une vendeuse de sourires.
Paumée, clocharde, oui, sans doute. Mais avec un sourire qui est grand, un petit côté crâneur, et un oeil qui perle vers le soleil. Elle tend la main à Paris, du côté de Saint-Séverin. Si vous n’avez jamais été pauvre, lisez Maud Lethielleux. Déjà, l’an dernier, je vous avais conseillé son premier roman, Dis oui, Ninon ; vous devez le relire et découvrir celui-ci : D’où je suis, je vois la lune.
Moon vit dans la rue, et laisse traîner les cahiers où elle se raconte. Quelqu’un s’en empare, les met au propre et lui dit qu’elle est un écrivain : « Le type dit que je suis un auteur et ça me fait une belle jambe étant donné que je ne sais pas à quoi ça ressemble, un auteur. Quand il me demande où j’habite j’ai un instant d’hésitation, j’explique que je suis en plein déménagement, ce qui n’est pas faux puisque je ne sais pas où je vais dormir demain. » Très juste ! Même nous, les auteurs, nous ne savons pas « à quoi ça ressemble, un auteur ». En tout cas, ça peut ressembler à Maud Lethielleux. Lisez-la : c’est une petite qui vaut bien des grandes.
Une grande, mais vraiment grande, et qui a déjà pas mal de livres à son actif, et qui a peint des toiles magnifiques, et qui nous conte depuis longtemps ses voyages initiatiques, sa vie, ses errances : c’est Jacqueline Merville.
Je suis un peu honteux de devoir vous présenter Jacqueline Merville, au cas où vous n’auriez rien lu d’elle : c’est un écrivain magnifique, une auteure, un poète, une femme, une… les mots sont insuffisants ici. Cette femme est un grand écrivain. Depuis La Ville du non, en 1986, et de nombreux romans, récits, poèmes, elle a sculpté une oeuvre étrange, digne et grave. Une statue égyptienne. C’est Jacqueline la Merveille ! Et bien sûr, son histoire personnelle, parfois fidèlement restituée dans certains de ses textes les plus récents, nous surprend par l’audace mise en pratique, assumée, vécue : elle vit comme elle veut. Elle voulait partir, elle est partie. Elle voulait faire face à la souffrance du monde, elle l’a fait. « Vagabonde sur la terre », dit son éditeur L’Escampette, sur la quatrième de couverture de Voyager jusqu’à mourir. Ou voyager jusqu’à vivre ? Car vivant depuis presque vingt ans en Asie, surtout en Inde, elle a, avec son compagnon, fréquenté les chemins des pèlerins du nord au sud, avec bien peu de moyens et de volonté de fer. Et puis un jour… Oh, ce n’est pas racontable… Elle, elle sait le raconter. Dans The Black Sunday, elle a dit l’impensable : elle se trouvait sur les côtes de l’Inde au moment où est survenu le tsunami. Elle raconte cela : le tsunami.
Et voilà qu’aujourd’hui, alors qu’on pensait qu’elle avait vécu là-bas une expérience indépassable, elle avoue qu’elle en avait déjà vécu une auparavant, en Afrique. Elle dit seulement : « un « supplice ». Elle n’utilise pas les mots habituels : torture, viol ; et elle raconte comment elle a survécu. Comment ne pas demeurer une demeurée : une victime. Dans ce texte superbe, Presque africaine, elle parle en son nom seul, et voici que depuis quelques semaines des femmes lui écrivent : merci d’avoir dit pour nous ce que nous ne pouvons pas dire.
Pourquoi avoir vécu tout cela ? C’est un mystère. Jacqueline Merville s’y confronte, et ose avancer encore : « Avais-tu besoin d’être, un instant, hors de la femme blanche ? De l’oublier comme on oublie son nom, sa respiration, sa pensée ? N’être plus l’étrangère. Devenir l’autre, sans peau. »
Et c’est bien ce que l’on risque, à lire Jacqueline Merville, devenir l’autre, explorer des contrées inconnues, passer à l’autre comme on passe à l’ennemi. C’est une si forte expérience qu’il n’est point besoin, ici, d’en rajouter : quelques personnes voudront lire Jacqueline Merville, afin de faire cette expérience. D’autres, c’est certain, n’oseront jamais.
D’où je suis, je vois la lune, Maud Lethielleux, Editions Stock, 297 p., 18,50 euros.
The Black Sunday, 26 décembre
2004, Jacqueline Merville, Editions des Femmes (mars 2005), 91 p., 9,50 euros.
Presque africaine, Jacqueline Merville, Editions des Femmes, 74 p., 10 euros.
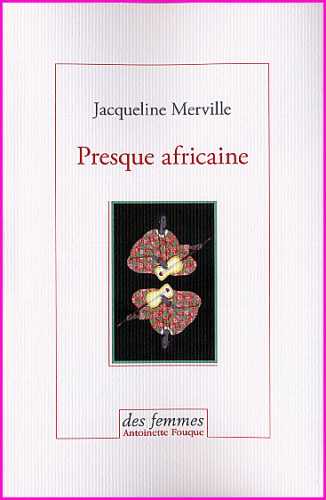
 Jeudi 20 mai sur France 3 Ile de France
Jeudi 20 mai sur France 3 Ile de France
 Dimanche 9 Mai 2010 – Dimanche 9 mai 20100
Dimanche 9 Mai 2010 – Dimanche 9 mai 20100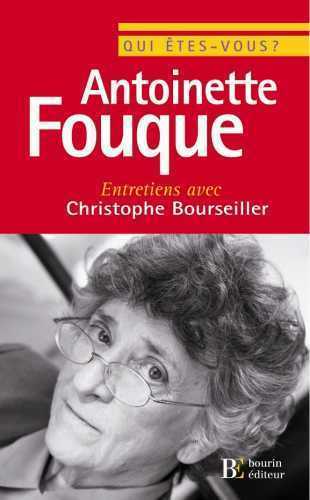 Antoinette Fouque est de celles-là. Elle nous signale les dates phares qui jalonnent sa vie. Ce sont comme autant de naissances successives.
Antoinette Fouque est de celles-là. Elle nous signale les dates phares qui jalonnent sa vie. Ce sont comme autant de naissances successives.
 Isabelle Clerc
Isabelle Clerc Nous sommes le 15 septembre 1943 à 20h30. Le énième bombardement les usines de l’ouest de Paris, dont Renault qui collaborait avec l’Occupant, a fait plus de sept mille morts durant la guerre. Mais ce jour-là, ce sont trois occupants d’une voiture qui sont fauchés porte de Saint-Cloud. Le chauffeur est le père, la passagère arrière la tante et la passagère avant sa femme – la mère. Enceinte, on l’accouche par césarienne in extremis d’une petite fille. C’est cette histoire que nous conte Chantal – son histoire.
Nous sommes le 15 septembre 1943 à 20h30. Le énième bombardement les usines de l’ouest de Paris, dont Renault qui collaborait avec l’Occupant, a fait plus de sept mille morts durant la guerre. Mais ce jour-là, ce sont trois occupants d’une voiture qui sont fauchés porte de Saint-Cloud. Le chauffeur est le père, la passagère arrière la tante et la passagère avant sa femme – la mère. Enceinte, on l’accouche par césarienne in extremis d’une petite fille. C’est cette histoire que nous conte Chantal – son histoire.

 Informations sur le site :
Informations sur le site :
 Lundi 3 mai à 21 h, l’excellent André Nahum, fidèle lecteur de Chantal Chawaf a choisi de l’interviewer avec deux autres écrivains dans son émission sur Judaïques FM 94.8.
Lundi 3 mai à 21 h, l’excellent André Nahum, fidèle lecteur de Chantal Chawaf a choisi de l’interviewer avec deux autres écrivains dans son émission sur Judaïques FM 94.8.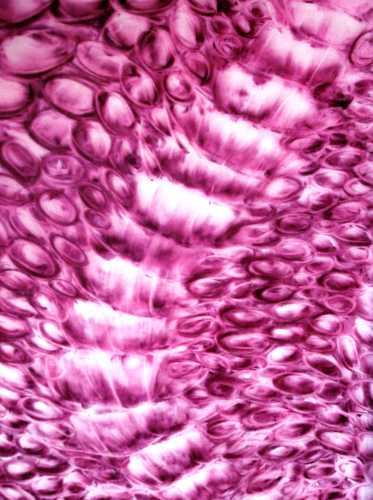 Questions de Femmes – de lundi 3 mai 2010. Par Marjorie Mitucci
Questions de Femmes – de lundi 3 mai 2010. Par Marjorie Mitucci
Hypatie d’Alexandrie – Maria Dzielska
lundi 3 mai 2010, critique par Tristan Hordé
Sur ©e-litterature.net
Hypatie d’Alexandrie est devenue héroïne du grand écran sous les traits de Rachel Weisz dans le film Agora (présenté à Cannes en 2009) du réalisateur espagnol Alejandro Amenábar, qui raconte l’histoire de la philosophe et mathématicienne. En France, le premier à la sortir de l’oubli est un grammairien connaisseur de l’Antiquité, Gilles Ménage, qui publia en 1690 Historia Mulierum philosopharum [Histoire des femmes philosophes]. Le sujet a été repris et développé en 2006 par Éric Sartori avec son Histoire des femmes scientifiques de l’Antiquité au XXe siècle : Les filles d’Hypatie. Ce titre donne à Hypatie un rôle de pionnière et on attendait qu’un livre lui soit consacré, qui reprenne minutieusement le peu d’éléments dont on dispose à son propos, textes anciens et correspondances. Il ne suffisait pas de les citer, mais de les comparer et de les analyser en relation avec ce qui peut par ailleurs être connu de la vie politique et des conflits de l’époque.
Maria Dzielska a reconstruit en partie la vie d’Hypatie et analysé la manière dont on a reconstitué sa biographie depuis le XVIIIe siècle. Sa beauté et sa jeunesse ont été constamment louées, elle a été perçue à la fois comme « un symbole de la liberté sexuelle et du déclin du paganisme (et, avec lui, de la disparition de la pensée libre, de la raison naturelle et de la liberté d’expression). » La réalité est différente et plus complexe.
Hypatie, née vers 355 et morte en 415, devint, comme son père Théon, mathématicienne et astronome (elle aurait peut-être mis au point l’édition de l’Almageste de Ptolémée), et elle enseigna aussi la philosophie. Ses disciples faisaient souvent de longs voyages pour former auprès d’elle une communauté intellectuelle, issus de Syrie, de Lybie ou de Constantinople (maintenant Istanbul). Elle était appréciée pour ses qualités morales, menait un train de vie modeste et n’eut probablement jamais de relations sexuelles ; « toutes nos sources, écrit Maria Dzielska, s’accordent à la présenter comme un modèle de courage éthique, de vertu, de sincérité, de dévouement civique et de prouesse intellectuelle. » Dévouement civique : elle était sollicitée pour conseiller les autorités d’Alexandrie ou impériales.
Hypatie n’a pas été victime d’une campagne contre les païens, non seulement parce qu’elle n’avait pas marqué de sympathie pour les cultes païens, mais aussi parce que les chrétiens s’en prirent d’abord aux juifs avant de combattre la pensée païenne. Après elle, la philosophie grecque, les mathématiques et l’astronomie ne disparurent pas à Alexandrie : « Jusqu’à l’invasion arabe, des philosophes continuèrent à expliquer l’enseignement de Platon, d’Aristote […] et des néoplatoniciens. » Par ailleurs, Hypatie fut d’une certaine manière récupérée par le christianisme : il semble que la plupart de ses qualités ait été versée à la légende de Catherine d’Alexandrie.
Maria Dzielska apporte un point de vue nouveau sur Hypatie et, en outre, étudie dans le détail le statut de ses disciples, ce qui permet de restituer la composition du milieu intellectuel d’Alexandrie dans la dernière partie du IVe siècle ; ces disciples, riches, puissants — et seulement masculins —, occupaient tous de hautes fonctions. Ce travail savant, si nécessaire à la connaissance de l’Antiquité tardive, ne fait donc pas que mettre au jour, comme l’écrit Monique Trédé dans sa préface, « la figure complexe d’une éminente intellectuelle, en un temps où l’hellénisme jette ses derniers feux. » On regrettera seulement que la traduction, à partir d’une version anglaise, soit parfois approximative.
Tristan Hordé