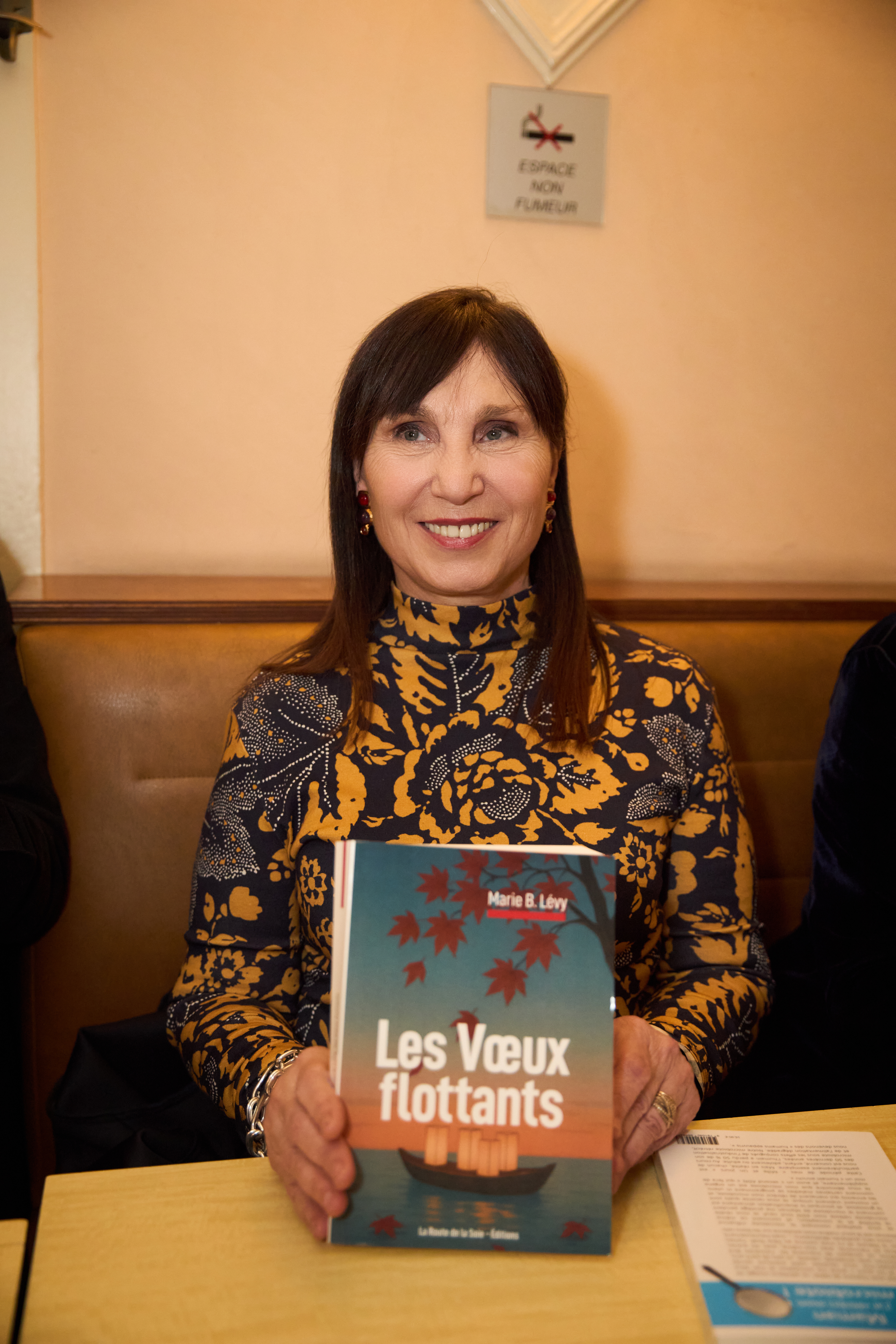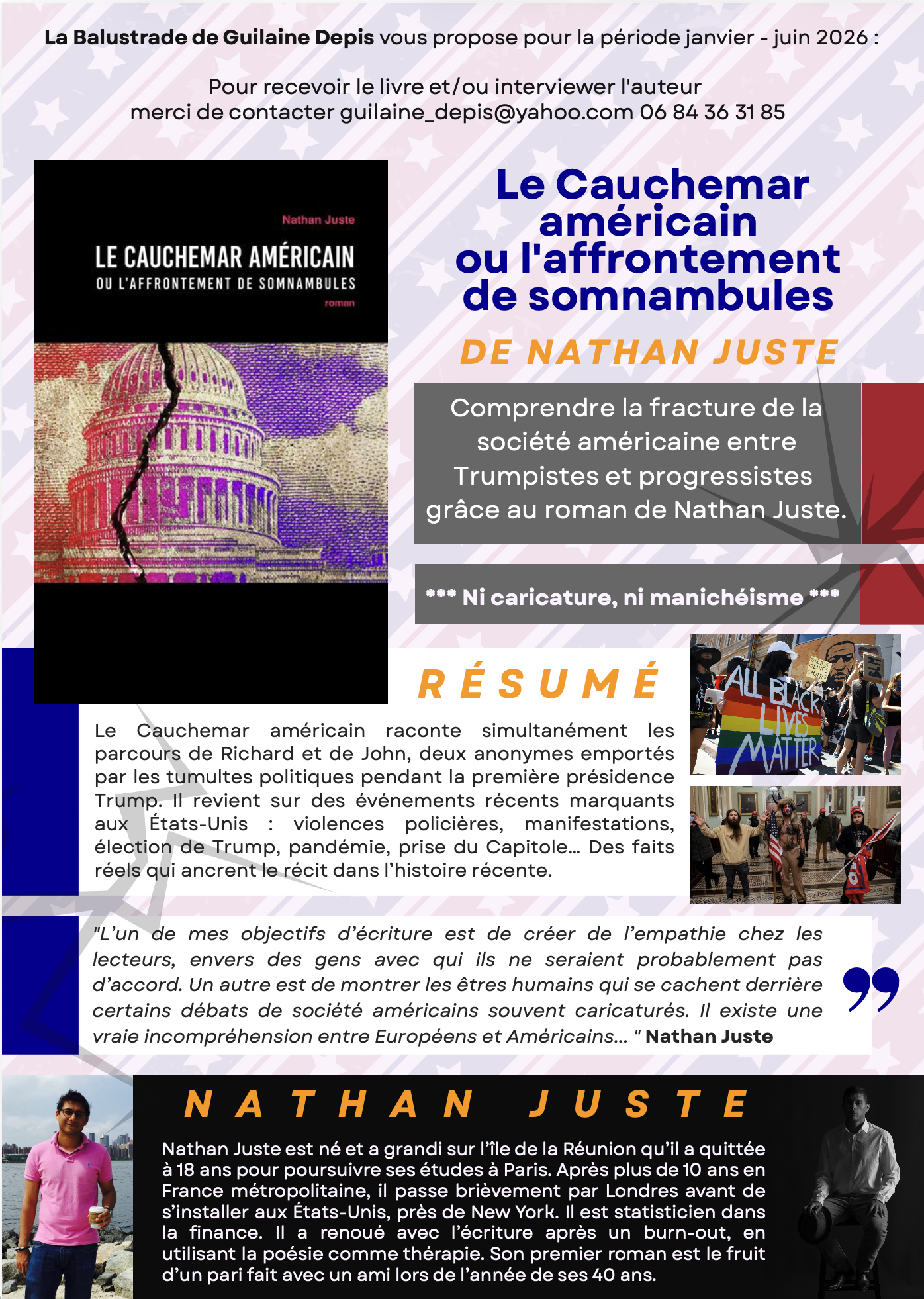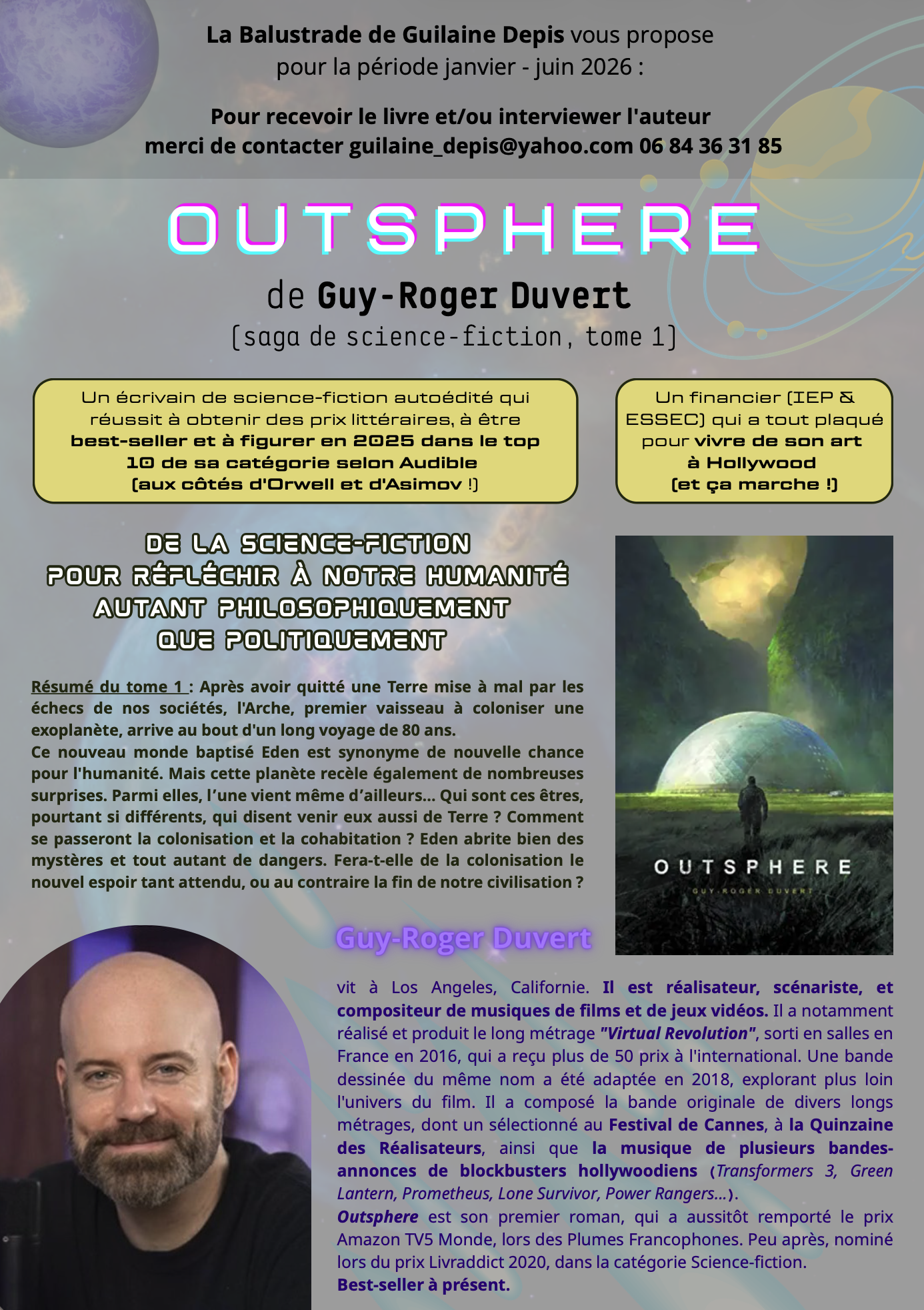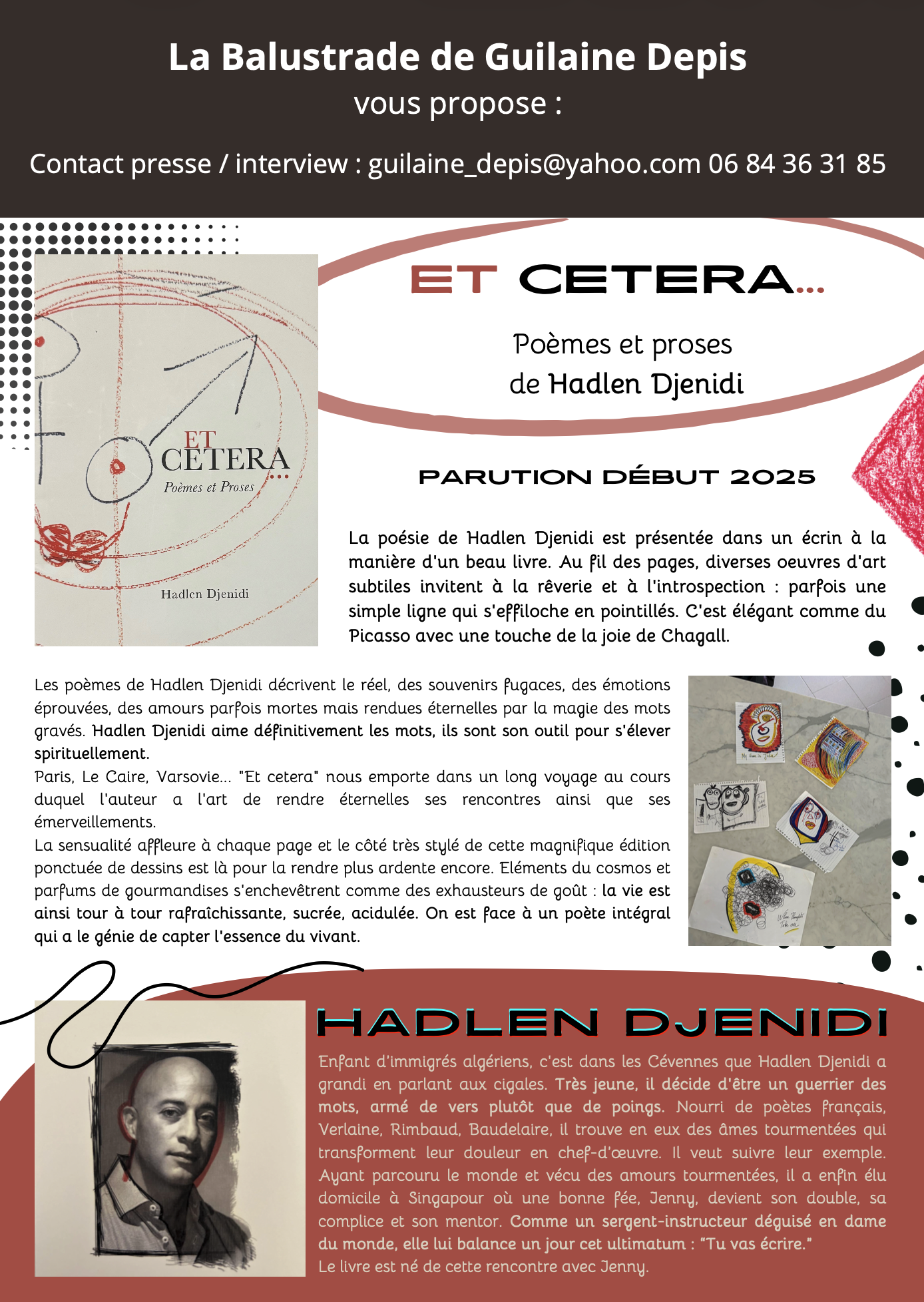Par Yves-Alexandre Julien – Critique littéraire.
Entre le retour de la guerre sur le continent, l’affirmation de puissances hostiles au multilatéralisme et la fragilisation de l’alliance transatlantique, l’Union européenne se découvre vulnérable comme jamais depuis la fin de la guerre froide. Dans L’Europe entre Poutine et Trump, Pierre Ménat dresse un diagnostic rigoureux, sans illusion ni incantation, d’un continent pris au piège de ses dépendances et de ses hésitations stratégiques. Un essai de lucidité, à lire comme un rapport sur l’état politique de l’Europe à la fin de l’année 2025.
Le retour du tragique dans l’histoire européenne
Avec L’Europe entre Poutine et Trump, Pierre Ménat livre un ouvrage qui relève moins de l’essai idéologique que du diagnostic stratégique. Ancien ambassadeur, fin connaisseur des institutions européennes, il ne prétend ni refonder la théorie politique ni proposer une utopie nouvelle. Il s’attache à une tâche plus ingrate mais plus nécessaire : penser l’Europe telle qu’elle est, confrontée à un monde qui a renoué avec le tragique de l’Histoire.
Ce tragique est formulé sans détour dans la seconde partie du livre : « L’Europe est seule. La Russie est devenue un adversaire systémique. Les États-Unis ne sont plus un partenaire fiable. »
Rarement le constat aura été posé avec une telle netteté. Cette triple affirmation condense tout l’argument de l’ouvrage : l’Europe ne peut plus s’abriter derrière ses alliances traditionnelles ni différer son accès au statut de puissance sans en payer le prix politique.
Poutine : la souveraineté contre le droit
À l’Est, la Russie de Vladimir Poutine apparaît comme une puissance structurée autour d’une souveraineté absolue, hostile à toute norme supranationale. Le droit international y est perçu comme une contrainte illégitime, et les « valeurs occidentales » comme une menace civilisationnelle. Cette analyse rejoint la tradition réaliste décrite par Raymond Aron dans Paix et guerre entre les nations (1962), lorsqu’il rappelait que les régimes refusant les règles communes finissent toujours par imposer leur propre logique de puissance.
La lecture de Pierre Ménat trouve également un écho direct dans les travaux de Michel Eltchaninoff, notamment Dans la tête de Vladimir Poutine (2015), où le pouvoir russe est analysé comme un national-conservatisme assumé, fondé sur le rejet de l’universalisme et la restauration d’une grandeur perdue.
Trump : le populisme contre les institutions
Le second choc analysé par l’auteur est celui du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Pierre Ménat ne se contente pas d’une lecture psychologique du personnage : il décrit un système de pouvoir brutal, décomplexé, imprévisible. L’épisode du 28 février 2025, lors de la rencontre entre Trump et Volodymyr Zelensky, en constitue la scène fondatrice.
L’auteur en tire une conclusion lourde de sens : « Cet épisode marque un tournant : Trump ne considère plus l’Europe occidentale au sens large comme une alliée. »
Cette phrase, d’une sobriété glaçante, rompt avec l’illusion d’un simple malentendu transatlantique. Pierre Ménat ne décrit pas une crise passagère, mais une mutation stratégique durable, où l’alliance devient conditionnelle, instrumentale, réversible.
Face à ces deux pôles de puissance, l’Europe apparaît forte en principes mais faible en actes. Pierre Ménat souligne son incapacité à se faire respecter sur le plan commercial, à retenir ses talents, à investir son épargne sur son propre sol ou à maîtriser ses flux migratoires. Cette critique rejoint celle formulée par Pierre Manent dans La Raison des nations (2006), selon laquelle l’Europe a cru pouvoir substituer le droit au politique et la norme à la décision.
Contestée en interne par des droites radicales aux profils distincts – conservateurs, souverainistes, nationalistes -, l’Union se fragilise encore en multipliant les projets d’élargissement sans approfondissement préalable.
Élargir ou approfondir : le retour d’un dilemme fondateur
Pierre Ménat consacre des pages particulièrement sévères à la politique d’élargissement. Il rappelle que ce qui n’était encore qu’un risque est désormais devenu une trajectoire presque irréversible : « Le risque de l’élargissement doit aujourd’hui être considéré non plus comme une hypothèse, mais comme une quasi-certitude. »
En employant cette expression, l’auteur franchit un seuil lexical révélateur : l’élargissement n’est plus un choix stratégique, mais un processus enclenché, dont les conséquences sont de moins en moins maîtrisées. La référence au général de Gaulle, opposé dès les années soixante à une extension incompatible avec l’approfondissement, s’impose ici naturellement.
Pierre Ménat avertit sans détour : « Passer de 27 États membres à 30 ou 35, et ce à horizon 2030, c’est courir un risque de dilution et de déperdition des moyens. »
La spirale des dépendances européennes
Le cœur analytique de l’ouvrage réside dans l’inventaire méthodique des dépendances européennes : énergétiques, industrielles, technologiques, agricoles, financières et géographiques. Sur l’énergie, l’auteur rappelle une évidence longtemps refoulée : « La dépendance énergétique de l’Europe a été brutalement exposée par l’invasion russe de l’Ukraine. »
Le choix de l’adverbe « brutalement » est révélateur : l’Europe n’a pas découvert sa dépendance, elle l’a subie. L’énergie cesse ici d’être un simple enjeu économique pour redevenir un attribut central de souveraineté, comme l’avaient déjà souligné les analyses de Zygmunt Bauman dans La Vie liquide (2005), décrivant des sociétés riches mais structurellement vulnérables.
Immigration et guerres hybrides : l’angle mort stratégique
Sur la question migratoire, Pierre Ménat adopte une approche résolument stratégique. Il souligne l’insuffisance du pacte migratoire européen et l’absence de vision d’ensemble, dans un contexte où les flux peuvent être instrumentalisés comme des outils de déstabilisation. Cette lecture rejoint les travaux de Gérard-François Dumont, auteur de Géopolitique des migrations (2019), qui analyse les migrations comme un facteur structurant des rapports de force contemporains.
Défense européenne : l’urgence d’une rupture
La défense constitue le point de cristallisation de toutes les faiblesses européennes. Fragmentée, dépendante de l’Otan, dépourvue de préférence européenne, elle souffre avant tout d’un déficit de volonté politique. Pierre Ménat estime que la politique des petits pas est désormais inadaptée à la gravité de la menace russe et plaide pour une rupture institutionnelle, fondée sur un nouveau traité, à adhésion volontaire, dans l’esprit du Plan Fouchet.
Une voie médiane contre les illusions
Ni fédéraliste doctrinaire ni souverainiste nostalgique, Pierre Ménat défend une voie médiane, fondée sur une répartition pragmatique des compétences entre États et Union. Il rappelle que le fonctionnement institutionnel européen s’est construit sans modèle préétabli : « Le fonctionnement institutionnel de l’Union n’a jamais obéi à un modèle préétabli. »
Ce pragmatisme, s’il a permis d’avancer, a aussi produit un empilement institutionnel devenu illisible. La position de l’auteur rejoint ici la conception wébérienne de la politique comme art du possible, telle que formulée par Max Weber dans Le Savant et le politique (1919).
Livre d’actualité appelé à être rapidement dépassé par la marche de l’Histoire, L’Europe entre Poutine et Trump n’en demeure pas moins précieux. Il fixe les termes du débat, hiérarchise les urgences et rappelle une vérité que l’Europe peine encore à regarder en face : la puissance ne se proclame pas, elle se construit ou elle se subit.
 L’Europe à l’épreuve du tragique : Poutine, Trump et la fin de l’innocence européenne
L’Europe à l’épreuve du tragique : Poutine, Trump et la fin de l’innocence européenne