Le silence du nom et autres essais – Interprétation et pensée juive
Esther Cohen
Traduit du mexicain par Anne Picard.
Préface de Catherine Chalier.
Office 05/04/2007
Dans Le silence du nom, Esther Cohen rassemble des essais traitant du nom qui, dès son apparition, nous marque de l’empreinte de la mort. L’auteure aborde plus particulièrement cette symbolique de l’acte de la dénomination dans la tradition juive et kabbalistique, mais aussi chez des philosophes modernes comme Levinas, Benjamin ou Derrida.
Cette édition française du Silence du nom incorpore trois essais qui inaugurent un autre moment de la réflexion d’Esther Cohen : « Le Territoire de la parole écrite », « Le labyrinthe » et « La sexualité dans la kabbale », réunis dans La parole sans fin. Essais sur la kabbale, publié en 1991. Dans ce livre, Esther Cohen s’intéresse au rôle du Texte par rapport à la culture mystique juive ; le nom y apparaît déjà clairement comme objet d’étude. Elle s’attache principalement au destin du Livre à partir de la destruction du Second Temple en 70 après J.-C., et à la manière dont l’absence de territoire a fait du Livre une terre, une patrie et une identité. L’auteure fait en outre ressortir un caractère érotique inhabituel dans la tradition juive. La kabbale nous est dévoilée comme un monde exceptionnel où la Torah est la fiancée qu’il faudra posséder, non point par la force, la violence, mais au contraire par la caresse, la parole d’amour, le désir et la volupté. Tandis que lecture et l’interprétation impliquent le corps et la sexualité, le Livre devient un territoire féminin à explorer.
Esther Cohen est diplômée en philologie et littérature anglaises et docteure en philosophie. Elle a en outre suivi un cursus de sémiotique à l’université de Bologne et des séminaires d’études cabalistiques à Jérusalem et à New York. Elle enseigne la critique littéraire à l’UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México). Elle est également éditrice et traductrice. L’un de ses livres les plus récents a été publié en français : Le corps du diable. Philosophes et sorcières à la Renaissance (Léo Scheer, 2004).
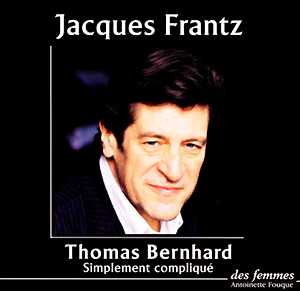 Simplement compliqué
Simplement compliqué
 Trois portraits, trois femmes exceptionnelles : trois vies marquées par l’expérience mystique. Jeanne Guyon, directrice spirituelle de Fénelon, enfermée à la Bastille sur ordre de Louis XIV pour avoir voulu enseigner la mystique aux plus humbles. Simone Weil, morte à Londres en 1943 de désespoir de ne pouvoir retourner se battre en France. Etty Hillesum, déportée à Auschwitz où elle mourut en 1943.
Trois portraits, trois femmes exceptionnelles : trois vies marquées par l’expérience mystique. Jeanne Guyon, directrice spirituelle de Fénelon, enfermée à la Bastille sur ordre de Louis XIV pour avoir voulu enseigner la mystique aux plus humbles. Simone Weil, morte à Londres en 1943 de désespoir de ne pouvoir retourner se battre en France. Etty Hillesum, déportée à Auschwitz où elle mourut en 1943.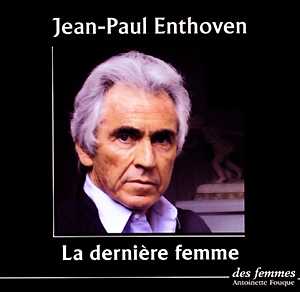 Neuf femmes (neuf muses ?) font l’objet d’un portrait dans la galerie privée, intime, de Jean-Paul Enthoven. Huit femmes célèbres qu’il a bien, peu ou pas du tout connues, mais qui n’ont cessé de l’accompagner pendant sa vie. Et une rencontre amoureuse, relation intime qui vient clore une série de mythes au féminin.
Neuf femmes (neuf muses ?) font l’objet d’un portrait dans la galerie privée, intime, de Jean-Paul Enthoven. Huit femmes célèbres qu’il a bien, peu ou pas du tout connues, mais qui n’ont cessé de l’accompagner pendant sa vie. Et une rencontre amoureuse, relation intime qui vient clore une série de mythes au féminin. « Femmes, race et classe »
« Femmes, race et classe »
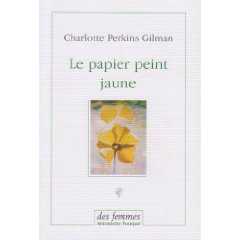 Le papier peint jaune
Le papier peint jaune