Le Bulletin Quotidien continue à recommander la lecture des livres de Pierre Ménat
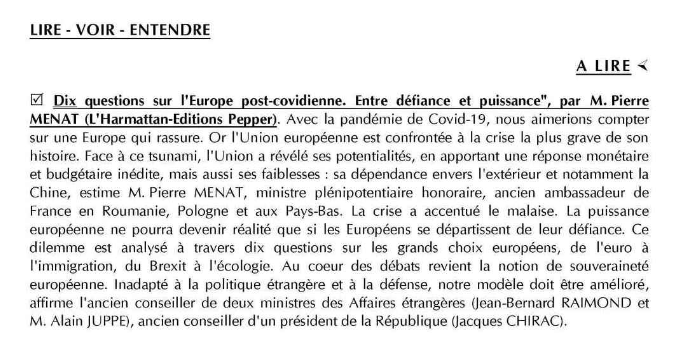
Guilaine Depis, attachée de presse (Balustrade)
Rampe de lancement ! Appuyez-vous sur la balustrade !
Le Bulletin Quotidien continue à recommander la lecture des livres de Pierre Ménat
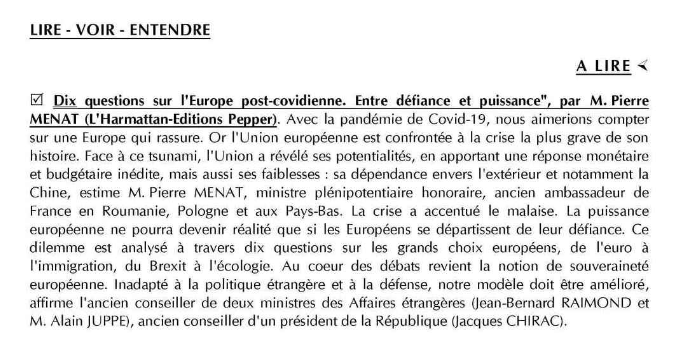
 Un nouveau traité européen, pourquoi pas ?
Un nouveau traité européen, pourquoi pas ?Entre les éructations d’Erdogan et la crainte d’un reconfinement, y a-t-il encore de la place pour la réflexion européenne ? C’est parce que nous le croyons que le livre de Pierre Ménat Dix Questions sur l’Europepost-covidienne (L’Harmattan, 97 pages) mérite d’être lu. Cet ancien conseiller aux affaires européennes du président Chirac pose 10 questions « entre défiance et puissance » (tel est le sous-titre) au moment où tous se demandent si l’Europe est capable tout à la fois de protéger les Européens, de bâtir des stratégies industrielles, de défendre une monnaie forte face au dollar, de contrer le retour des grands empires ou s’il ne vaudrait pas mieux revenir au « chacun chez soi »…
Pierre Ménat propose, in fine, un nouveau traité. On entend déjà les sceptiques s’indigner d’un nouveau transfert de souveraineté. La source d’inspiration de ce diplomate retraité est puisée dans l’œuvre inachevée d’un grand homme : le général de Gaulle, promoteur d’un plan Fouchet mort-né. On ne fera pas de l’Europe une puissance respectée et respectable sans se choisir des partenaires fiables et susceptibles d’affirmer une position dans le monde.
Revenons donc à la source : le général de Gaulle distinguait nettement le marché commun de la souveraineté en matière de défense et de politique étrangère. Il jugeait du reste la seconde plus impérieuse que le premier. Le plan Fouchet a été rejeté au début des années 1960, car, comme le rappelle Pierre Ménat, les Belges et les Néerlandais ne le trouvaient pas assez atlantiste et souhaitaient y inclure le Royaume-Uni. Ils redoutaient l’hégémonie de la France, surtout entre les mains du général…
Or, Pierre Ménat fait l’inventaire des obstacles révolus : le Royaume-Uni est entré, puis sorti de l’Union ; les États-Unis se désengagent ou le prétendent de la sécurité européenne ; le Conseil européen des chefs d’État et de gouvernement, créé dans les années 1970, a pris un essor considérable, conformément à ce que souhaitait de Gaulle… L’auteur y voit donc une opportunité : « Rassembler, écrit-il, ceux des États européens qui auraient la volonté de s’engager dans une Union étroite mais respectueuse des identités nationales. Mettre sur pied un Conseil de sécurité européen, indépendant des institutions de l’UE, qui traiterait des affaires étrangères et de la défense, mais qui pourrait élargir son action à d’autres domaines non couverts, ou insuffisamment, par les traités actuels, comme la santé, la culture ou la recherche. Bien entendu, un lien s’établirait entre cette Union politique et l’Union européenne. »
D’abord, on notera que la Commission et le Parlement n’en sont pas. Les institutions de l’UE ont été édifiées un peu au petit bonheur la chance des ouvertures politiques en ratant plusieurs fois le coche de l’approfondissement au moment des élargissements successifs. On se retrouve au bout du compte avec un ensemble qui poursuit plusieurs logiques sans jamais les rattraper : un bout de fédéralisme par-ci, un morceau de confédération par-là, une couche d’organisation internationale qui n’accueillerait pas seulement ses membres à part entière mais en associerait d’autres (Suisse, Norvège…) selon les compétences, les terrains de jeu… L’architecte de l’Europe n’existe pas. Ou plutôt, ils sont plusieurs, ont vécu à plusieurs époques, sous l’influence de divers courants. Imaginons une cathédrale commencée au XIe siècle, poursuivit dans le style Bauhaus, retouchée par Le Corbusier et dont l’emballage final aurait été confié à Christo et vous aurez une image assez exacte du monument européen. Pierre Ménat sollicite donc un dernier coup de main : celui du général de Gaulle pour achever l’Europe politique. Il faudrait aussi décider du sort de l’Otan, dont la Turquie est membre, ce qui laisse songeur… Là, l’auteur ne tranche pas.
Il existe bien cependant un « haut représentant pour les Affaires extérieures » au sein de l’UE. Il a même statut de vice-président de la Commission et jouit d’une administration volumineuse. Depuis que l’Espagnol Josep Borrell occupe le poste avec l’instauration de la Commission von der Leyen, le Catalan ne manie pas la langue de bois, mais, pour son plus grand malheur, il ne dispose que d’une épée… de bois. Ses analyses sont fameuses, mais ses moyens d’action inexistants. Appeler à des cessez-le-feu sans être en mesure de faire peser la moindre menace sur les belligérants est un exercice déprimant dont Josep Borrell s’acquitte non sans une certaine abnégation. Quand il ne dit rien, on enrage de l’impuissance de l’Europe. Quand il parle, on se moque de son impuissance à être écouté des puissants.
Pour faire cesser cette comédie, Pierre Ménat propose donc de passer aux choses sérieuses : quelques États européens – et pas les 27 – sautent le pas d’une vraie politique étrangère commune. Ce Conseil de sécurité serait composé idéalement de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, de l’Espagne, de la Pologne et… du Royaume-Uni. Londres, en effet, ne serait pas obligé de réadhérer à l’UE puisque ce traité serait indépendant des institutions. Angela Merkel avait formulé l’idée d’un Conseil de sécurité, mais elle le situait au sein de l’UE avec des membres tournants. Tant que la règle de l’unanimité demeurera, l’UE ne sera jamais à l’abri d’une prise d’otage par l’un des siens pour obtenir gain de cause sur un tout autre sujet. Pour passer cet obstacle, un nouveau traité de défense qui ne regrouperait que les États vraiment motivés.
« On objectera qu’il serait vain de créer une structure supplémentaire alors qu’il en existe déjà tant. Mais face aux immenses enjeux de la souveraineté européenne, qui peut prétendre que les structures actuelles sont adaptées ? Il faut donc essayer, le jeu en vaut la chandelle », conclut l’auteur. Le seul dirigeant capable de porter ce projet est par définition français : en l’occurrence, Emmanuel Macron ou la personne qui lui succédera. Macron reprendra-t-il le flambeau tombé à terre du général de Gaulle ? Et qui trouvera-t-il à Berlin, Londres, Rome, Madrid ou Varsovie pour l’aider dans cette entreprise jadis gâchée… La Conférence sur l’avenir de l’Europe qui doit, en principe (sauf reconfinement général), s’ouvrir avant la fin de cette année et s’étaler jusqu’au printemps 2022 est le lieu pour débattre et trancher cette immense question. Osera-t-on, à la fin, en cas de nouveau traité, quel qu’il soit, faire voter les peuples ? Difficile d’imaginer que l’Europe puisse se passer de cette assise populaire pour se projeter avec force dans les grands défis du siècle. Il faudrait accepter que ceux qui n’en voudront pas s’écartent pour laisser passer les autres.
Dix Questions sur l’Europe post-covidienne, Entre défiance et puissance, de Pierre Ménat, L’Harmattan, éditions Pepper
Émission « Le nouveau monde » le 22 octobre sur Télésud. Au menu: les religions et l’Europe. Vincent Hervouët reçoit Pierre Conesa, auteur de « Avec Dieu, on ne discute pas! » ed. Laffont et Pierre MENAT « 10 Questions sur L’Europe post-covidienne »
Revoir l’émission ici :

Ancien ambassadeur de France en Roumanie, Pologne, Tunisie et Pays-Bas, Pierre Ménat actualise son livre France cherche Europe désespérément après la pandémie de Covid-19. Face au duel global de la Chine et des États-Unis, l’Europe reste coincée entre défiance et puissance. En 10 questions, il rappelle l’origine des interrogations des citoyens et propose quelques solutions.
Tout d’abord, l’anxiété. L’Europe vieillit, sa population ne représentera que 6 % de la population mondiale en 2050. Les ressources naturelles sont limitées, la mondialisation fait concurrence, les idées sont en crise. Les Européens cherchent donc des refuges dans la famille, la religion, la nation. L’expression publique de cette frustration du peuple contre ses élites se radicalise – à l’américaine – ce qui ne risque pas de faire avancer les choses. Il faudrait donc à l’Europe une politique industrielle, des négociations réciproques pour les échanges, une politique monétaire de l’euro pour le rendre égal au dollar. Quant aux défis écologiques, l’Europe prend sa part et ne doit pas se culpabiliser, renvoyant plutôt les excités aux plus grands pollueurs de la planète que sont les Américains les Chinois. En revanche les intellectuels, bien absents, sont appelés à la rescousse pour penser le nouveau monde.
Si les Anglais s’en vont, par souci de commercer librement et surtout de s’aligner sur les États-Unis, l’essentiel de leur commerce reste tourné vers les pays européens, tandis que les États-Unis regardent vers le Pacifique. Le plus sage pour les Anglais du Brexit serait de conserver une relation forte dans la défense et les affaires étrangères avec l’Europe.
Le sentiment d’impuissance des citoyens en Europe vient de ce que la souveraineté des états a été déléguée en catimini depuis les années 50. Dans les faits, seulement cinq compétences exclusives ont été déléguées par les Etats : l’union douanière, les règles de concurrence, la politique monétaire pour l’euro, la conservation des ressources de la mer commerciale commune. Tout le reste est partagé ou en appui, notamment la santé :« l’Union n’a pas de compétence en la matière » p.9. Mais il existe un déficit d’information aux citoyens. Un rapport de 2005 en France remis à Dominique de Villepin est resté lettre morte. Or il existe une citoyenneté européenne selon l’article 9 du traité : elle permet de voter aux élections locales et un droit d’initiative populaire au niveau européen. Qui le sait ? Qui l’utilise ?
L’ultralibéralisme est une idéologie française qui distord la revendication historique libérale qui a conduit à l’indépendance américaine et à la révolution française. La défense de la dépense sociale française, qui représente plus que les dépenses de l’État, est un intérêt particulier dans toute l’Europe. Le retour de l’Etat dû au Covid ne devrait pas durer au-delà de la pandémie. Le droit et les institutions l’emportent même si l’Europe à 27 est partagée entre le Nord plus ouvert au large et le Sud plus étatiste parce que plus clientéliste. La France se situe en pays intermédiaire : ses citoyens manifestent surtout un conservatisme anti-industriel et radicalisent l’écologie pour « répondre à la rage ambiante ».
Reste une ambiguïté entre l’Europe à 27 et la zone euro à 19. La politique monétaire devrait faire partie de l’Europe, ou du moins les pays réunis autour de l’euro devraient avoir une représentation qui ne soit pas confondue avec celle des 27. Avec le Covid, les critères de Maastricht sont suspendus et la Commission pourra directement recourir à l’emprunt pour 900 milliards d’euros, deux fois le budget communautaire, même si l’interdiction de financer directement les Etats demeure. Manque cependant une gouvernance politique des crises, criante durant la débâcle financière de 2008, la crise grecque, et la pandémie Covid.
Un point sensible, laissé de côté par la pandémie, reste l’immigration. Elle représente 500 000 à 1 million de personnes par an dans toute l’Europe. C’est une compétence partagée de l’Union où Schengen fonctionne mais pas Dublin. Les solutions existent et ne sont pas mises en œuvre, par exemple le demandeur d’asile n’a pas à choisir son pays d’accueil. Il faudrait augmenter les moyens de Frontex et négocier des accords supplémentaires avec les pays limitrophes. On ne peut laisser non plus la charge de premier accueil aux Etats du sud tel que la Grèce ou l’Italie.
Au total, que signifie la souveraineté européenne ? Après le Covid, nous nous apercevons que la Chine est devenue une puissance mondiale d’influence, tandis que les États-Unis imposent leurs lois nationales et leurs GAFAM aspirateurs de données tout en se dégageant de l’OTAN. La souveraineté européenne est donc toute relative puisque nous dépendons des autres pour beaucoup de nos industries, de nos matières premières et de notre santé. À quelle fin récupérer cette souveraineté ? Dans le domaine monétaire, économique et politique : il nous faut encourager la recherche, développer le numérique, élaborer une véritable autonomie stratégique dont la pandémie a montré la carence, une politique industrielle, une sur les flux migratoires et développer une force d’intervention autonome. « Je propose que soit élaboré un traité d’union politique sur le modèle du plan Fouchet » p.95. Ce serait un projet collectif pour une diplomatie européenne.
Au total, ce petit livre fait le point sur l’Europe aujourd’hui du point de vue politique, un sujet important pour les Français et que la pandémie met en lumière de façon très crue.
Pierre Ménat, Dix questions sur l’Europe post-covidienne – Entre défiance et puissance, septembre 2020, L’Harmattan/éditions Pepper, 99 pages, €12.00
Pierre Ménat, France cherche Europe désespérément, février 2019, L’Harmattan/éditions Pepper, collection Témoignages dirigée par Sonny Perseil, 319 pages, 29€
Pierre Ménat est aussi l’auteur d’un roman chroniqué sur ce blog
Attachée de presse Guilaine Depis, 06 84 36 31 85 guilaine_depis@yahoo.com
L’Europe vue par ce blog
 Dans un monde inquiétant, l’Europe en proie au doute
Dans un monde inquiétant, l’Europe en proie au doute Pierre Ménat : «Dix questions sur l’Europe post-covidienne: Entre défiance et puissance»
Pierre Ménat : «Dix questions sur l’Europe post-covidienne: Entre défiance et puissance» Nous ne soulignerons jamais assez l’importance des ouvrages sur l’Europe, surtout lorsqu’ils ont le mérite de la rigueur, du regard objectif et de l’esprit d’ouverture. C’est le cas du nouveau livre de Pierre Ménat, diplomate, ancien conseiller pour les affaires européennes et ambassadeur de France, Dix questions sur l’Europe post-covidienne: Entre défiance et puissance, où ceux qui s’intéressent à ces questions auront l’occasion de profiter des bénéfices d’une analyse minutieuse de dix aspects du mécanisme de fonctionnement de l’Union européenne, surtout en cette période de crise où la Covid semble avoir tout mis devant une évidente et inédite urgence. Il s’agit, comme ce fut le cas de son précédent livre, France cherche Europe désespérément (2019), « de repenser le débat européen », dans un climat « impensable quelques mois auparavant ». Sont abordés – tels qu’annoncés dans l’Avant-propos – des aspects concernant le rôle de l’Europe dans le monde, les effets du Brexit, la question de la dévolution à l’Union de parts de souveraineté, du dogme libéral et de la reprise économique, de la protection des frontières externes, de la souveraineté européenne et, enfin, du modèle institutionnel idéal.
Nous ne soulignerons jamais assez l’importance des ouvrages sur l’Europe, surtout lorsqu’ils ont le mérite de la rigueur, du regard objectif et de l’esprit d’ouverture. C’est le cas du nouveau livre de Pierre Ménat, diplomate, ancien conseiller pour les affaires européennes et ambassadeur de France, Dix questions sur l’Europe post-covidienne: Entre défiance et puissance, où ceux qui s’intéressent à ces questions auront l’occasion de profiter des bénéfices d’une analyse minutieuse de dix aspects du mécanisme de fonctionnement de l’Union européenne, surtout en cette période de crise où la Covid semble avoir tout mis devant une évidente et inédite urgence. Il s’agit, comme ce fut le cas de son précédent livre, France cherche Europe désespérément (2019), « de repenser le débat européen », dans un climat « impensable quelques mois auparavant ». Sont abordés – tels qu’annoncés dans l’Avant-propos – des aspects concernant le rôle de l’Europe dans le monde, les effets du Brexit, la question de la dévolution à l’Union de parts de souveraineté, du dogme libéral et de la reprise économique, de la protection des frontières externes, de la souveraineté européenne et, enfin, du modèle institutionnel idéal.
Ce sommaire ambitieux trouvera peut-être la réprobation et le réquisitoire faits à la fois par des eurosceptiques et euro-indifférents qui ont toujours dénoncé l’excès de telles entreprises qu’ils considèrent avec indulgence, sinon avec une certaine arrogance. « Encore un livre sur l’Europe », s’exclament-ils à chaque parution, d’un ton rappelant le fameux « in aqua scribere » des Antiques.
Il revient à la critique objective de défendre la démarche de Pierre Ménat en redisant d’abord son premier souci d’analyse politique et institutionnelle fidèle aux documents et à l’objectivité du regard historique face à l’engrenage décisionnel et à la facilité avec laquelle des responsables nationaux sont « prompts à montrer Bruxelles du doigt dès qu’on problème se pose ». Il ne s’agit sans doute pas d’un regard de sycophante de la part de quelqu’un qui connait de l’intérieur de fonctionnement de l’Europe. Il suffit de se pencher sur un ou l’autre des sujets abordés, que ce soit sur l’analyse pertinente du Brexit, sur la souveraineté et sa ramification sociale de la solidarité dans des temps de crise comme c’est le cas de celui que nous vivions actuellement ou sur la doctrine libérale qui est, selon de nombreux citoyens européens le talon d’Achille de l’UE. Sur ce thème de la souveraineté, Pierre Ménat rappelle que l’Union Européenne assure ces fonctions de souveraineté « dans la stricte limite de ses compétences ». « Les attributions de l’Union – écrit-il – sont par exemple exclusives pour la monnaie, la concurrence ou l’Union douanière, partagées pour le marché intérieur ou l’immigration, inexistantes pour la diplomatie, la santé ou la défense ». De quoi répondre, selon nous, à des commentaires trop fréquents ces derniers temps sur le manque de solidarité devant la crise de la Covid. Même les grands journaux et les media ont fait semblant d’ignorer cette évidence, alors qu’il ne s’agit que d’une vérité que la réalité tient à nous renvoyer dans les cordes de nos limites de pensée.
 Sans doute, chacun de ces sujets mérite de s’y arrêter longuement, tellement leur complexité et leur importance sont grandes. Le lecteur retrouvera des réponses à ces questionnements.
Sans doute, chacun de ces sujets mérite de s’y arrêter longuement, tellement leur complexité et leur importance sont grandes. Le lecteur retrouvera des réponses à ces questionnements.
Disons juste en guise de conclusion que ce livre de Pierre Ménat a, par-dessus des mérites déjà cités, celui de sortir des sentiers battus, s’élevant avec autorité au-dessus des clichés, sans pour autant tomber dans l’académisme.
Dix questions sur l’Europe post-covidienne: Entre défiance et puissance se construit sur le schéma de cette dichotomie largement argumentée qui alimente les deux poumons de notre perception de l’Europe et du quotidien. Au fond, un livre sur nous-mêmes, sur qui sommes-nous mais surtout sur ce que nous semblons ignorer de l’être.
Pierre Ménat, Dix questions sur l’Europe post-covidienne: Entre défiance et puissance, Éditions Pepper, 2020, 104 pages.
Pour plus d’informations sur Pierre Ménat : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_M%C3%A9nat
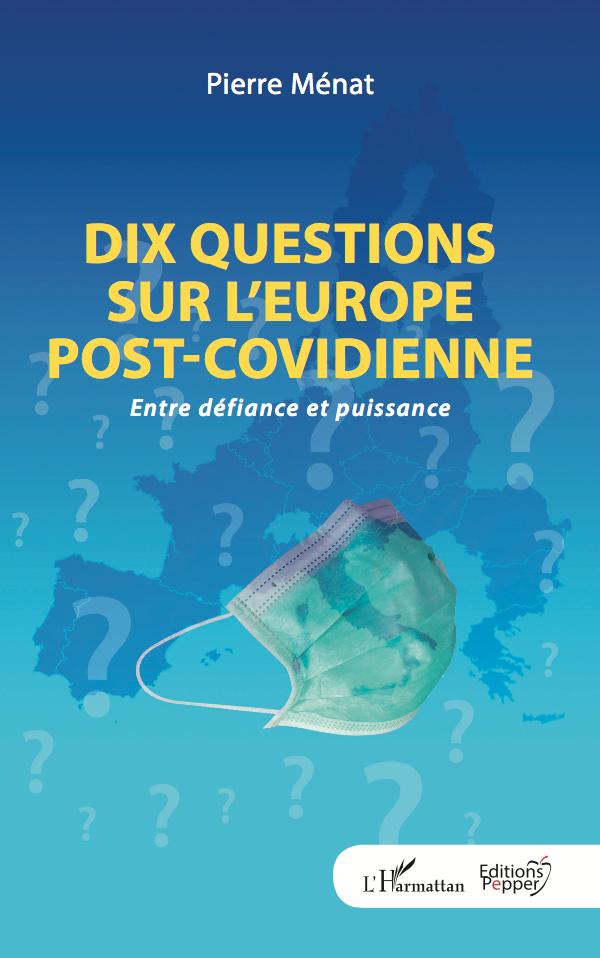 « Dix questions sur l’Europe post-covidienne » Entre défiance et puissance de Pierre Ménat
« Dix questions sur l’Europe post-covidienne » Entre défiance et puissance de Pierre Ménat
Parution fin septembre 2020 – L’Harmatten Editions Pepper – 12,50 €
Contact presse pour le recevoir / interviewer l’auteur :
guilaine_depis@yahoo.com 06 84 36 31 85
Avec la pandémie du Covid 19, l’anxiété du monde s’est encore accrue. Nous aimerions compter sur une Europe qui rassure. Or l’Union européenne est confrontée à la crise la plus grave de son histoire.
Face à ce tsunami, l’Union a révélé ses potentialités, en apportant une réponse monétaire et budgétaire inédite, mais aussi ses faiblesses : la dépendance du continent envers l’extérieur et notamment la Chine fut cruellement soulignée. La crise a accentué un malaise déjà installé.
La nécessaire puisse,ce européenne ne pourra devenir réalité que si les Européens se départissent de leur défiance, qui reste forte envers l’Union.
C’est ce dilemme que ce livre analyse à travers dix questions sur les grands choix européens, de l’euro à l’immigration, des suites du Brexit à l’écologie. Au coeur de tous les débats revient la notion de souveraineté européenne, prérogative exercée à la fois par les Etats, qui en sont les principaux détenteurs, et par l’Union européenne, qui en est attributaire déléguée.
Le modèle institutionnel actuel peut fonctionner, sous réserve d’être amélioré, pour l’économie et la monnaie. Mais ce modèle est inadapté à la politique étrangère et à La Défense, domaines pour lesquels le plan Fauchet présenté par le Général de Gaulle en 1961 pourrait être repris.
Un livre essentiel pour comprendre les choix à faire pour que l’Europe donne enfin la mesure de ses potentialités.
Après France cherche Europe désespérément, Pierre Ménat actualise ici sa réflexion avec le Brexit et à l’heure du Covid. L’auteur, qui a été ambassadeur de France en Roumanie, en Pologne, en Tunisie et aux Pays-Bas, est ancien directeur Europe du Ministère des Affaires étrangères.
Quatrième de couverture : Avec la pandémie de Covid 19, l’anxiété du monde s’est encore accrue. Nous aimerions compter sur une Europe qui rassure. Or l’Union européenne est confrontée à la crise la plus grave de son histoire. Face à ce tsunami, l’Union a révélé ses potentialités, en apportant une réponse monétaire et budgétaire inédites, mais aussi ses faiblesses : la dépendance du continent envers l’extérieur et notamment la Chine, fut cruellement soulignée. La crise a accentué un malaise déjà installé. La nécessaire puissance européenne ne pourra devenir réalité que si les Européens se départissent de leur défiance, qui reste forte envers l’Union.
C’est ce dilemme que ce livre analyse à travers dix questions sur les grands choix européens, de l’euro à l’immigration, des suites du Brexit à l’écologie. Au cœur de tous les débats revient la notion de souveraineté européenne, prérogative exercée à la fois par les Etats, qui en sont les principaux détenteurs, et par l’Union européenne, qui en est attributaire déléguée.
Le modèle institutionnel actuel peut fonctionner, sous réserve d’être amélioré, pour l’économie et la monnaie. Mais ce modèle est inadapté à la politique étrangère et à la défense, domaines pour lesquels le plan Fouchet présenté par le Général de Gaulle en 1961 pourrait être repris.
 Après France cherche Europe désespérément, Pierre Ménat actualise ici sa réflexion avec le Brexit et à l’heure du Covid. L’auteur, qui a été ambassadeur de France en Roumanie, en Pologne, en Tunisie et aux Pays-Bas, est ancien directeur Europe du ministère des Affaires étrangères.
Après France cherche Europe désespérément, Pierre Ménat actualise ici sa réflexion avec le Brexit et à l’heure du Covid. L’auteur, qui a été ambassadeur de France en Roumanie, en Pologne, en Tunisie et aux Pays-Bas, est ancien directeur Europe du ministère des Affaires étrangères.
ENTRE DEFIANCE ET PUISSANCE.
Dix questions sur l’Europe post-covidienne
Avant-propos
Chapitre 1 Quel rôle l’Europe peut-elle jouer dans un monde anxiogène ?
Chapitre 2 Le Brexit : pourquoi et comment ?
Chapitre 3 L’Union Européenne limite-t-elle la souveraineté des Etats ?
Chapitre 4 L’UE est-elle ultra-libérale ?
Chapitre 5 L’UE peut-elle relever le défi climatique ?
Chapitre 6 Comment mieux gérer la zone euro ?
Chapitre 7 L’UE est-elle éloignée des citoyens ?
Chapitre 8 L’UE peut-elle avoir une politique migratoire ?
Chapitre 9 Y a-t-il un modèle institutionnel idéal ?
Chapitre 10 Que signifie « la souveraineté européenne » ?
ENTRE DEFIANCE ET PUISSANCE
Dix questions sur l’Europe post-covidienne
Avant-propos
Voici quelques mois était publié mon livre « France cherche Europe désespérément ».
J’y analysais la relation si complexe que notre pays entretient avec l’Union européenne. S’ils admettent la valeur d’une association institutionnalisée entre les Etats du vieux continent, les Français, consciemment ou pas, souhaiteraient que cette nécessaire union s’effectue autour de leur modèle. Et cette espérance, commune à tous les acteurs de la scène politique française, est considérée comme un gallicisme par nos partenaires.
« Encore un livre sur l’Europe. Pourquoi faire ?» écrivais-je au tout début de cet ouvrage. Et voici qu’à nouveau, je prends la plume !
Pourquoi ? Le sujet est inépuisable ; le premier livre était mû par l’ambition d’éclairer les actuelles frustrations par un historique de la construction européenne depuis 1948.
Mais surtout, le Covid 19 a modifié les perspectives. Soudainement, cette pandémie a catalysé une angoisse déjà perceptible. En 2015, Rémi Brague nous alertait sur les dangers du « règne de l’homme », soulignant les risques d’une victoire supposée de l’immanence sur la transcendance. Or, la science est l’argument le plus solide de la raison. Et les progrès de la médecine sont l’un des succès les plus visibles de la science. Déjà la mondialisation, le terrorisme, le changement climatique, l’absence de leadership international, la mutation insidieuse des idéologies, la prise de contrôle de l’information par des réseaux sociaux eux-mêmes incontrôlables, la montée du complotisme suggéraient ou révélaient une forte anxiété. Et voici qu’un simple virus est capable d’enfermer à domicile les deux tiers de l’humanité, de promettre un bouleversement des fondamentaux de l’économie mondialisée : les échanges, les transports, ou simplement la liberté d’aller et de venir. Plus fondamentalement, nous réalisons que notre système de valeurs a placé la sauvegarde de la vie humaine au-dessus de tout, cette vie que nos anciens savait menacée par guerres ou maladies.
Brusquement, nous mesurons, touchons du doigt l’anxiété du monde, lui donnons un nom. Nous réalisons que les progrès médicaux spectaculaires ne sont pas infinis. Bien sûr le COVID est une grave pandémie, mais surtout l’homme n’est plus en mesure d’accepter un tel risque, qu’il croyait révolu. Nous n’étions plus mentalement immunisés contre ce mal, ne pouvions plus tolérer que la vie soit ce qu’elle est, aléatoire, transitoire, interruptible.
Déjà privé de repères, le monde a encore perdu un marqueur. Exposé au terrorisme ou à la pauvreté, il se croyait au moins vacciné contre les épidémies. Une illusion de moins.
Face à ce monde qui inquiète, nous aurions aimé compter sur une Europe qui rassure. Mais l’Union européenne est confrontée en 2020 à la plus grave crise de son histoire. L’épidémie de coronavirus, par ses ravages sanitaires et économiques, a révélé au grand jour les atouts de l’UE mais aussi ses failles.
Cette Union si prompte à interférer dans la vie des Etats a tardé à réagir, puis l’a fait de manière diversement puissante et pertinente.
Cette crise est d’abord la revanche des Etats, dont le général de Gaulle disait qu’ils étaient « la seule entité à même de donner des ordres et d’être obéis ». A l’intérieur des frontières, l’Etat est de retour. Même les plus libéraux reconnaissent, avec bien sûr des nuances selon que l’on soit, par exemple, aux Pays-Bas ou en France, que seule la puissance publique a la capacité matérielle et financière de lutter contre la pandémie et surtout contre ses désastreuses conséquences économiques. Certains crient au scandale : pourquoi l’argent qui n’était pas magique l’est-il devenu ? Réponse : dans la crise, il redevient légitime d’emprunter et seul l’Etat peut le faire dans de telles proportions. Cependant se dessine ici l’ombre portée de l’Europe. La levée des critères de Maastricht, l’ampleur de l’intervention de la Banque centrale européenne, la création d’un nouveau mécanisme d’emprunt-subventions sont des contreparties du recours massif à la dette et ne sont pas acquises à jamais. Nous y reviendrons dans le chapitre consacré à la zone euro.
Et dans l’ordre international, l’Etat retrouve sa pertinence et sa souveraineté mises à mal par la mondialisation ou l’Union européenne. C’est dans le cadre étatique que sont définies les frontières, que sont mesurés les ravages de la pandémie, que sont comparées les capacités de chacun à y faire face, quitte à ce que ces jugements soient nuancés en fonction de l’organisation interne, fédérale ou non, de chaque Etat.
Alors qu’en est-il de la souveraineté européenne, dont on nous parle si souvent ?
Nous nous attacherons plus loin à essayer de cerner cette notion si complexe, qui associe en fait deux parts inégales de souveraineté, celle des Etats européens qui est la règle et celle de l’Union qui demeure l’exception. Et cette exception dépend bien sûr des domaines de compétences dévolus à l’Union.
La monnaie d’abord. Est censée être souveraine la Banque centrale européenne (BCE). Elle seule a le pouvoir de création monétaire dans la zone euro. Depuis l’arrivée à sa direction de Mario Draghi en 2012, la BCE s’est lancée dans une politique dite non conventionnelle, par le rachat d’obligations publiques sur les marchés secondaires, c’est-à-dire aux banques et autres détenteurs de telles obligations et, à partir de 2015, par l’assouplissement quantitatif. Poursuivie par Christine Lagarde, cette politique a été renforcée par un programme de 750 milliards d’euros destiné à faire face à la crise née du Covid. Et pourtant, même dans ce domaine de compétence exclusive, l’autonomie de la BCE vient d’être menacée par la décision en date du 5 mai 2020 de la Cour Constitutionnelle allemande de Karlsruhe. Cette juridiction suprême allemande ne peut certes donner d’injonction à la BCE, mais exige des autorités allemandes qu’elles demandent des comptes à la banque de Francfort, sous peine de se voir interdire de participer aux programmes de la BCE.
Souveraineté économique ? Elle ne coule pas de source si l’on considère les divergences entre Etats pour mettre en place un plan de relance, quant à son volume, mais aussi à sa forme, que l’on parle de subventions, de prêts ou de garanties. La crise aura permis de muscler l’outil budgétaire européen, mais au service de quelle ambition ?
Souveraineté politique ? Celle-ci supposerait que deux conditions soient remplies : la responsabilité et la solidarité. Or, l’Union n’a pas compétence en matière de santé publique. Et la solidarité s’est surtout manifestée dans les coopérations bilatérales. L’Union n’a que peu contribué au volet sanitaire de la crise. Elle n’a été réactive ni dans la coordination de la réponse des Etats-membres, ni dans la gestion de la capacité hospitalière globale, ni dans le domaine de la recherche de traitements et d’un vaccin.
Que signifie la souveraineté européenne ? Tel est le titre du dernier chapitre du présent livre. Et chacun voit bien que l’importance de la question comme les termes de la réponse sont affectés par le Covid.
Pour autant, il faut partir de ce qui existait. Il y a plus d’un an, en mai 2019, cela paraît loin, les citoyens de l’Union ont élu le nouveau Parlement européen (PE). Nous avions assisté à une campagne donnant lieu aux débats habituels sur la souveraineté, les valeurs, l’inadaptation des institutions européennes. Dans la plupart des Etats-membres, à commencer par la France, le clivage désormais habituel entre « européistes » et « eurosceptiques » a fait rage. Les populistes montaient, affirmaient pouvoir être majoritaires.
Le 25 mai 2019 au soir était dévoilé le nouveau visage du Parlement. Il ne prendrait sa forme définitive que le 1er février 2020, après l’entrée en vigueur du Brexit. Finalement, les groupes considérés comme populistes ne gagnaient globalement pas en nombre. La nouveauté était ailleurs. Depuis sa création, le PE était dominé par une « grande coalition » entre la droite (PPE) et la gauche (S et D). Cette majorité pouvait être qualifiée d’institutionnelle : elle ne se formait que pour la désignation du président du PE, des vice-présidents, des présidents de commissions et de l’approbation des nominations proposées par le Conseil européen. Pour le cœur de métier, à savoir les fonctions législative, budgétaire et politique, chacun reprenait sa liberté, y compris au sein des groupes.
Cette majorité n’existe plus. Au sein du PE, le PPE compte 187 députés, trente de moins que dans la précédente assemblée. L’hémorragie est encore plus forte chez les socialistes, passés de 187 sièges à 148. Qui a gagné ? D’abord, le groupe centriste ALDE, renommé Renew Europe, qui conquiert une trentaine de sièges (97 contre 68), fort de l’arrivée de 23 parlementaires macronistes. Ensuite, le groupe Identité et démocratie, classé le plus à droite, fondé par Marine Le Pen en 2015, progresse de 35 à 76 membres ; mais cette hausse est compensée par la régression des « conservateurs et réformistes », dont le groupe, amputé des conservateurs britanniques et désormais dominé par le PIS polonais, perd une dizaine de sièges. Les Verts gagnent une dizaine de sièges ; la gauche radicale en perd 11.
Donc les partis classés comme européistes (droite, gauche, centre, verts) totalisent 500 sièges, soit 70 % du PE. Mais PPE et S et D sont à 30 sièges de la majorité absolue. Pour élire la présidente de la Commission européenne, il a fallu l’appoint de Renew Europe.
Qu’a fait ce Parlement une fois élu ? Il a « montré les muscles » envers certains Etats-membres. Au sein du Conseil européen, la France avait mené une bataille contre le système des « spitzenkandidaten ». Selon le PE, le président de la Commission devait être choisi parmi ces têtes de listes. Et puisque le PPE était arrivé en tête, son candidat, président de son groupe parlementaire, Manfred Weber, était fléché pour prendre la tête de l’exécutif européen. Le président Macron s’est insurgé à juste titre contre ce mécanisme contraire au traité. Ce fut une autre personnalité allemande, Ursula Von Der Leyen, qui fut élue – de justesse – comme présidente de la Commission. En réponse, une humiliation fut infligée à la France : Sylvie Goulard, désignée comme commissaire française, fut largement battue en commission des investitures et dut laisser sa place à Thierry Breton. La Commission ne prit ses fonctions que le 1erdécembre 2019.
Le Conseil européen consacra des semaines à la nomination des principaux hauts responsables de l’Union. La recherche d’un équilibre entre les Etats, les mouvances politiques et les genres domine ce type d’exercices, plutôt que le choix de fortes personnalités particulièrement compétentes dans leurs domaines respectifs d’activité. Cependant, les deux critères sont remplis pour Christine Lagarde, nouvelle présidente de la Banque centrale européenne. Quant au président du Conseil Européen, Charles Michel (Belgique), il est, contrairement à son prédécesseur Donald Tusk, citoyen d’un Etat-membre de la zone euro, dont il présidera les sommets. Josep Borrell (Espagne), nouveau haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, est un ancien président du Parlement européen. Mais disposeront-ils de la capacité d’initiative et de la marge de manœuvre leur permettant de peser sur le cours des affaires ?
Ces institutions renouvelées faisaient face à un lourd agenda : adoption du cadre financier pluriannuel, c’est-à-dire du budget européen 2021-2027 ; discussion du « green deal » proposé par la nouvelle Commission ; négociations sur les futures relations avec le Royaume-Uni après la période de transition qui doit s’achever fin 2020 ; lancement d’une conférence sur l’avenir de l’Europe voulue par le Parlement européen et soutenue par Mme Von der Leyen.
Et puis vint le COVID-19. Ce virus qui a bouleversé la vie du monde a constitué un puissant révélateur des tensions contradictoires auxquelles est soumise l’Union européenne. Nous l’avons évoqué et y reviendrons tant l’agenda futur de l’Union en sera affecté.
Au-delà de ces échéances importantes, il ne faut pas perdre de vue les deux défis majeurs, qui viennent de se présenter sous un jour encore plus net : la confiance et la puissance.
Il existe une crise de confiance entre l’Europe et ses peuples. Son symptôme le plus net : un grand Etat-membre, le Royaume-Uni, vient de quitter l’Union. Certes peut-on se demander s’il y était vraiment entré. N’oublions pas non plus que 48 % des Britanniques ont voté pour le maintien. Mais le Brexit est un séisme dont l’ampleur est encore mal appréciée, dont les répliques toucheront aussi bien les Britanniques que les autres Européens. Nous reviendrons sur les épisodes passés et futurs de cette saga. Mais soyons certains qu’après le Brexit, l’Europe ne pourra plus être pensée de la même manière.
La défiance existe aussi parmi les peuples du continent. Dans « France cherche Europe désespérément », je me suis longuement penché sur le cas de notre pays. Le ressentiment envers l’Union y est fort, notamment depuis la rupture qu’a consacrée le referendum négatif du 29 mai 2005 et qu’a aggravée la ratification par voie parlementaire du traité de Lisbonne, qui reprenait l’essentiel de la constitution européenne. De plus, la question européenne, qui suscitait des débats dépassant souvent le clivage gauche-droite, voire majorité-opposition, est aujourd’hui au cœur du duel entre « progressistes » et « patriotes ». Cette situation se prête aux caricatures, à des présentations trop optimistes pour les premiers, destructrices pour les seconds. Dans ce contexte, les résultats de l’élection européenne de 2019 ont pu rassurer les défenseurs de l’UE : hausse de 8% de la participation, scores élevés mais contenus des eurosceptiques. Pour autant, un excès de confiance serait malvenu.
En France comme ailleurs, par commodité sans doute, les commentateurs ont un peu trop tiré sur l’accessible ficelle du populisme pour expliquer la contestation de l’Union européenne. Et dans leur lancée, ils sont conduits à coller l’étiquette populiste à des mouvements d’inspiration diverse et parfois contradictoire. Il n’y a rien de commun entre les ultraconservateurs du PIS polonais, le fantasque ligueur Salvini et le PVV néerlandais, sans parler de l’extrême-gauche. Les Etats d’Europe centrale, qui avaient passé quarante-cinq années sous le régime de la souveraineté limitée par Moscou, se montrent peu enclins à abandonner leurs compétences à Bruxelles. Le populisme italien tient à la résurgence d’un césarisme considéré comme le mieux à même de juguler la vague migratoire. Aux Pays-Bas, l’ultra-droite est ultra-libérale, prompte à condamner les cigales du Club Med et anti-islamique. Tous reflètent, il est vrai, la méfiance envers une Union jugée soit intrusive, soit incapable, tantôt trop dépensière, tantôt pas assez généreuse. « Union européenne » est devenue une formule magique qui désigne tout ce qui ne va pas : même la réforme des retraites en France serait due, selon certains propos, à une imaginaire exigence de Bruxelles. Le déficit de confiance sera difficile à combler.
En réalité, entre européistes et eurosceptiques, il y a la masse des « euro-indifférents ». Ceux-ci n’adhèrent pas particulièrement à des mots d’ordre comme le Frexit ou la sortie de la zone euro mais perçoivent les institutions européennes au mieux comme éloignées de leurs préoccupations, au pire comme aggravant leurs problèmes. Cette majorité silencieuse est sensible à la petite musique populiste, alors qu’elle est peu attirée par les messages optimistes.
L’autre grand défi est celui de la puissance. Souverainistes et Européistes peuvent se retrouver autour d’un constat : l’Europe, qui dominait encore le monde au début du XXème siècle, a perdu la main. A partir de là, les analyses divergent. En se fédérant ou se confédérant, les grands Etats européens pourraient-il compenser cet affaiblissement ?
Le sujet est séculaire, puisqu’en 1919, Paul Valéry se demandait si l’Europe deviendrait « un petit cap du continent asiatique » tandis qu’Oswald Spengler dissertait sur le déclin de l’Occident. Car ce fut la première guerre mondiale qui porta un coup fatal au rayonnement européen. Territoires dévastés, populations décimées, empires désagrégés, voilà le tableau du continent, qui serait encore noirci par l’autre guerre. Dans le même temps, de nouvelles puissances montaient en gamme, à commencer par les Etats-Unis d’Amérique.
En 2020, si l’on peine à définir l’Europe-puissance, c’est parce que ce concept résulte d’un raccourci. A l’apogée de sa gloire, notre continent avait pour champions quelques Etats. La France et le Royaume-Uni, en passe d’être rejoints par l’Allemagne, disposaient de toute la panoplie des Grands : l’armée, la diplomatie, l’économie, la monnaie, l’influence mondiale s’appuyant sur leurs empires. Un siècle plus tard, nos Etats ont perdu l’essentiel de ces forces. Soumis pendant quarante-cinq ans à l’ordre de Yalta, qui sanctionnait le condominium Etats-Unis-URSS établi en 1945, les Européens vivent depuis 1989 dans un monde dépourvu de repères. Décrétée en 1989, la « fin de l’histoire » avait pour corollairel’obligation pour les démocraties de se ranger derrière la bannière étoilée. Mais celle-ci a pâli. Les Etats-Unis détiennent encore le statut de première puissance mondiale, étant le seul pays du monde à disposer encore à la fois d’une monnaie hégémonique, d’une puissance de feu inégalée, de ressources énergétiques confortables, de géants à la pointe du développement technologique, d’un ordre juridique protecteur et d’une influence culturelle universelle. Mais leurs erreurs répétées les ont conduits à se concentrer sur la défense de leurs intérêts, au détriment de leur fonction de meneur de jeu.
Dans le même temps, la Russie de Poutine se vengeait des humiliations qui lui avaient été infligées dans les années quatre-vingt-dix. Convertie au capitalisme le plus débridé, la Chine, à son tour, acquérait une capacité économique lui promettant la première place en ce domaine. L’absence de leadership mondial permettait à quelques puissances moyennes, comme l’Iran ou la Turquie, loin des scrupules démocratiques, de songer à étendre leurs zones d’influence respectives.
Au sein du vieux continent, deux Etats, France et Royaume-Uni, conservaient ces atouts de la puissance que constituent l’arme nucléaire et la qualité de membre permanent du Conseil de Sécurité. La supériorité démographique et le dynamisme industriel de l’Allemagne réunifiée la hissaient à la première place en matière économique. L’Union européenne est le premier marché du monde en taille et en prospérité. Mais peut-on la qualifier de puissance ?
Ce terme s’applique encore à certains de ses Etats, mais à condition de l’assortir du qualificatif « moyenne ». Et lorsqu’on parle d’Europe-puissance, cela implique que tous les facteurs concourant à cette qualité soient agglomérés et contribuent à un effet d’échelle.
Voilà la difficulté. L’Union européenne est une structure sui generis, associant certains ingrédients du fédéralisme à des mécanismes de caractère intergouvernemental. La cote a été taillée au fil des années et des changements de traités. Si bien que parmi les attributs de souveraineté, l’un d’entre eux, la monnaie, a été transféré au niveau européen pour les Etats-membres de la zone euro. Les autres fonctions dites régaliennes, la diplomatie, l’armée, la police, la justice, demeurent du ressort des Etats. Mais le jeu a été compliqué depuis le traité de Maastricht, qui, en 1992, a institué un pilier « justice et affaires intérieures ». Il a aussi prévu une « politique étrangère et de sécurité commune » et a dessiné la perspective d’une défense européenne. Ces derniers concepts sont trompeurs : ils désignent des actions que les Etats décident de mener ensemble, un plus petit dénominateur commun qui n’entrave en rien leur autonomie de décision. Aussi la notion de souveraineté européenne, récemment avancée, est-elle complexe, associant des mécanismes de nature fédérative (commerce, monnaie) et d’autres qui relèvent en dernier ressort des Etats.
Le Brexit contribue à brouiller les pistes. Avant le départ du Royaume-Uni, il était déjà difficile de concevoir une diplomatie et une défense dans le cadre de l’UE. C’est désormais impossible, sauf à se priver de l’apport irremplaçable du seul Etat européen qui, avec la France, détient l’ensemble des atouts de la puissance. C’est pourquoi, dans « France cherche Europe désespérément », j’ai suggéré une autre piste, inspirée du plan Fouchet présenté en 1961 par le général de Gaulle.
Confiance à l’intérieur, puissance dans le monde, voilà bien les deux défis européens qui sont au cœur de ces dix questions sur l’Europe post-covidienne.