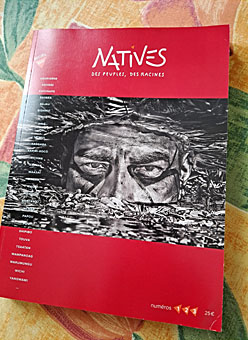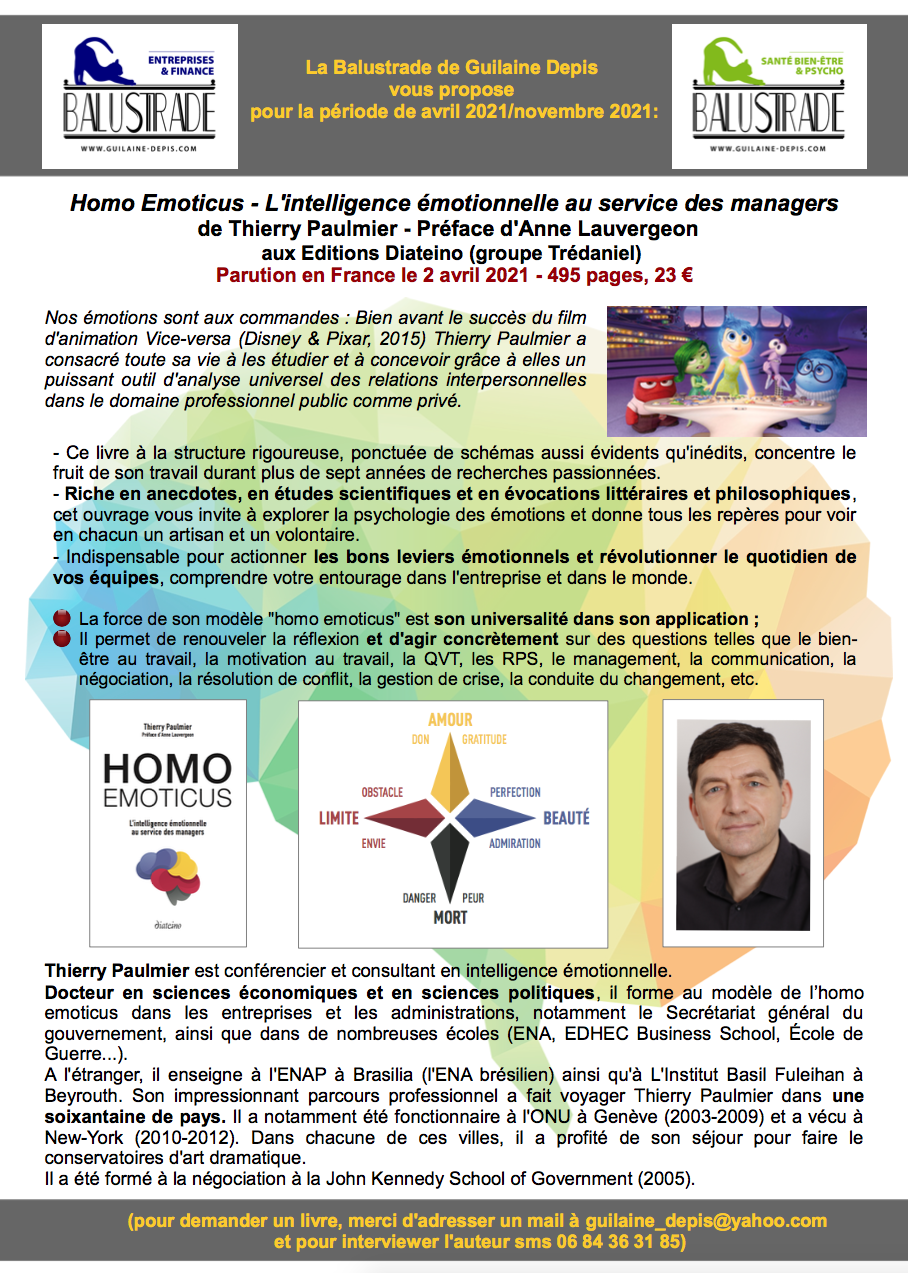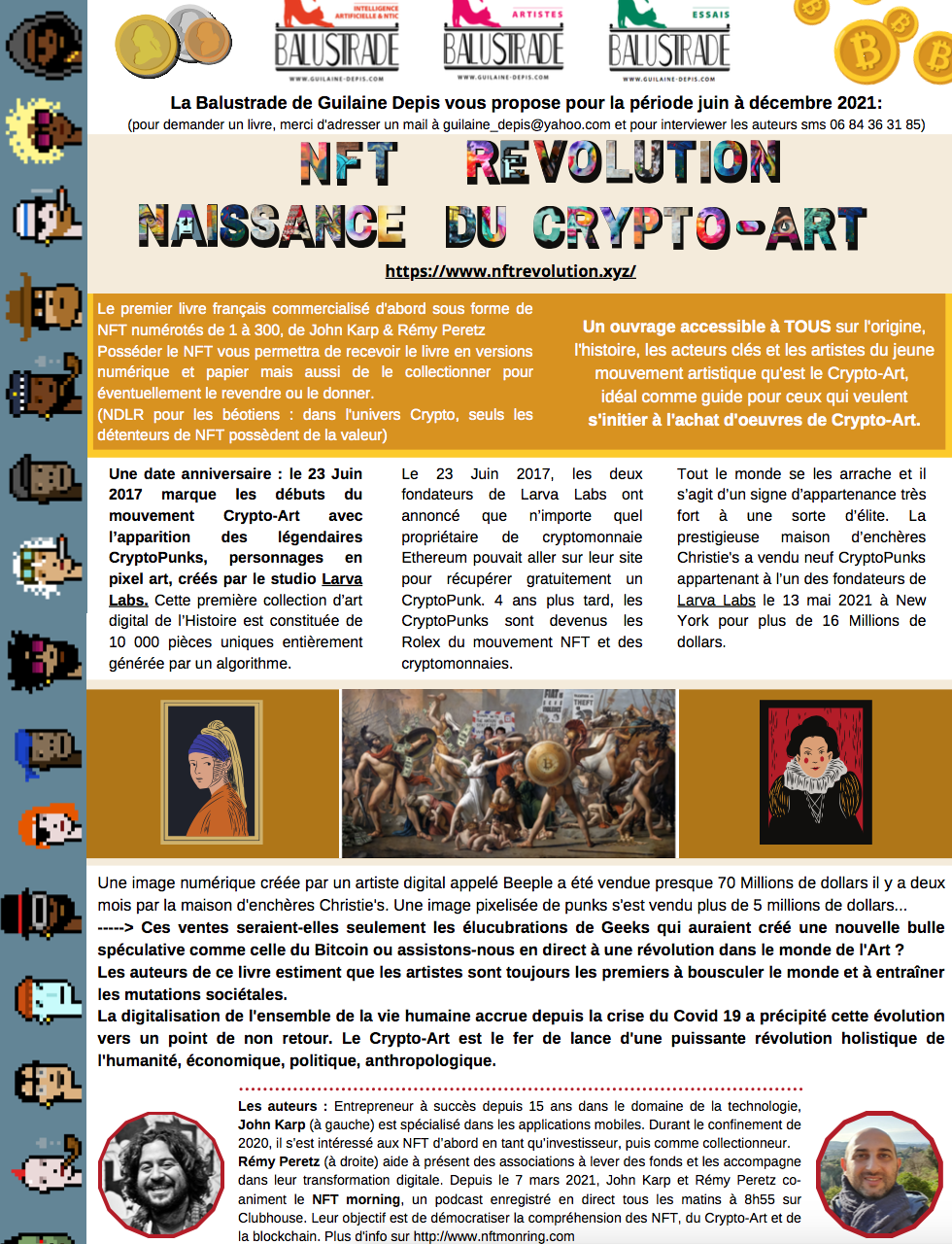Une rencontre avec l’auteur de cet article le 24 juin à Paris.
PMA ? GPA ? euthanasie ? eugénisme ? Le droit de connaître son géniteur ? La solidarité entre les générations ? La prolongation de l’IVG jusqu’au terme de la grossesse ? La Balustrade de Guilaine Depis et Joaquin Scalbert vous invitent à venir débattre autour d’un verre de vin de Bourgogne des questions de bioéthique qui sont au cœur de l’actualité politique immédiate le jeudi 24 juin 2021 de 17h à 21h, à l’Atelier Galerie Taylor 7 rue Taylor, 75 010 Paris. RSVP par SMS 06 84 36 31 85 •
 Les quatre dangers de la loi de bioéthique
Les quatre dangers de la loi de bioéthique
Loin de rejeter en bloc la loi de bioéthique, je m’élève contre un gouvernement qui oublie qu’une loi concerne tous les citoyens sans exception.
La convention internationale des Droits de l’enfant (1989) considère dans son préambule que « l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection appropriée, avant comme après la naissance ». Pourtant, cette loi ne semble pas prendre en compte l’enfant en tant que sujet. Seuls le droit au bonheur et le droit à l’enfant paraissent avoir présidé à l’élaboration de ce texte.
Quatre menaces existent :
La violence
La violence faite aux enfants nés par PMA et par GPA. La GPA est la suite logique de la PMA pour toutes les femmes (célibataires et homosexuelles), car il n’est pas possible d’empêcher longtemps les hommes dans la même situation, de bénéficier de tels droits.
Les donneurs de gamètes ne seront plus anonymes pour la plupart des enfants nés par PMA. Cependant, pour ceux qui sont nés avec des donneurs anonymes et pour ceux à qui on apprendra tardivement leur conception la violence sera toujours présente. Violence d’un secret enfin révélé. Etaient-ils si peu de chose pour que l’on ait omis de les informer et de les laisser ignorants de cette moitié d’eux-mêmes ? C’est une atteinte à leur dignité.
Violence du secret lui-même. Les enfants découvrent que ce constitue une grande part de leur patrimoine génétique et de leur personnalité n’est pas ce qu’ils croyaient. Ils se sentent vides ou amputés selon leur expression. Le succès des recherches généalogiques, l’engouement pour les méthodes de développement personnel prouvent combien nos concitoyens sont à la recherche de ce qui peut les aider à se situer dans leur environnement relationnel. Savoir d’où l’on vient, qui on est, où l’on va. Connaître ses racines, c’est aussi se mettre en lien en correspondance avec une communauté humaine plus large. Le roman familial est un fantasme nécessaire à chaque être humain. N’est-il pas dangereux de laisser les futurs parents d’enfants nés de PMA et GPA libres de toute responsabilité dans ce domaine ?
Le triomphe de l’hédonisme
Il est à l’œuvre dans la société de consommation. La recherche du plaisir immédiat, le désir satisfait à tout prix, l’émotion plutôt que la réflexion ou le narcissisme qui animent dans un sentiment de toute puissance les futurs parents, encouragés par les médias et accompagnés par les moyens techniques que fournit la science médicale, ne sont pas des fondements raisonnables à l’éducation des « bénéficiaires » de la PMA.
Comment allons-nous faire grandir ces enfants dans la conscience d’autrui et de la société ?
L’eugénisme
Tant décrié pour ce qu’il a représenté au XXe siècle… et pourtant parfaitement présent dans les conséquences de ce texte de loi. Il y aura demain des bébés sur catalogue (c’est déjà le cas aux Etats-Unis ou dans certains pays européens). Dans un premier temps, cela sera réservé aux parents les plus fortunés : pourquoi ne pas avoir un bébé de premier choix, quand on peut se le payer ?! Puis, comme pour tous les produits de consommation, cela deviendra accessible à tous.
L’amour des animaux réglemente aujourd’hui la destruction des poussins avant l’éclosion de l’œuf et bientôt avant que leur cœur batte (embryon de quatre jours) mais on n’interdit pas les IMG -interruption médicale de grossesse- jusqu’au 9e mois (n’oublions pas que les premiers battements de cœur de l’embryon humain surviennent dès la sixième semaine).
Les bébés médicaments et les chimères ne rentrent pas encore dans l’arsenal scientifique, mais ces expériences déjà réalisées en Chine et au Japon le seront probablement en France dans l’avenir. Les futurs parents sont-ils conscients de la vie qu’ils veulent donner et de celle qu’ils ont choisi d’ignorer ?
La science et ses limites
Avons-nous toute la connaissance scientifique pour dire que tel type de procréation présente plus ou moins de dangers qu’un autre pour ces futurs embryons ?
La GPA est présentée comme un magnifique acte d’amour (généralement bien rétribué) d’une personne pour des couples ne pouvant pas procréer. Acte sans conséquence sur l’enfant, puisque toutes les gamètes mâles et femelles proviennent de donneurs et donneuses externes. Pourtant, nous en découvrons peu à peu beaucoup sur la vie intra-utérine (sensations, perceptions, émotions, échanges entre le sang fœtal et le sang de la mère porteuse). Nous savons aussi que l’accouchement par césarienne peut interférer avec la composition macrobiotique de l’intestin du nouveau-né et influer sur sa fonction immunologique. Combien de futurs parents sont avertis de ce type de « dommages collatéraux » ?
La loi de bioéthique ne prendrait de sens que dans un schéma de responsabilité générale, où des minorités ne pourraient jouir de nouveaux droits qu’en s’inscrivant dans un parcours pédagogique les amenant à un meilleur respect d’autrui et de la société qui leur permet de satisfaire leur désir personnel. Un meilleur accès aux informations médicales doit également être repensé.
Nouvelles du temps présent: Archives du lendemain
Price: 14,00 €
6 used & new available from 5,60 €
Price: 27,00 €
3 used & new available from 27,00 €

 19h00 | Co
19h00 | Co mment réunir la communauté française du NFT?
mment réunir la communauté française du NFT?  19h10 / Les NFT et le Crypto-Art aujourd’hui.
19h10 / Les NFT et le Crypto-Art aujourd’hui.  19h40 l Les NFT demain.
19h40 l Les NFT demain.