 Entretien avec Laurent Benarrous: “La France et les Juifs c’est terminé”. Par Marc Alpozzo
Entretien avec Laurent Benarrous: “La France et les Juifs c’est terminé”. Par Marc Alpozzo

Laurent Benarrous et Marc Alpozzo
Par Marc Alpozzo – Philosophe et critique littéraire. Il a publié une douzaine de livres, dont Seuls. Éloge de la rencontre (Les Belles Lettres), La Part de l’ombre (Marie Delarbre) Lettre au père (Lamiroy), Galaxie Houellebecq (et autres étoiles) (Ovadia) et il est coauteur de plusieurs ouvrages collectifs, dont L’humain au centre du monde (Cerf).
Laurent Benarrous – Avocat au barreau de Paris et écrivain, auteur d’un premier roman Tintamarre, La Route de la Soie, 2024.
Marc Alpozzo : Cher Laurent, la lecture de Tintamarre m’a mis en joie, notamment grâce à ce découpage très moderne en brefs chapitres, ce qui permet de bien résumer votre itinéraire. Aussi, vous écrivez dans votre livre une phrase qui me paraît essentielle : « J’étais juif parce qu’on m’avait dit que j’étais juif. Je n’en avais pas honte, mais j’étais d’abord français. » C’est une idée majeure, notamment dans le débat politique et sociétal actuel où l’on parle de « droit du sol » et de « droit du sang », évacuant tout de même l’idée centrale d’assimilation. Vous reconnaissez-vous dans la qualification d’assimilé ? Pourquoi pensez-vous que ce mot fait tant polémique aujourd’hui ?
Laurent Benarrous : J’ai toujours vécu le judaïsme comme un problème. Je n’en avais pas honte mais je comprenais instinctivement que cela n’allait pas me rendre la vie facile. Très tôt, j’ai proposé à ma mère « qu’on arrête d’être juif » mais elle m’a expliqué que ce n’était pas possible. Ayant eu un père d’extrême gauche qui haïssait les religieux, il avait interdit la religion à la maison. On n’en parlait jamais. La religion avait été « inventée pour pouvoir profiter des pauvres gens et les empêcher de se révolter et la Thora était un tissu d’âneries pour incultes ou illuminés ». À tel point que j’ignorais tout de mes origines et de ma religion. Papa nous a totalement coupés de nos origines, allant jusqu’à me proposer de devoir choisir entre une raquette de tennis et l’organisation de ma Bart Mitzva !
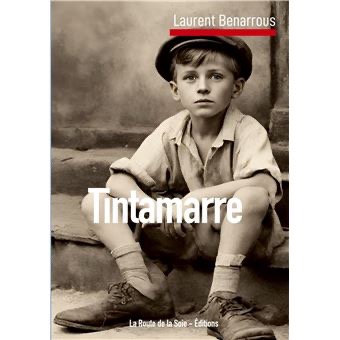
Évidemment, j’ai choisi la raquette de tennis, ne comprenant pas ce que voulait dire Bart Mitzva même si maman me disait à voix basse pour ne pas contrarier mon père « que c’était comme la communion des catholiques, et que je devais dire oui car j’aurais des cadeaux ». Dès petit, j’ai senti qu’être juif c’était quelque chose de compliqué puisque tout le monde me charriait dans ma cité avec ça. Quand on est enfant, on veut être comme tout le monde. À cette époque, les blagues racistes étaient en réalité dénuées de méchancetés réelles et je n’ai jamais vécu le moindre racisme. Mais j’avais le droit aux blagues qu’on entend sur les Juifs : « Tu caches où ton argent », « Vous êtes radin », « Vous dominez le monde », etc… J’avais du mal à comprendre tout cela, vu que nous étions très modestes et qu’on vivait en HLM et en banlieue ! Je dois aussi confesser que la religion catholique m’attirait. Je trouvais les cathédrales sublimes et on y parlait en français. J’ai même un jour appris une prière catholique que je répétais le soir avant de dormir, jusqu’au jour où ma mère m’a surpris et m’a dit « qu’elle n’en avait pas dormi de la nuit et qu’il fallait arrêter cela ».
En grandissant, le regard des autres, les blagues permanentes sur mon identité m’ont obligé à m’y intéresser. J’ai lu la Thora. Je n’y ai pas rencontré Dieu. Cette lecture a été une grande déception. J’ai aussi fréquenté des synagogues, mais j’y ai découvert que les juifs n’étaient pas meilleurs que les non-juifs. Puis, lors de la seconde intifada, devant l’agressivité des militants pro-palestiniens, je me suis intéressé à la question juive, au sionisme et à Israël. J’ai lu des centaines de livres sur la question et je suis consterné quand j’entends des gens parler de ce conflit sans avoir un minimum de culture.
J’ai découvert qu’on pouvait être juif sans croire en Dieu et aimer passionnément Israël. Le Juif assimilé que je suis est profondément attaché à Israël, d’une façon même excessive parfois. On ne touche pas à Israël chez moi. C’est un point de rupture. Pour autant, la France est ma patrie. Quand je regarde un match de foot entre Israël et la France, je soutiens la France sans aucune hésitation. La France m’a permis de vivre dans un pays libre, d’aller à l’école et d’être soigné, puis de faire des études et de devenir quelqu’un. J’ai la reconnaissance du ventre. Je crois que je donnerai ma vie pour ce pays sans aucune hésitation, même si j’ai découvert par ailleurs que le statut des Juifs en France n’avait pas été aussi naturel que je l’avais imaginé. Mais quel pays au monde m’aurait permis de devenir ce que je suis ? Reste que je constate comme beaucoup que l’assimilation est vécue par beaucoup comme un renoncement de ce qu’ils ont été. Pour eux, l’assimilation c’est une forme de reniement. Je pense qu’il faut l’entendre et qu’il faut arrêter ces débats et avoir pour seule exigence, l’intégration. L’assimilation viendra après. Je pense que forcer le lien, c’est prendre le risque de l’abîmer. La France ne doit pas obliger. Chacun doit comprendre que la France est une chance.
M. A. : La montée de l’antisémitisme aujourd’hui dans notre pays devient un fléau, notamment à cause du conflit à Gaza que La France Insoumise (Nouveau Front Populaire) essaie d’importer dans les débats nationaux. Votre roman est fort parce qu’il est un hymne à la France, vous y exprimez avec beaucoup de poésie l’amour de votre France qui est en grande partie d’objet de votre livre. Cependant, le moment de rupture c’est lorsque vous devenez père. À cet instant, vous souhaitez transmettre votre identité juive à vos enfants, décidant de faire circoncire vos fils. Est-ce que vous pensez que cette double appartenance est encore tenable dans la France d’aujourd’hui, et surtout celle de demain, cette République française, qui semble honnie par les tenants de la gauche radicale?
L. B. : Mon livre est un hymne à tous ceux que j’ai croisés et qui m’ont permis de me construire. J’ai été élevé sans aucun racisme et par éducation, je refuse totalement d’essentialiser les gens en fonction de leurs origines ethniques, religieuses et même sociales. J’en ai trop souffert pour le supporter. Pour moi, un homme est un homme et ce qui compte c’est ce qu’il fait. Je pense aussi que c’est une voie sans issue qui n’apporte que la division et la haine. Créer des différences qui ne doivent pas exister, c’est accepter de fabriquer les prémices de la division.
Le Front Populaire à cet égard est une honte et un danger pour la France.
Ce que ces gens ont fait, par pur calcul électoral, c’est de monter les communautés les unes contre les autres. Pour être plus précis, monter la communauté musulmane contre la communauté juive en se servant du conflit israélo-palestinien. Dans le climat de désespérance sociale, ce projet est criminel et je ne comprends pas qu’aucune sanction ne soit intervenue pour y mettre un terme.
C’est un aveu de défaite.
Par ailleurs, même si je ne pense pas que les hommes et femmes d’un certain âge y seront sensibles car la manipulation est grossière, je pense que la jeunesse arabe de France, qui a perdu le contact avec sa culture d’origine et qui ignore que les Juifs étaient présents au Maghreb avant les musulmans, se sont vu accorder par LFI un permis de tuer des Juifs avec la conscience du juste. En tant que juif ayant eu un père qui parlait l’Arabe et qui aimait profondément la culture arabe, allant jusqu’à m’inviter lors de nos séjours au Maroc à passer avec lui des moments dans des mosquées pour nous recueillir et mieux appréhender l’âme musulmane, j’en suis pétrifié. Si mon père était encore en vie, il aurait du mal à croire à l’ampleur et à la gravité du phénomène auquel nous assistons. Pour mon père, nous étions certes juifs, mais des Juifs arabes et depuis près de 800 ans et il adorait les Arabes qui le lui rendaient bien, en toutes circonstances. J’ai moi-même gardé cet attachement avec cette culture, si proche de celle de mon enfance, en ayant un entourage arabe très présent et qui me renouvelle son amitié avec une récurrence qui me fait du bien. Nous avons de très grandes choses en commun. La générosité, le sens de la fête, le respect des parents et un sens de l’humour. Cette proximité est tellement forte que je me suis marié avec une femme française, mais d’origine algérienne dont je suis éperdument amoureux. Par ailleurs, jamais un Arabe musulman ne m’a fait du mal. Ils ne m’ont fait que du bien depuis l’enfance, me protégeant des voyous de mon quartier et m’invitant chez eux à manger régulièrement. Je les considère comme des frères et je sais pouvoir compter sur eux. Quand nous nous croisons, nous sommes malheureux de ce que nous voyons arriver à grands pas. Dans mon roman, les Arabes ont une belle place. Mon ami Farid est mon héros et la plus belle preuve de générosité que j’ai rencontrée depuis que je suis né, c’est dans un petit village du Maroc où un enfant d’une pauvreté extrême m’a donné son tam-tam lors de mon départ. LFI salie la culture arabe et les musulmans qui méritent d’être représentés par des gens plus honorables. Mais quand on souffre, on fait souvent des mauvais choix. Cela étant, malgré la politique et cette proximité avec la culture arabe, ni moi ni mon père n’avons oublié la réalité. Nous étions des Juifs, et avant de mourir, mon père, avait un peu évolué sur la question juive et sur ses positions politiques. Il était devenu plus sage. La gauche l’avait écœuré. La gauche que mon père et moi avons adorée n’était pas celle d’une bande de voyous incultes, n’ayant aucun amour de la France et vendant ses Juifs pour gagner des élections. Et puis, lorsque j’ai décidé de circoncire mes fils, papa est venu et j’ai vu de la fierté dans ses yeux quand il portait mes fils sur la chaise de circoncision. Ce jour-là, j’ai compris que papa était encore juif, mais trop en colère pour l’accepter. Il connaissait toutes les prières par cœur ! Il m’a demandé pourquoi j’avais fait ce choix. J’ai été incapable de lui répondre et aujourd’hui encore je ne sais pas quoi vous répondre. Je crois que le judaïsme est inscrit dans nos gènes et que l’alliance est un sentiment qui survit à tout, même au Trotskysme de mon père. C’était très important pour moi de circoncire mes fils, à un point tel que lorsque le Moal m’a dit « on peut décaler d’une journée, pour vous ce n’est pas important : je l’ai attrapé par le col pour lui dire « mes fils sont juifs » ! » Ensuite, avant de mourir, papa m’a dit « je veux mourir en homme et pas en juif. Mais tu me liras le kaddish si cela te fait plaisir ». Par contre, « écoute moi mon fils, tu dois te préparer à faire des valises car pour les Juifs, la France c’est terminé » ! J’étais sidéré. J’ai tenté de le relancer, mais il était épuisé. Il m’a juste dit « écoute moi ». Je n’ai pas écouté mon père, mais jour après jour, je constate qu’il avait malheureusement raison.
La France et les Juifs c’est terminé. Il ne manque que la date. Un jour, des guides touristiques feront des visites dans Paris pour rappeler où nous vivions. Cela me rend très malheureux car je suis très attaché à cette terre et profondément français. Mais pour moi, un départ est très compliqué. Mes enfants ne sont pas juifs. Personne ne parle hébreux et je suis marié avec une femme qui n’est pas juive. J’attendrai qu’on vienne me tuer. Je ne partirai pas, quelles que soient les menaces et les pressions.
M. A. : Autre point essentiel de votre roman : les névroses héréditaires, et notamment la psycho-généalogie. Vous avez une relation très difficile à votre père, qui s’apaise un tant soit peu dès lors que vous apprenez qu’il a été lui-même maltraité par son père : « Ton père, lui, non seulement il était seul, mais il était maltraité dans sa propre famille ». Est-ce que votre roman est un roman de la résilience ? Pourquoi l’avoir intitulé « Tintamarre » ? Est-ce le tintamarre familial ?
L. B. : Mes amis me demandent comment je peux aimer un tel monstre ! Ils me demandent si je ne suis pas victime du syndrome de Stockholm. Je les comprends. Mais on pardonne ce qu’on peut comprendre et moi j’ai compris mon père, sa folie, sa violence, ses souffrances et je ne veux pas le juger car je sais qu’il a été le premier puni de sa folie. Je n’ai jamais douté que cet homme nous aimait, mais il souffrait trop pour faire la paix et malgré ses immenses talents, il n’a pas trouvé comment se réconcilier avec la vie. Mais un homme n’est pas qu’un monstre. On ne peut pas réduire un homme comme ça. On est tous complexes, avec des cotés sombres et peu recommandables. Papa avait aussi des qualités exceptionnelles. Il y avait 500 personnes à son enterrement. Il n’a pas fait que du mal. Il n’a pas connu ce que vous appelez la résilience. Pourtant, il le méritait car il avait toutes les qualités pour la rencontrer : la volonté, l’énergie, la culture, un humour foudroyant et une répartie exceptionnelle. Mais la vie est une loterie tragique. En ce qui me concerne, je n’ai pas eu la volonté de parler de résilience. J’ai écrit ce livre pour mes enfants, car finalement, on ne connaît jamais ses parents. Je suis stupéfait quand je vais aux enterrements de constater que personne ne connaît réellement le défunt. Je l’ai aussi écrit pour tous ceux qui souffrent de n’être rien et qui sont en réalité exceptionnels, car c’est grâce à eux que j’ai pu survivre et rester debout. J’ai eu envie de les consoler et de leur dire qu’ils étaient des héros car ce qui compte lors de notre bref passage sur terre, c’est de donner et de ne pas abîmer. Ceux-là ne comptent pas. Seuls comptent les imbéciles prêts à tout pour exister et à accumuler des objets inutiles. Reste la question du pourquoi du comment de ce livre !
Ce livre est un accident et je m’en excuse par avance…. Comme tous les Français écrivent, même ceux qui n’ont rien à dire ou qui oublient en publiant qu’ils ne bénéficient que d’un système qui donne à ceux qui peuvent rendre, je n’avais pas envie de gêner ! Et puis les arbres sont si rares que je culpabilisais quand même un peu. Il est sûrement né pour permettre aux romans que j’écrivais depuis des années d’être débarrassés de ces récits qui les polluaient, les rendaient illisibles, à force de vouloir à tout prix raconter tout cela, dans des histoires qui ne le permettaient pas vraiment. Il fallait probablement écrire celui-là pour pouvoir devenir enfin écrivain. Je n’ai d’ailleurs jamais voulu l’éditer, pensant qu’il n’avait aucun intérêt. Ce manuscrit était posé sur une table de mon cabinet. Il prenait la poussière depuis plus de 10 ans et j’en avais écrit 25 versions. C’est une associée du cabinet où je travaille qui l’a lu ! Qu’est-ce que c’est ? Un livre pour les miens. Je peux le lire : oui ! Et il est arrivé dans les mains de Guilaine Depis, puis de Sonia Bressler. Je suis donc le seul écrivain qui n’a rien fait pour être édité et je trouve ça stupéfiant !
Je n’ai pas réalisé la portée universelle du message de ce livre. Les gens qui reviennent vers moi me disent qu’ils se sont repassé toute leur vie. Il ne parle donc pas de moi, mais de nous ! Cela étant dit, quand on écrit, on souhaite être lu et ce serait totalement hypocrite de prétendre que ce désir n’existait pas. Mais j’ai toujours préféré rêver ma vie que de la vivre. Ça évite d’avoir des refus. C’est comme avec les filles. Pourquoi draguer pour prendre une veste ? J’ai toujours préféré qu’une femme soit nue dans mon lit pour tenter ma chance et encore, il fallait qu’elle me pousse dans le lit et qu’elle me confirme que « j’avais une ouverture. » Cela s’appelle avoir peur. Peur de vivre. Bref, mon histoire n’a aucun intérêt. Elle est d’une banalité affligeante et consternante. Même moi, elle ne m’intéresse pas. Que la vie soit dure ne sera une découverte pour personne et chacun pourrait raconter la même histoire et même pire que celle-là. Aujourd’hui, le seul statut enviable est celui de victime ! Moi, je n’ai jamais voulu être une victime. C’est une voie sans issue. On préfère donc être plaint que d’être admiré, sauf à vouloir être admiré parce qu’on est à plaindre…
Ce qui est original dans ce livre, je le pense, c’est la manière de la raconter, à travers les yeux d’un enfant qui forcément n’a pas de point de vue. Je ne vous dis pas à quelle page il faut rire ou pleurer. Vous faites ce que vous voulez. J’ai horreur qu’on me manipule. Et je vais au plus profond et au plus sincère. Ce n’est pas un adulte qui revient sur son enfance. C’est un enfant qui vous raconte son enfance. J’y ai mis toute mon âme. Ne me parlez donc pas de récit de vie. Ma vie n’a aucun intérêt ! Et d’ailleurs qui vous dit que c’est ma vie et ou que je n’y ai pas glissé quelques mensonges pour rigoler ? Quant à la structure, ne m’en voulez pas d’avoir choisi la forme chronologique. J’aurais pu structurer ça à l’américaine. Vous savez ces écrivains qui écrivent des livres de 500 pages ou qui font des scénarii oscarisés, qui vous tiennent en haleine jusqu’au bout et vous font vivre les montagnes russes, mais que vous avez oublié totalement dès le lendemain, en étant même incapable de vous rappeler du sujet ! J’aurais aussi pu l’écrire en utilisant des mots qui font intelligent et distingué et faire des phrases définitives, mais moi en général, cela me donne envie de dormir. Je n’aime pas qu’on se cache derrière des mots et qu’on cherche à enfermer la vie dans des phrases. Je veux que les mots cognent, qu’ils aillent au but. Enfin, pourquoi « tintamarre » ? J’ai été incapable de trouver un titre à ce livre moi qui adore donner des titres aux chapitres ! C’est une amie à moi qui a trouvé ce titre après l’avoir lu en me disant « mais quel tintamarre cette vie » ! Et j’ai trouvé ce titre amusant et enfantin et disant que face à la vie, il faut un peu de dérision car tout cela n’est que du boucan et un peu de baraka !
M. A : La France a malheureusement un passé douloureux et trouble avec sa communauté juive. Nous n’allons pas rentrer dans les détails, mais durant la Seconde Guerre mondiale, la France a échoué à protéger ses Juifs des griffes des Nazis. Voilà que le passé nous revient comme une sorte de retour du refoulé. La France d’aujourd’hui est haut en couleurs et multiculturelle, ce qui ne semble pas vous déplaire. C’est ainsi que vous aimez votre France et vous en dressez dans votre livre un panorama enthousiasmant. Pourtant, avec un certain antisémitisme d’importation, un antisémitisme à gauche de plus en plus dangereux, une tribune dans Le Monde de vendredi 20 juin qui prétend que c’est instrumentalisé par l’extrême droite, comme s’il pouvait y avoir un antisémitisme acceptable parce que de gauche et un antisémitisme inacceptable parce que de droite, ne voyez-vous pas là le point de bascule, qui donne raison au mot de Gérard Colomb, désormais nous vivons face à face, et les Juifs sont désormais mis en première ligne ? Que vous inspire cette époque à propos de cette France que vous chérissez ? Est-ce que vous ne craignez pas de la quitter un jour à cause de cela ?
L. B. : J’ai été de gauche pendant 40 ans. J’ai même eu ma carte du Parti socialiste et j’ai défendu avec acharnement la motion Rocard. Aujourd’hui, j’ai honte de moi. D’avoir participé à l’effondrement de notre pays, de ses valeurs, de sa culture. D’avoir été à ce point dans l’erreur. Évidemment que nous allons devoir partir, mais moi je ne partirai pas. Je ne peux pas vivre ailleurs qu’en France. Les Juifs se débattent et sont dans le déni, mais c’est terminé pour nous ici, sauf mort ou en rasant les murs. La démographie est contre nous et quand elle sera à son point culminant, que se passera-t-il ? Nous avons déjà perdu. C’est toujours comme ça lorsqu’on a 50 ans de retard sur un problème. Nous sommes aujourd’hui totalement dépassés et impuissants car peu nombreux et incapables de résister à cette violence qui n’est pas dans notre culture. L’inquiétude est d’autant plus grande que les événements du 7 octobre nous ont démontré que l’antisémitisme était mondial et qu’il n’existait plus aucun endroit sur terre où nous pouvions vivre en paix. Je ne suis pas sûr que même sur Mars on n’irait pas nous chercher pour violer nos femmes et nous brûler vifs en famille. L’absence de réaction du pays démontre aussi qu’il a accepté sa défaite. Quand on craint sa population, c’est qu’on a déjà perdu.
M. A. : Dans votre roman Tintamarre, vous écrivez à un moment être passé « d’outsider à looser ». Que voulez-vous dire par là ? Vous êtes un avocat de forte renommée pourtant, n’est-ce pas là le signe tout de même d’une belle réussite sociale ? Est-ce que pour vous le gagnant que vous dîtes être aujourd’hui se devait de devenir écrivain, sans quoi vous auriez considéré votre vie comme ratée ?
L. B. : Le regard qu’on porte sur soi dépend d’énormément de facteurs. Certains se regardent le matin et sont contents d’eux. J’aimerais être ainsi ! Quand j’ai réalisé que je n’étais ni le plus beau, ni le plus fort, ni le plus riche ni le plus intelligent, j’ai trouvé ça déprimant. Et puis surtout, avec le temps, j’ai réalisé que je ne tenais pas les promesses que je m’étais fait enfant ! Mais quand on ne prend pas le risque de n’être rien, on devient souvent rien, ou plus exactement, pas celui qu’on rêvait d’être. Je n’ai pas eu ce courage. Pour l’avoir, il aurait fallu accepter de renoncer à ce concours d’avocat ou d’avoir le courage de le rater et de ne faire qu’écrire. Mais j’étais las d’être pauvre et j’avais besoin de considération. Le métier d’avocat m’en donnait. Je n’étais plus « le fils à la petite Juju », j’étais Maitre BENARROUS, avocat au Barreau de Paris ! C’est assez pathétique, mais c’est la vérité. Je sais que je suis écrivain depuis que j’ai 10 ou 11 ans, sans avoir lu le moindre livre. J’ai écrit dans ma tête une bonne trentaine de romans, sans discontinuer, pour éviter le réel que je trouvais insupportable, mais dès que je passais à l’écrit, la magie s’évaporait et je découvrais un écrivain raté ! Depuis, j’ai vécu comme une femme enceinte qui n’aurait jamais accouché. Cela m’a rendu très malheureux et cela explique ce sentiment d’échec, car même si mon livre ne permet pas de le comprendre, j’ai créé dans ma tête une œuvre, qui je pense mérite d’exister et je ne veux pas mourir sans avoir tenu les promesses que je m’étais fait enfant. Aujourd’hui, malgré ce livre, je n’ai aucun sentiment de victoire. Je suis juste soulagé. Je serai heureux quand j’aurais écrit tous les livres qui m’envahissent et qui me gâchent la vie, car je me sens obligé de les écrire, mais je suis malheureusement pris par une vie avec de très fortes contraintes que je me suis bêtement imposées. Et puis, j’ai très longtemps souffert d’une mélancolie atroce, qui m’a fait perdre le goût des choses, rien n’ayant du sens à mes yeux, même si j’ai eu à cœur de sauver les apparences et d’avoir ce qu’il faut pour répondre aux critères de l’époque, une belle voiture, une maison de campagne et une femme superbe, car je n’ai pas voulu donner aux gens le plaisir de ma défaite. J’en ai été d’autant plus malheureux que le métier d’avocat ne m’a jamais rendu très heureux ! Je ne crois pas à la justice tandis que la Loi et le Juge me rappellent trop mon père et mon impuissance devant lui. Un bon résultat me permet de ressentir du soulagement. Un mauvais résultat et ce sont les ténèbres pendant plusieurs jours. Je crois que je revis éternellement mon impuissance d’enfant face à un père effrayant et dominateur. Cela ne m’empêche pas de faire mon travail avec un grand sérieux, mais il me provoque tant de souffrances que si j’avais pu écrire et en vivre, je me serais épargné cette souffrance, et ce, d’autant plus que pour beaucoup, trop, être avocat remplit une vie, et que dès lors, je n’aurais manqué à personne.
Propos recueillis par Marc Alpozzo
 Valérie Gans, La question interdite
Valérie Gans, La question interdite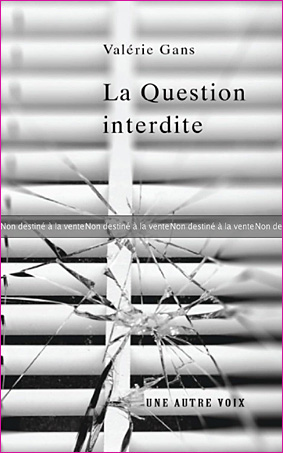
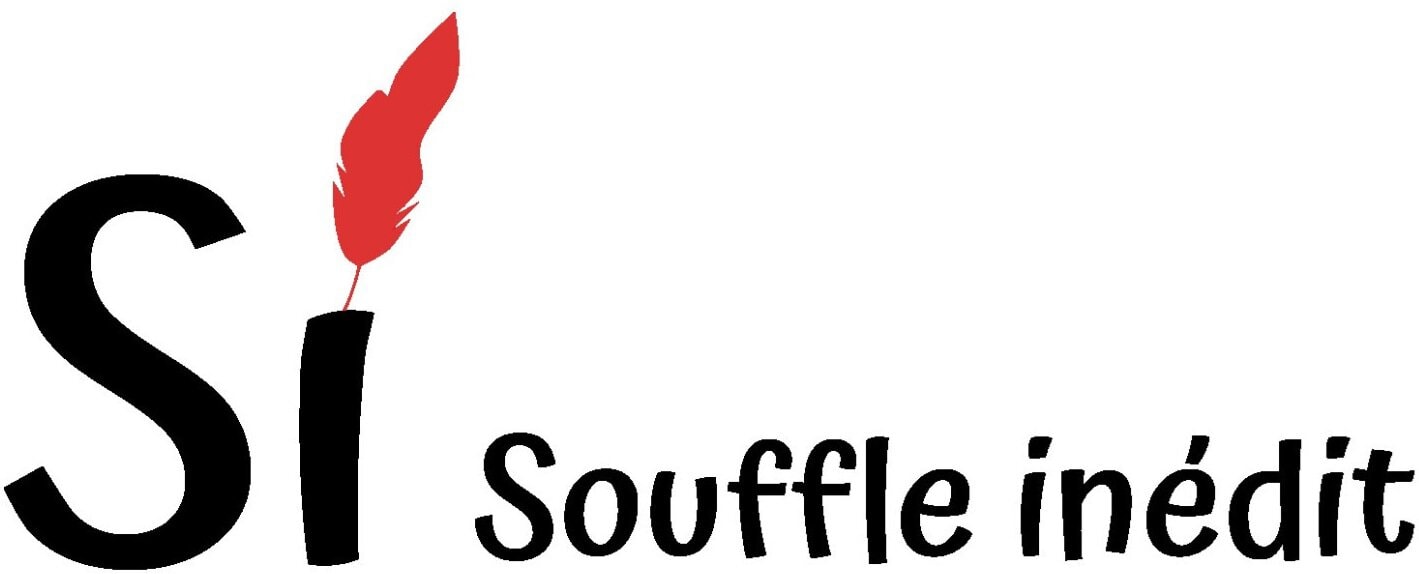







.jpg)

.jpg)
 Cuisine et littérature
Cuisine et littérature
 La littérature et le Mal : entretien avec Dana Ziyasheva
La littérature et le Mal : entretien avec Dana Ziyasheva


 Dans le cadre de l’exposition « Socotra, des dragonniers et des hommes » du photographe Benoit Palusnski
Dans le cadre de l’exposition « Socotra, des dragonniers et des hommes » du photographe Benoit Palusnski