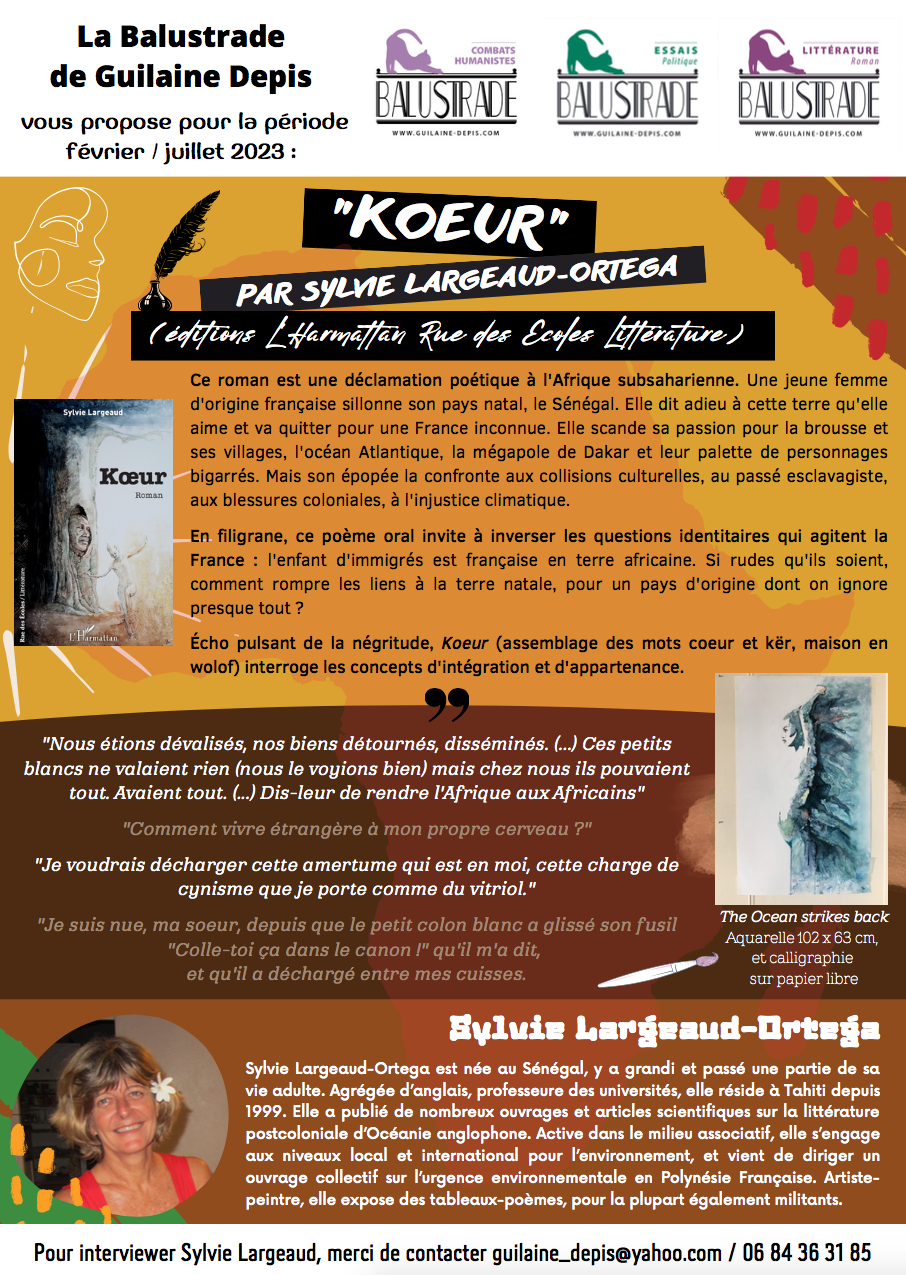Vidéos sur l’Association « Les Amis de Patrice » créée par Eric Durand-Billaud (médecin chercheur en neurosciences), auteur de « L’amputation », récit de sa vie avec son mari Patrice Billaud-Durand (décédé d’un AVC durant le premier confinement), et l’exposition « Distorted Date » de l’artiste Erik Andler qui s’intéresse lui aussi aux neurosciences
Mois : février 2023
« Le quinquennat de Macron ? Un fiasco national ! » interview de Christian de Maussion dans Entreprendre
 « Le quinquennat de Macron ? Un fiasco national ! »
« Le quinquennat de Macron ? Un fiasco national ! »
Entretien avec Christian de Maussion
Le moins que l’on puisse dire, c’est que le second quinquennat de Macron n’a pas commencé sous les meilleurs auspices, d’autant que l’abstention fut importante, et sa campagne introuvable. Mais l’on doit aussi rajouter que le premier s’est assez mal terminé. Pour l’écrivain et intellectuel Christian de Maussion, ce premier quinquennat fut un fiasco national, ce qu’il dénonce et décrit dans un nouveau livre La fin des haricots (5 sens éditions, 2022). Je l’ai rencontré dans un restaurant du VIème arrondissement de Paris.
Marc Alpozzo : Cher Christian de Maussion, vous êtes l’auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, intitulé La fin des haricots (5 sens éditions, 2022) qui est un pamphlet, excellent par ailleurs. Il est une critique caustique et juste de l’ère Macron. Vous le sous-titrez : « Chronique d’un fiasco national, 2017-2022 ». Pourquoi ce livre ? Pourquoi maintenant ? Croyez-vous vraiment que le premier quinquennat de Macron fut un fiasco ? Pourquoi ?
Christian de Maussion : L’ouvrage est un collage de petits textes rédigés à la diable, puis repris, repolis, une juxtaposition au fil du temps, le journal occasionnel de mes humeurs au regard du spectacle politique, certes indigent, mais toujours distrayant. Macron joue le jeu. Il jouit du pouvoir. Il théâtralise l’Elysée. L’ouvrage s’est achevé, faute de volonté. J’avais le sentiment d’avoir épuisé le sujet, d’avoir suffisamment consacré de mon temps à l’histrion. Autrement dit, j’ai exprimé une colère, manifesté une indignation, jeté un cri, au besoin pratiqué l’ironie. On attribue souvent à Boris Vian une phrase qui appartient à Chris Marker, le poète cinéaste : « L’humour est la politesse du désespoir ». Cette politesse du désespoir, je l’ai nommée avec mes mots : « La fin des haricots. » L’ouvrage fait écho à l’écriture d’un essai littéraire sur la poésie du pouvoir : C’est encore loin de Gaulle ?[1]. Avec Macron, De Gaulle est désormais très loin, inaccessible, au-delà même de l’horizon. Macron s’est débarrassé du grand Charles, d’« Amédée », comme dans la pièce éponyme d’Eugène Ionesco. Il gît, introuvable, dans le placard de Benalla. L’attentat, cette fois, à la différence de celui du Petit-Clamart, n’a pas été raté. De Gaulle est mort, surtué comme le fut Mesrine par la police, de dizaines de balles en plein cœur. Le quinquennat est un fiasco car rien de grand n’y fut accompli, ni même envisagé. Le grand chagrin gaullien, c’est la perte de l’indépendance nationale. L’épisode du virus de Chine a révélé la subordination du pays vécue comme l’humiliation d’une nation. Nous sommes à la remorque d’une Europe de rivaux, d’un monde hostile, par définition. À cela s’ajoute un péché contre l’esprit : la division du peuple. Macron n’est pas machiavélique, il est diabolique. Il fait le Malin, attise les méchants instincts. Il fracture, excite les querelles, scinde le corps social comme seule une âme satanique sait faire. Le « Qu’ils viennent me chercher ! » s’apparente aux tentations de Jésus au désert de l’Évangile de Matthieu. Le Macron tentateur provoque ainsi le peuple des gueux.
M. A. : Vous commencez votre livre par cette phrase : « Macron séduit les patrons, un peu moins les corons ». Diriez-vous comme les Pinçon-Charlot, que Macron est le président des ultra-riches[2] ?
C. M. : Macron soliloque en son palais. Il est le président de lui-même. C’est pourquoi le peuple se sent à l’étroit dans le nombril du monarque. Le quinquennat se calque sur une politique du selfie généralisé.
Macron s’entiche des ultra-riches. Il est leur potiche. Il leur appartient. Ils ont payé l’accès à l’Elysée. Reconnaissance du centre, reconnaissance du ventre. Mais son affection à leur endroit n’est pas illimitée. Il n’adore qu’un seul dieu, à qui mieux mieux : « Bibi », comme il dit.
M. A. : Hormis Pompidou, que vous qualifiez de dernier lettré, aucun des autres présidents ne trouvent grâce à vos yeux, notamment Macron, que vous rangez dans le « quarteron des ambitieux félons ». Qu’est-ce que vous voulez dire par-là ?
C. M. : Je ne sais plus trop pourquoi j’ai usé de cette expression. « Quarteron » ressortit de l’idiome gaullien. Il renvoie aux généraux dissidents de l’époque algérienne. Sans doute ai-je voulu fourrer Macron dans le même fourgon que Giscard, Sarkozy, Hollande. C’est un quatuor de profond désespoir. Les trois petits présidents quinquennaux rivalisent de pugnacité au trophée de la médiocrité. Je suis injuste d’associer Giscard. Mais il annonce Macron par le mépris, le modernisme de pacotille, l’hypertrophie d’un ego qui mène rigoureusement au même fiasco. La félonie est leur marque de fabrique. Au sens où leur politique de renoncement à la grandeur et à l’indépendance les associe au déclin de nos contrées, à la trahison d’une nation.
M. A. : Je crois personnellement que Macron n’est pas un libéral, il s’occupe de tout, il signe des chèques à tout va, il mène une politique d’État-providence, en distribuant de l’argent magique. À l’inverse, vous écrivez que Macron est un « libéral de gauche, enraciné dans une politique de droite ». Comment pouvez-vous justifier cette idée. Je crois plus, pour reprendre vos propres mots, que Macron représente une gauche caviar et « humanitaire qui ennoblit la droite épicière ».
C. M. : À vrai dire, Macron est creux. C’est un ectoplasme idéologique. Il règne sans conviction. Il n’a de respect que pour ses intérêts. « Il est enraciné dans une politique de droite ». Car la sociologie électorale est provisoirement à droite. Les bataillons de la droite épicière sont venus conforter le socle de la gauche originelle. Il est libéral. C’est sa nature. « Comme on parle du nez » disait André Gide de la belle âme de Jean Guéhenno. A cause de son pedigree, de ses gènes affairistes. Mais dans le même temps, il nationalise les salaires du pays, déglingue les comptes, improvise un communisme qui coûte un pognon de dingues. Il est de gauche parce que c’est une étiquette gratifiante qui honore le bourgeois d’élite, qui labellise son bon cœur. Chic type !
Oui. Macron est « Le Candidat » de Flaubert. Il est le Rousselin d’une pièce oubliée :
« – Pourquoi toujours ce besoin d’être emporte-pièce, exagéré ? Est-ce qu’il n’y a pas de tous les partis quelque chose à prendre ?
– Sans doute, leurs voix. » (Acte II, scène XI)
Plus loin :
« – Il est absurde d’avoir des opinions arrêtées d’avance. » (Acte IV, scène II)
Bref, « candidus » veut dire blanc en latin. Le candidat est la somme de toutes les couleurs, y compris politiques.
M. A. : Lors de l’époque des gilets jaunes, la macronie a été violente avec ces Français issus de la classe moyenne, qui manifestaient, je crois légitimement, pour vivre dignement. Pourtant, « Casta-nerfs », je reprends votre jeu de mots, Macron, avec la complicité d’une partie de la police, ont réprimé durement le mouvement des gilets jaunes. Vous parlez, vous, en revanche, d’« extrêmes jaunes », il est vrai que le mouvement a été protéiforme, et il y a eu certainement une partie de séditieux. Pourtant Macron a, à la fois reculé devant le mouvement, et gardé le cap, jusqu’au Covid qui a été l’arrêt de mort des gilets jaunes. Croyez-vous qu’ils ont été jusqu’au bout des « comédiens du réel », comme vous les nommez, et ne pensez-vous pas que Macron s’est montré cynique et froid dans cette triste période ?
C. M. : Macron a eu chaud. Il a eu peur. Les gilets jaunes, c’est une révolte à l’état pur. Le peuple est en rogne. C’est une jacquerie sécrétée par la Macronie, une émeute des gens d’ici qui dit, qui crie : ça suffit. La révolte terrorise l’auteur de Révolution. L’assaut des ronds-points réveille le réel, cogne contre les mots du virtuel. La révolte procède du spontanéisme, dopé par l’instantanéité des réseaux numériques. Elle s’affranchit des maîtres, des syndicats, des partis, des institutions, des grandeurs d’établissement. Elle est anarchique, an-énarchique. Une vraie gueuserie. La précarité et la pauvreté déterminent un élan, une solidarité, une humanité, un besoin de visibilité. Les gueux sont bien « les comédiens du réel ». Ils incarnent, ils sont la chair de leur terre. Or Macron ne saisit que pouic. Il joue un autre théâtre. Il est corseté dans son habit de petit marquis. Il baigne dans le monde virtuel de la note administrative. Les vilains échappent à son radar. Et quand il les voit de près, il prend peur, il s’enfuit, il rentre au palais. Macron et les gilets jaunes, ce sont deux étrangetés qui peinent à s’apprivoiser. Les deux corps sont chimiquement distincts. C’est la signature de la fracture. Mélenchon va épauler Macron. Il politise les manifs, dénature le message de la rue. Le réel est aboli, réécrit en virtuel, représenté en blabla du grand débat.
M. A. : Vous abordez également la période du Covid, dénonçant le Macron « va-t-en guerre » ridicule. Que retenez-vous de cette expérience inique ?
C. M. : De la guerre du virus, je retiens le triomphe des menteries de tout acabit. Le sens philosophique du mot « vérité » a été distordu, voire trahi. Les joviaux praticiens d’une discipline, la médecine, se sont arrogés le monopole de la science. Ils ont maquillé leurs opinions et préjugés sous le masque d’une hypothétique recherche fondamentale qu’au reste ils peinaient à maîtriser. Sous diverses appellations – fèques niouzzes, blasphèmes, contre-vérités, ignorances –, le mensonge a régné en souverain, a obscurci la saisie de l’événement.
À la tyrannie du mensonge corporatiste, l’Etat électoraliste s’est rangé, s’est conformé. Je retiens aussi le burlesque des temps, le comique de situation. La péripétie des masques fut un grand moment de rire, de fou rire « hénaurme », de délire absolu. Je retiens encore, le silence de la cité : Paris, ville morte. Je me souviens de la brave Mauricette, première piquée, comme d’une saynète de cinéma muet, à la Max Sennett. J’éprouve un certain ressentiment à l’évocation des longues semaines de confinement. J’ai l’impression que la population a vieilli d’un coup, prématurément, que les corps et les têtes se sont usés, se sont doublement altérés. Un peuple entier s’est abîmé dans un encabanement généralisé. « Encabanement » est un mot que j’emprunte à dessein à Pierre Legendre (« Jouir du pouvoir », traité de la bureaucratie patriote, Editions de Minuit, 1976).
M. A. : On disait de Chirac qu’il était un super menteur. On pourrait dire de Macron qu’il est un super tricheur. Il s’invente chef de guerre quand il n’y a pas la guerre, il s’invente gardien de la paix quand c’est la guerre, il se fait passer pour un homme de gauche quand il mène une politique de droite, et inversement. Pensez-vous que le « en même temps » de Macron n’a pas ruiné les relations de confiance entre le pouvoir et le peuple ?
C. M. : La fadaise du « en même temps » est une escroquerie intellectuelle. Dans mon livre, je souligne qu’il fait fi de la logique de non-contradiction, de la logique du tiers exclu, héritée d’Aristote. La prétendue invention de Macron jette la confusion. Il l’érige en principe de gouvernement. Le peuple se défie, se détache d’un pouvoir obscur, indéchiffrable, sans clarté ni vision. Tout se passe comme si l’abstention du peuple était le but inavoué du prince. Une abstention qu’il souhaiterait muer en passivité. Car le peuple, à la manière du Bartleby de Melville, « préfère ne pas ». Il renonce aux urnes. Il s’est lassé d’être traité d’illettré, d’être convaincu d’indignité sous prétexte de « populisme ». A écouter les discours majoritaires, le peuple idiot ne mériterait pas l’intelligence, la légitime excellence de ses élites, confrontées à « la difficile complexité ». Au demeurant, l’extase technocratique de l’usine à gaz comme traitement systématique d’un dossier (retraites, sa meilleure illustration) se conjugue à merveille avec un pareil brouillard conceptuel.
Christian de Maussion, La fin des haricots, Paris, 5 sens Éditions, 2022.
1] Christian de Maussion, C’est encore loin De Gaulle ?, Paris, Éditions du Bon Albert, 2002.
[2] Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, Le président des ultra-riches : Chronique du mépris de classe dans la politique d’Emmanuel Macron, Paris, La Découverte, 2019.
John-Frédéric Lippis dans le magazine Entreprendre
 Dans les cœurs de Mozart et Jean-Paul II
Dans les cœurs de Mozart et Jean-Paul II
Entretien avec John-Frédéric Lippis
Qui était Mozart ? Qui était Karol Józef Wojtyła, dit Jean-Paul II ? Pourquoi un musicien compositeur de notre siècle a décidé d’écrire sur ces deux hautes personnalités, qui nous parlaient directement au cœur ? C’est ce que j’ai essayé de comprendre en interrogeant John-Frédéric Lippis, auteur de merveilleux essais, un sur le pianiste et compositeur de génie, l’autre sur le pape et homme de foi.
Marc Alpozzo : Bonjour John-Frédéric Lippis, vous faites paraître deux très beaux textes Dans le chœur de Mozart (Lina éditions, 2022) et L’homme a la valeur de son cœur (Lina éditions, 2022). Outre, que vous jouiez dans vos deux titres sur le mot « cœur », vous abordez dans l’un des ouvrages le génie de la musique du XVIIIème siècle, Mozart, et dans l’autre, le Pape Jean-Paul II qui a laissé un héritage immense. Pourquoi ces choix ?
John-Frédéric Lippis : Bonjour Marc Alpozzo. Très honoré d’échanger avec vous. Ces choix se sont imposés à moi naturellement. D’abord pour l’admiration que je porte à ces deux personnages hors normes et ce qu’ils m’ont apporté dans ma vie. Et plus encore, je voulais souligner combien leur existence avaient enrichis chacun de nous. Ils ont été un apport pour l’humanité. Deux grands spirituels qui ont permis de lever le nez du sol. D’une certaine manière, je dirais que nous les respirons chaque jour, ils sont dans nos vies. C’est la raison pour laquelle j’ai voulu faire ces livres. Quant au cœur, il a été la base de mon éducation.
M. A. : Avec Haydn, Mozart, dont il est le contemporain, touche directement à l’âme de l’auditeur. Ne peut-on pas dire la même chose du Pontificat de Jean-Paul II, et qui nous a laissé un message important, que vous citez : « N’ayez pas peur. Ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes au Christ, à sa puissance salvatrice. Ouvrez les frontières des États, des systèmes politiques et économiques, ainsi que les immenses domaines de la culture, du développement et de la civilisation. N’ayez pas peur. » ?
J.-F. L. : Mozart a harmonisé comme nul autre ses partitions rendant les barres de mesures moins lourdes et tranchantes. Il a été l’un des premiers à donner des concerts pour le public le plus large à l’époque, à sortir des salons des « rois » réservés aux plus nobles, pour partager sa musique dans des lieux publics au moment où Vienne (1750) fut le centre de l’Europe, de la modernité et de culture. En quelque sorte Mozart a donné un sens nouveau au son et même à l’expression scénique dans ses opéras.
Jean Paul II a donné de la portée aux mots, il a redessiné peut-on lire ici ou là les cartes de certains pays d’Europe qui par son influence spirituelle ou politique a « aboli » des frontières. Le monde a bougé. Des murs sont tombés. Jean Paul II a ouvert la porte de l’Église d’un partage large et populaire avec ses Journées Mondiales de la Jeunesse. Deux rock stars pourraient-on dire, avec un message, une valise de vitamines de l’âme à distribuer à tous. Mozart a allégé l’écriture musicale, et pourtant elle a pesé plus lourd que toutes les autres écritures. Jean Paul II a apporté de la modernité et a su actualiser des textes anciens avec talent et sens.Celle-ci en est un exemple: « Ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes au Christ, à sa puissance salvatrice ». Et la suite qu’il donne n’est que sa « traduction contemporaine » dans l’ère que le monde vivait à cette époque : « Ouvrez les frontières des États, des systèmes politiques et économiques, ainsi que les immenses domaines de la culture, du développement et de la civilisation. »
Ils incarnent l’harmonie. Ce sont des bâtisseurs de l’humain. Et j’ai toujours rêver de leur ressembler, en restant à ma place, celui que je suis.
M. A. : Vous êtes un musicien de renommée internationale. Wolfgang Amadeus Mozart était pianiste et compositeur comme vous. Il n’a pas vécu très longtemps, 35 ans. Il est un compositeur autrichien de la période classique, considéré comme l’un des plus grands de l’histoire de la musique européenne. Il laisse derrière lui une œuvre considérable (893 œuvres sont répertoriées dans le catalogue Köchel). Aussi, selon les témoignages de ses contemporains, il était un virtuose au piano comme au violon. N’y voyez-vous pas là l’expression du divin dans cette étoile filante ?
J.-F. L. : Mozart a reçu une formation musicale rigoureuse de son père dès son plus jeune âge. Musicien virtuose, c’est certain, mais plus encore, son œuvre relève du divin. On dépasse ici toutes les formes et expressions. Nous avons à faire à l’œuvre d’un personnage qui a créé la majorité de ces œuvres lorsqu’il était enfant, adolescent. Ces tournées de représentations les plus flamboyantes furent celles de l’enfant prodige qui à l’époque ont fait de lui un génie auprès du public. Aussi, sa rapidité de composition, d’écriture, relevait du divin si on y associe l’expression, la qualité d’harmonie, puis le rendu. On est au-dessus de l’imaginable. Mozart a pris le temps d’écrire alors que la vie ne lui en a pas beaucoup donné. En même temps, elle lui a offert l’éternité et le sublime.
Ces œuvres répertoriées au catalogue Köchel, constamment enrichis par des spécialistes après, nous montrent combien Wolfgang Amadeus battait la mesure, il ne se répétait pas, et se corrigeait très peu. Comme souvent lorsque l’on crée cela est un jet, cela vient vite et tout entier. C’est LA création le LA de la créativité. Ce qui est (re)travaillé devient un produit quelque chose d’« artificiel ». Il faut laisser à l’œuvre sa part de magie. Il y a une puissance invisible dans chaque création.
Lorsque vous dites « Mozart était un pianiste comme vous », j’en suis flatté, je n’ai pas son génie, mais je me suis modestement reconnu en lui, et comme beaucoup d’autres, il m’a surtout inspiré car c’est lorsque j’étais enfant que j’ai fait mes premières compositions, et reçu un premier enseignement de la musique par mon père. Puis très tôt, j’ai ressenti un lien spirituel entre la musique et moi. Et en jouant devant un public qui était impressionné de voir l’enfant que j’étais jouer ainsi, ou interprétant des œuvres, je me sentais voyager vers le plus haut. En composant j’étais pris dans quelque chose qui me dépassait. Cela a fait ma joie, mon bonheur d’enfant. Cette lumière éclaire toujours ma vie. C’est à partir de là que j’ai eu des lectures tournées vers le spirituel, vers l’univers, l’humain, je me suis ouvert totalement. Cela a totalement guidé ma vie et fondé l’adulte que j’allais devenir, même si à l’époque je l’ignorais, enfin je me le demande.
M. A. : Karol Józef Wojtyła, dit Jean-Paul II, a durant son très long Pontificat, (26 ans, 5 mois et 18 jours), le troisième plus long de l’histoire catholique à ce jour après ceux de saint Pierre (37 ou 34 ans selon la tradition, non documentée) et Pie IX (31 ans et 8 mois) a délivré à l’humanité un message profondément chrétien. Qu’y a-t-il de plus important dans l’héritage qu’il nous laisse, selon vous ?
J.-F. L. : Il nous a laissé la lumière, il n’a pas éteint lorsqu’il est parti, loin de là. Il a vécu un très long pontificat Jean Paul II. L’athlète de Dieu, comme il fut très justement surnommé, a été debout et un redonné à cette époque une ferveur à tous les chrétiens du monde. D’ailleurs, je suis persuadé qu’il a permis une espérance aux croyants qui n’existe plus aujourd’hui. Ses successeurs n’ont pas eu le même charisme. Je pense que si le message de Jean Paul II aux chrétiens et son héritage fut l’espérance, pour ma part, je suis intimement convaincu que le plus fort de tout ça, toute proportion gardée, dépasse le pape et le christianisme et soit un message, héritage universel de Karol Wojtila nous disant de vivre debout et rempli d’amour. « N’ayez pas peur ». Après avoir abattu des murs et « redessiné » les cartes il a montré un chemin de liberté pour chacun. De la dignité.
Il a incarné le courage qu’il a transmis aux personnes âgées, à la jeunesse, aux malades. Il a été un pape qui a dépassé souvent le cadre religieux, c’est tout l’homme qu’il était, et que je répète encore une fois : L’homme, Karol, était plus grand que le pape Jean Paul II.
M. A. : En tant que musicien, vous jouez dans vos titres de livres, sur le mot « cœur », que vous écrivez aussi « chœur ». La musique hante vos deux livres. Mais aussi les thèmes du courage, de l’amour, de la joie, de la fraternité. Dans un monde où la violence et l’hostilité ressurgissent de manière inquiétante, vous a-t-il semblé urgent de revenir à des valeurs chrétiennes, mais surtout humaines ? Vous avez été Chef de chœur de chorales dès l’âge de 23 ans, c’est donc d’une expérience de l’intérieur que vos écrits partent pour nous témoigner une vie mise au service de la musique, mais aussi de la charité et de l’amour universelle. Vous abordez donc la vie intérieure, à travers des textes qui n’hésitent pas à être intimistes, pensez-vous que les gens aujourd’hui se soucient encore de leur propre vie intérieure ?
J.-F. L. : J’espère de tout cœur que les gens qui forment le « chœur » de ce monde se soucient de leur propre vie intérieure. Elle est leur santé physique, leur grandeur humaine et spirituelle. Je suis persuadé que pour beaucoup aujourd’hui il y a une volonté de ne plus se laisser instrumentaliser par la technologie même si elle nous a pris en otage. Il y a des limites humaines à ne pas dépasser. La vie intérieure permet encore la liberté. D’ailleurs je recommande à toutes et à tous, de prendre rdv avec eux-mêmes, et de se rencontrer pour la première fois pour certains. Car j’ai souvent vu des gens qui voulaient devenir quelque chose ou quelqu’un de célèbre mais qui était en fait des anonymes pour eux-mêmes. Nous devons cultiver notre vie intérieure. Elle nous mènera vers la joie, la réalisation de nos souhaits, l’accomplissement juste de notre vie, et la transmission de l’amour, d’une lumière que l’on porte dans les yeux et qui donnera confiance à ceux que nous croiserons de continuer à vivre dignement et de rendre chacun meilleur.
Notre monde n’a jamais vécu sans guerre, sans haine, sans ignorance. Il faut avoir un regard lucide et également nourrir une volonté acharnée de bâtir l’amour chaque jour. Il y a mille raisons futiles et injustifiées de se quereller, et je me suis toujours intéressé aux deux ou trois choses sensées qui nous rassemblent. Le soleil m’émerveille, la nuit m’enrichit de sérénité ou de rêves multiples. Contemplons ce qui nous est offert. Ne nous obstinons pas à vouloir devenir star lorsque nous n’avons pas encore fait l’effort de lever la tête et d’observer une étoile et la grandeur de l’univers. La vie n’est pas de creuser des tombes mais d’élever les êtres. Il faut lâcher la pelle et passer à l’Appel.
Les valeurs qui me portent viennent de mon éducation, de mes parents. Mon père, immigré italien, arrivé en France en 1953 avec sa famille, s’est intégré par les valeurs du travail et de la famille. De petits boulots manuels et « forcés », en formations diverses, il a arpenté une France qui exigeait une carte de séjour stricte, les italiens n’étaient pas les plus gâtés. Après avoir fait des études au Séminaire en Italie, et à avoir appris le français chez lui, il se destinant à enseigner. Puis une Italie fragile et l’histoire en ont décidé autrement. Au début, il s’est adapté en France à ce qu’on lui a permis de faire : l’agriculture, la mine ou le bâtiment. N’ayant pas les mains du travailleur, car plus intellectuel, cela a été un moment difficile où il s’en est sorti par sa persévérance et le devoir de réussir. Se mariant à une française, ma mère, il a ensuite gravi les échelons de la société, et a ouvert une auto-école qu’il a tenu 42 ans, puis une société de transports. Comme pour beaucoup, on ne nous a rien fait cadeau. Mais mon père me disait que le cadeau c’était la vie et qu’elle nous donnait tout. Alors nous avons aimé éperdument la vie, nous nous sommes engagés dans l’amour des gens, la culture de la joie et du partage. J’ai grandi au son de l’accordéon de mon père dans l’allégresse absolue. Nous avons été conscient de la chance que nous avions, et de la fragilité de tout. Nous vivions fixés sur un cap, un rail, on avait la locomotive, les wagons, et la gare. Mes parents étaient la locomotive, les wagons ce que l’on faisait et notre potentiel, la gare, notre maison familiale. Un équilibre parfait. Des échecs, oui, beaucoup car nous n’arrêtions pas d’essayer des choses, de faire, de créer, d’avancer et de se former. Une vie saine qui allait me mener à la scène pour la partager. J’avais compris que : le soleil se lève tous les matins, et que si nous comptions sur les hommes pour le lever, nous vivrions dans le noir, l’obscurantisme le plus total ».
J’ai connu des moments de doute, la trahison, de façon plus rare la calomnie, mais il faut accepter lorsqu’on est dans l’action le fait de ne pas plaire. Ce que vous ne bousculez pas, vous renverse. Nous devons tenir la barre de notre navire avec autorité et respect de chacun. On a tenté plus d’une fois de me déstabiliser, de faire diversion. J’ai tenu le cap car j’étais sain et propre.
Mon expérience de chef de chœur a été une révélation, quelque chose d’irrationnel et même temps un lien entre la terre et le ciel. Le chant choral m’a toujours touché, plus encore bouleversé de sa grandeur, du voyage qu’il vous permet de faire. Dès mon enfance, je fus touché par la voix et les voix, l’harmonie. Lorsque l’on mêle son et sens, c’est l’essence même de ce qui nous porte. J’aimais secrètement le chant choral. Je n’ai jamais voulu devenir chef de chœur et je n’ai jamais appartenu à une chorale avant de le devenir. C’est arrivé par hasard, on est venu me proposer la direction d’une chorale, puis deux, puis trois. Sans vous mentir, cette expérience n’a rien eu d’artistique pour moi, elle fut initiatique, je l’ai mise sur un niveau si haut que cela m’a fait lever ma tête et mes yeux et j’ai grandi, bien plus encore, me suis élevé. Même si jusque-là j’avais toujours regardé la vie avec les yeux de l’amour, la lumière et le lien avec l’invisible a été plus haut. J’aime sincèrement les gens. Je crois en l’humanité, en l’amour.
J’ai toujours été impressionné et surtout transcendé par les voix, le chant polyphonique ou à l’unisson. Lorsque j’entendais des moines et leurs chants, cantique ou autres, résonnant des murs historiques d’un monastère, cela produisait en moi quelque chose d’indescriptible. Je me suis aussi intéressé et ému à l’écoute de chants bulgares en qui je trouvais une puissance intérieure intense. Du coup, mes lectures se sont même étendues à Omraam Mikhaël Aïvanhov.
Je trouve que le chant choral apporte la dignité, il est un appel, son équilibre nous guide. C’est une discipline qui vous libère, et l’écouter vous transmet l’harmonie et la paix. J’ai associé à cette expérience de chef de chœur le désir de rester bénévole pour qu’elle soit totalement humaine, désintéressée, pour mieux respecter et apprécier cette étape inattendue qui m’était offerte. Même si j’ai eu l’honneur de voir l’une des trois chorales me verser une indemnité. Je la reversais dans mes actions humanitaires. Je vais vous avouer quelque chose, je ne me suis pas enrichi à une époque où on me proposait des contrats, mon but était autre, les amis me disaient pense à toi, ils travaillaient pour l’argent, ce qui peut être respecté et compris, mais ma volonté était ailleurs, j’étais l’homme le plus riche du monde, je faisais ce que j’aimais, je réalisais chaque jour un rêve d’enfant, celui de m’accomplir, de grandir, de servir. On ne pouvait pas me voler, ce que j’avais était en moi. Et j’ai toujours eu le désir de donner. Je ne me suis jamais appauvri en partageant.
Beaucoup cherchaient la lumière, moi j’étais modestement engagé à éclairer là où il n’y en avait pas. La musique pour moi est une passion, un rêve, une respiration, un métier. un alibi même, allez savoir. C’est l’instrument qui me permet de délivrer le message suprême de l’amour et de partager. Ma vie se résume à cela.
M. A. : Vos deux ouvrages sont des livres de paix et de fraternité. Vous vous servez beaucoup des principes de la religion chrétienne, notamment lorsque vous vous racontez en évoquant Jean-Paul II. Pianiste, compositeur, commandant de réserve, vous vous êtes engagé dès votre plus jeune âge dans l’humanitaire et les associations caritatives. Votre livre sur Jean-Paul II s’intitule L’homme a la valeur de son cœur. Vous dites d’ailleurs qu’après un drame personnel désormais vous entendez avec le cœur. Que voulez-vous nous dire par-là ?
J.-F. L. : Oui j’entends avec le cœur aujourd’hui, après avoir regardé le monde avec le cœur pendant toute ma jeunesse, avec tant d’amour, il m’est arrivé quelque chose au milieu de la quarantaine qui a touché ce que j’avais de plus cher : mon oreille. J’ai perdu une bonne partie de mon audition, si bien que j’ai dû adapter ma vie professionnelle et sociale à cet incident. Ce fut un bouleversement total et douloureux, de ne plus entendre le chant des oiseaux le matin, en même temps une autre façon de vivre est née. je me suis moins exposé, je me suis organisé des moments de solitude plus long, moins d’échange direct, mais encore plus d’amour et de perception du monde. Ce dont j’ai toujours été convaincu m’est arrivé. Il est plus important de ressentir que d’entendre. Sauf que je ne suis plus en mesure d’entendre le chant des oiseaux. C’est dramatique. Heureusement, la technologie avec les appareils m’a sauvé et permis la possibilité d’entendre la voix de mes enfants à leur naissance.
Mon sens inné de l’adaptation m’a permis de me remettre dans une autre réalité. Nous sommes plus fort que nous croyons, et nous avons toutes les réponses en nous. Souvent on cherche la pilule miracle, elle est en nous.
Enfant, adolescent, j’écoutais des heures de musique au casque, à fond, comme on disait, alors on dit que ça vient aussi de là… mais que voulez-vous, tout ce que j’ai fait je l’ai fait à fond.
J’ai été élevé dans une famille catholique mais ouverte sur le monde et les différences. C’est en cela que j’ai apprécié Jean Paul II. Mon engagement s’est imposé à moi très tôt, c’était à la fois un accident et une chose naturelle, je l’avais en moi. Mes parents sont gaullistes, ils ont vécu ces moments avec le général, toute une époque. Ensuite j’ai eu la chance de rencontrer Pierre Messmer, il m’aimait beaucoup, lorsque j’étais adolescent il me faisait jouer avec mon accordéon pour les personnes âgées du côté de Sarrebourg en Moselle, commune où il était maire. Lorsque cette homme, compagnon de la libération ou encore ministre du général de gaulle me parlait du général, c’était quelque chose. J’ai été habité par l’essentiel dès mon enfance. Je me suis questionné toute ma vie sur le côté mathématique de la vie, son fonctionnement, et le côté spirituel, l’invisible. J’ai été marqué par deux personnages : Wolfgang Amadeus Mozart et Léonard de Vinci. Ce dernier avec sa capacité à joindre l’art et la science m’a fasciné, il incarne encore aujourd’hui la recette ultime de l’innovation. C’est cela qui m’a poussé aussi de suivre ma formation à l’École Polytechnique sur l’innovation. La spiritualité, la musique, les mathématiques, ou encore les lettres… La plus forte énergie qui m’a guidé est la créativité.
M. A. : Nous avons pensé pendant au moins 70 ans, que la paix perpétuelle de Kant avait enfin connu le jour en Occident. Les dramatiques événements qui touchent l’Ukraine aujourd’hui, et la guerre à nos portes en Europe, remettent en question nos dogmes. Vous militez dans vos livres pour la paix entre les hommes, vous êtes vous-même un homme de paix, pensez-vous qu’il puisse être possible, que le monde qui est gouverné par les passions et les désirs, puissent un jour trouver un peu de sagesse en lui ?
J.-F. L. : Kant que vous citez me parle. D’abord par un travail expérimental de création musical que j’avais accompli sur son œuvre en 1991 « l’Esthétique transcendantal », car l’étude a priori de la sensibilité à savoir l’espace et le temps m’a toujours préoccupé. Et cette « paix perpétuelle » … qui a inspiré bon nombre de chef d’État. On a pu lire beaucoup de passionnants ouvrages sur la paix, mais Kant à cette époque évoquait davantage de liberté humaine que d’autres… C’est vous le maître ici en philosophie Marc Alpozzo, je vous admire et la philosophie a donné du relief à ma vie, un espace.
Pour maintenir la paix, il faut être en capacité de se défendre et le faire savoir. Là, c’est le commandant de réserve qui parle. Il y a une réalité implacable dans la nature humaine, celle du poids de la dissuasion.
La paix est fragile dit-on. Ce dont je suis sûr est que le plus fragile est l’humain. Je suis lucide, bien plus que mes écrits ou musiques ne pourraient le traduire. Si vous saviez combien j’ai craint toute ma vie la guerre au regard des récits de mes parents qui l’ont vécu et des anciens combattants qui m’ont transmis tant de témoignages bouleversants.
Ce monde gouverné par les passions et les désirs comme vous le dites n’est finalement que le quotidien des hommes. Ils aiment se brûler les ailes qu’ils n’ont pas. Ah ! si seulement nous serions ces oiseaux pouvant voler sans rien prendre. Dans leur ciel, il y a aussi des rapaces. La vie revient toujours à un degré de puissance, de domination, mais si nous pouvions seulement convertir cette force à l’amour, l’enseigner et inonder les êtres, les contaminer, une pandémie dont le simple vaccin serait un regard « divin ».
Revenons sur terre, touchons le sol avant les cœurs pour être cohérent et en phase avec notre monde moderne. C’est par les actes, même les plus petits, au quotidien que nous pourrons améliorer le monde, par l’exemple. Il faut envisager une liberté personne qui n’entrave pas celle de notre semblable.
Quand vous allez dans des pays comme la Chine, la toile est éducative, chez nous distractive. Certains appellent ça de la liberté, mais c’est notre prison. On s’éloigne de nos priorités et de nos vies en regardant ce qui est ineptie et pire encore. Notre jeunesse ne se forment plus ou pas assez, le niveau intellectuel baisse. Il suffirait peut-être à cette génération rivée sur les écrans à se divertir, se faisant piéger par la diversion, d’ouvrir un livre et de lire. Cela les ramènerait à la vie, aux fondamentaux, à eux, et à la paix.
C’est là, que je suis convaincu que l’art, la musique, la lecture, la philosophie, sont des éléments qui sauveront le monde et qui permettront à l’humanité de rester debout et de vivre ensemble.
J’ai entamé depuis mon plus jeune âge une promotion du Devoir de Mémoire. Je suis convaincu que la sagesse, la paix, la liberté se trouvent dans la Mémoire, c’est pédagogique.
Merci de cette interview plus encore de ce partage.
Propos recueillis par Marc Alpozzo
Argumentaire de « Koeur » de Sylvie Largeaud-Ortega
Argumentaire de « Entre deux mondes » de Gilles Cosson
« Surchauffe – L’inflation ou l’enflure économiste » de Romain Kroës
« L’Union européenne et la guerre », par Pierre Ménat ancien conseiller Europe de Jacques Chirac
« il était japonais, vraiment japonais, même s’il a rêvé de devenir plus universel » sur « Vents contraires » de Jean-François Kochanski
Jean-François Kochanski, Vents contraires

C’est un récit de guerre et de bâtardise que nous livre l’auteur, ancien des salles de marché trésorerie de la BNP et vivant désormais au Japon. Comment Kurusu Ryo, appelé Norman, fils de diplomate japonais et d’une Américaine, a vécu sa japonité au Japon durant les années de nationalisme exacerbé de la Seconde guerre mondiale. Né en 1919, Ryo-Norman a eu 18 ans en 1937 mais n’a vécu au Japon qu’à l’âge de 8 ans. Son apparence gaijin, nettement occidentale, détonnait parmi ses pairs et, étant enfant, sa façon de parler aussi. Il a dû se battre pour s’imposer. Plus grand et plus costaud que ses camarades élevés au riz et aux légumes, il n’a pas tardé à se faire respecter, puis à s’intégrer dans le groupe.
Car l’auteur, qui reconstitue sa courte vie à partir d’archives privées de sa famille, de témoignages de guerre et de livres publiés, s’ingénie à faire comprendre le Japon, premier pays développé non-occidental, et sa mentalité îlienne de forteresse assiégée, très conservatrice et méfiante envers tout étranger (même Coréens). Norman, prénom américain, fut bientôt réservé à l’intimité familiale, délaissé socialement au profit du seul Ryo, prénom japonais. Le garçon devenu jeune homme se destine à l’ingénierie aéronautique, en plein essor au Japon industriel ; il deviendra en même temps qu’élève-ingénieur un élève-officier, tant le totalitarisme impérial nippon des années 1930 et 40 enrôlait toute la population dans un nationalisme fusionnel, à la manière nazie.
Être le seul officier métis de l’armée de l’air japonaise, et qui plus est d’apparence physique occidentale et parlant parfaitement anglais, est une performance. Que les Japonais l’aient accepté, avec plus ou moins de réticence ou de retard, est une gageure. Ryo a dû être meilleur en tout, aux études comme aux sports, et il n’a dû le respect du clan que parce qu’il savait battre ses plus acharnés détracteurs au kendo, l’art martial du sabre qui est l’essence du Japon.
Cette histoire vraie reconstituée, romancée seulement pour faire liaison ou s’imprégner de l’ambiance, serait plus lisible si elle avait été relue par un éditeur véritable. Les mots mal orthographiés ou mis pour un autre (haut-vent pour auvent, hôtel pour autel, tache pour tâche…), les fautes d’accord, les constructions de phrases bancales et les virgules placées au petit bonheur font se demander si l’écriture n’a pas été finalisée par une IA, genre traducteur automatique de l’anglais au japonais puis en français… Comment comprendre, par exemple, cette phrase : « Une certaine dissonance s’exposant à tous, troublait sans le vouloir l’unisson pouvant les lier » p.51 ? Il y en a beaucoup d’autres de ce type.
Outre un récit de guerre, une vue du Japon conduit malgré lui vers la défaite, l’auteur s’intéresse avec raison à l’écartèlement des « races » – on dirait aujourd’hui les « cultures » sans que cela change quoi que ce soit. Le physique et la mentalité américaine sont très différents du physique et de la mentalité japonaise : que fait-on lorsqu’on est mixte ? Le garçon choisit papa, parce qu’il est estimable et qu’il l’aime, mais ce n’était pas gagné. Le père, diplomate ancien ambassadeur à Berlin puis en Belgique, au Pérou, a tenté l’ultime négociation de la dernière chance entre États-Unis et Japon, d’ailleurs condamnée d’avance à l’échec puisque l’attaque de Pearl Harbor était déjà programmée. Il s’est infligé le déchirement de ne pas garder son fils avec lui durant ses années d’apprentissage, au contraire de ses filles. Il a voulu pour le garçon une éducation entièrement japonaise et non internationale selon ses postes diplomatiques. D’un corps occidental il a voulu faire un vrai japonais. Il y a réussi. « Sans une identité, un avenir ne peut être construit », dira-t-il à son fils jeune adulte, « mon fils, ton sang et ton cœur sont japonais » p.163.
Tragédie des métis, écartelés entre deux cultures. Il faut en choisir une tout en gardant la force de l’autre, mais le vent doit souffler dans une seule direction sous peine d’être déboussolé, voire psychiquement malade (comme trop de Maghrébins le montrent à l’occasion d’un fait divers). Le capitaine d’aviation Ryo Kurusu fut « tué au combat » sur un aérodrome militaire japonais par une hélice qui lui a arraché la tête dans les derniers mois du conflit, un accident malheureux. Il a vécu tourmenté mais courageux, il a servi avec honneur un régime pourtant fourvoyé. Mais il était japonais, vraiment japonais, même s’il a rêvé de devenir plus universel.
Jean-François Kochanski, Vents contraires, 2022, AZ éditions Content Publishing, 201 pages, €18,00 e-book Kindle €9,99
Attachée de presse BALUSTRADE : Guilaine Depis, 06 84 36 31 85 guilaine_depis@yahoo.com
Une belle page de Gilles Brochard sur le livre d’Isée St. John Knowles (Coco Chanel) dans Eco Réseau Business
Une belle page de Gilles Brochard sur le livre d’Isée St. John Knowles

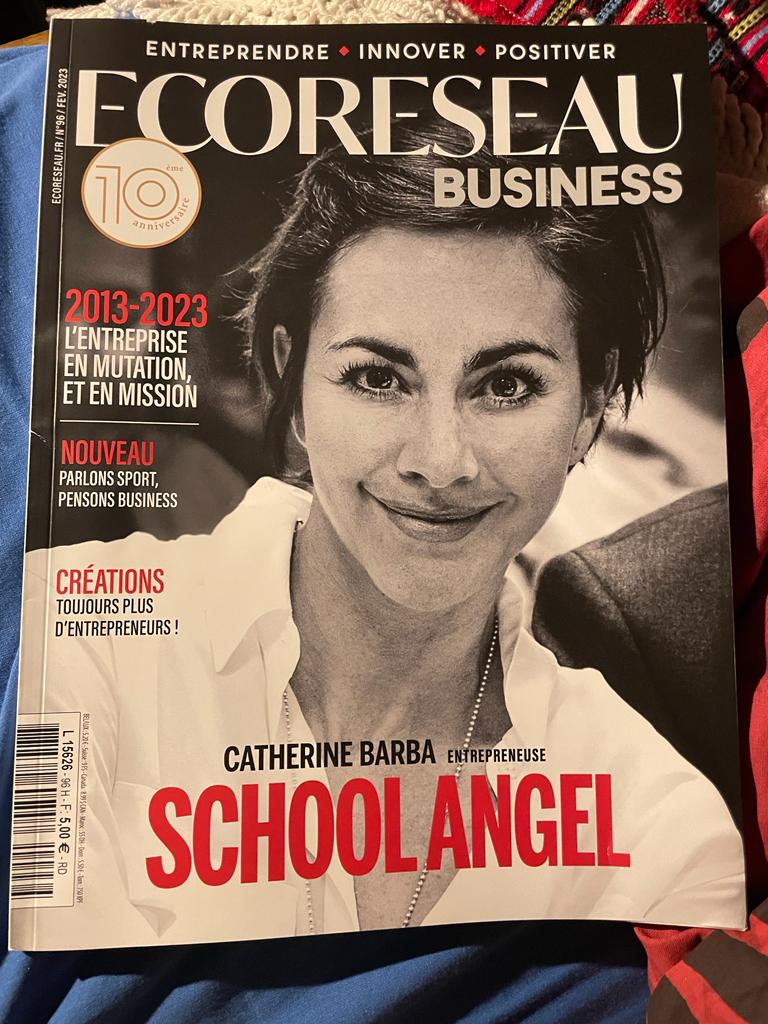
Christian de Maussion, auteur de « La fin des haricots » fait son entrée dans Front populaire
 Christian de Maussion, auteur de « La fin des haricots » fait son entrée dans Front populaire
Christian de Maussion, auteur de « La fin des haricots » fait son entrée dans Front populaire
Le Candidat
« Qu’ils viennent me chercher ! » Curieux appel qui n’a rien de gaullien. Le texte du Général était une invitation au voyage rimbaldien, bohémien : l’indépendance nationale. L’un s’adresse aux hommes libres, l’autre invective les gueux.
De Gaulle enseigne le savoir rudimentaire, testamentaire, d’un père. J’ai été élevé dans la terreur de subir. Macron détricote une passion, déboulonne une grandeur. La subordination est un horizon de haute trahison. L’addition des manquements bricole un simulacre de politique. Pas de cap, pas de parole. Pas d’industrie, pas d’énergie. Pas d’espoir, pas d’avenir.
L’épisode burlesque des introuvables masques allégorise la somme de tous les renoncements.
Une fois le livre achevé, j’ai été saisi par un vers de Pasolini qui m’a émerveillé : « La connaissance est dans la nostalgie ».
Oui, « La fin des haricots » témoignent d’un cri qui est celui de la nostalgie. Un cri de scrogneugneu. Avant, c’était mieux. Il y avait davantage de soin dans le travail ouvragé. L’éditrice du livre m’a confié que le livre « ne manquait pas d’humour ». On attribue souvent à Boris Vian une phrase qui appartient à Chris Marker, le poète cinéaste : « L’humour est la politesse du désespoir ». Cette politesse du désespoir, je l’ai baptisée, moi, avec mes propres mots paysans : « la fin des haricots ».
Il salit la mémoire du Général. Il dénature mes souvenirs de Boris Vian. Sa ressemblance de figure altère mon humeur. Car ce livre est une œuvre de colère. Durant la débâcle de 40, il est des soldats qui décidèrent d’instinct, sans réfléchir au péril, que la reculade était odieuse, qu’il fallait rompre avec la dégringolade, enrayer l’humiliation et repartir à l’assaut. Ils sont morts dans l’honneur.
Le théâtre des opérations, la réalité, le terrain comme ils disent. Le « terrain » est un lieu d’exotisme, peut-être même une utopie, une lointaine contrée inexplorée, sans doute une vue de l’esprit, située au bout du monde ministériel. Il fascine le souverain qui soliloque ses vœux du trente-et-un. L’homme fenêtre de la saint Sylvestre exprime le souhait de s’encanailler dans les bourbiers, de s’introduire « au plus près du terrain ».
A vrai dire, le terrain était demeuré une terra incognita du premier mandat. Mais depuis Mbappé au Qatar, le prince sait désormais fouler les terrains sans crier gare. Il a compris que le terrain est aux politiciens ce que l’atome est aux physiciens. Il lui appartient de s’aventurer toujours plus loin dans les mystères de la boueuse matière humaine. Il lui incombe d’aller débusquer les neutrinos du terrain, de percer le secret des portées d’engueulade.
Les ploucs et les sous ploucs, qui gîtent au diable dans des coins paumés, peuplent un terrain merdique, inflammable à la première connerie, à la première ânerie de petit marquis de l’Ena.
Ces ethnies de la périphérie se lassent des selfies des explorateurs de la préfecture. Les analphabètes photographiés par les messieurs des ministères, en service commandé de tourisme humanitaire, s’impatientent un peu. La gent illettrée des pourtours d’Elysée ne se satisfait pas des seules joggings républicains, des pieuses marches blanches du dimanche.
Le terrain, c’est comme l’atome. A vouloir le taquiner, on s’expose à des risques de fission. Quand on le casse, lui casse les pieds, l’enquiquine à l’excès, quand on roule le boulanger dans sa propre farine, il déferle en nombre dans les cités, s’éparpille dans les centres-villes comme un peuple illégal d’immigrés indésirables.
Mai 2017 : Maria est la reine du palais, la maîtresse de l’Atlas. Elle nous traite aux petits oignons, dresse une nappe devant l’horizon. La ronde Andalouse sert une soupe au poivron vert face au soleil du désert. La journée claudique. C’est la soie du soir qui se pose sur la peau.
Maria s’applique à sa besogne, chasse les miettes et les mouches, nous interroge d’un mauvais œil. La cuisinière est cachottière. Son sourcil noir délimite une frondeuse bouderie. Elle mord sa lèvre, faute d’extraire le mot qui colle à sa colère. Maria met les pieds dans le plat.
« Il n’a pas beaucoup de charisme, votre petit caudillo. Ses yeux sont trop bleus. Des pommes ici, sur les marchés, on dit qu’elles sont trop vertes. »
La soupe de Maria me rappelle celle de Nicolas de Staël, le type d’Antibes, les derniers soirs, comme une prière, un bénédicité, une fixité. Maria, sous le grand ciel de Chouiter, nous révèle un mystère, confie sa joie, fait du gazpacho le choix de notre écuelle. Maria s’est retranchée dans ses quartiers.
Elle dit ce qu’elle pense, je pense à ce qu’elle dit. Je me résume. J’ai voté Lance Armstrong, un champion cycliste à sourire métallique. M’emballe moyennement le symbole pyramidal, dans le dos du jeune homme qui pédale.
Le Candidat est un échec cuisant pour Flaubert. L’ermite de Croisset se distrait d’un gros chantier – Bouvard et Pécuchet – en s’exerçant aux tirades de comédies, en composant une sorte de poème politique. La pièce est jouée quatre soirs d’affilée sous les sifflets et quolibets. On aurait dit du Ionesco, venu trop tôt. Car, avec le bourgeois, Flaubert s’en donne à cœur joie.
Rousselin souffre d’une ambition. Il prétend à la députation. C’est un candidat d’élection. Au deuxième acte, scène XI, il se définit sous les traits d’un Macron d’aujourd’hui :
– Pourquoi toujours ce besoin d’être emporte-pièce, exagéré ? Est-ce qu’il n’y a pas dans tous les partis quelque chose de bon à prendre ?
– Sans doute, leurs voix !
Murel, son conseiller, capitaine d’industrie, opine du chef, impose sa loi. A ne se revendiquer d’aucune identité, Le Candidat de Flaubert est d’une extrême modernité. Rousselin a faim, mange à tous les râteliers. Il est aussi légitimiste que Bouvigny et libéral que Gruchet, l’un et l’autre rivaux.
L’argent de Murel finance L’Impartial, journal qui exhorte à ne pas voter mal. Murel fourgue au passage ses éléments de langage : « Il faut bien que je rebadigeonne votre patriotisme ! » (Acte deuxième, scène XII). Rousselin cause au peuple comme à des orphelins sans fifrelins : « On doit, autant que possible, démocratiser l’argent, républicaniser le numéraire » (Acte troisième, scène II). Or, du numéraire au numérique, il n’y a que quatorze décennies d’histoire, le temps de rafraîchir Rousselin, d’en extraire un Macron magicien.
Au dernier acte, Pierre, le domestique de Rousselin, se fiche comme d’une guigne de la commission de contrôle des comptes de campagne : « Rien ne coûte, vu la circonstance ! Ce soir l’élection, et la semaine prochaine, Paris ! » Rousselin est l’ange annonciateur de notre Emmanuel marcheur : « Il est absurde d’avoir des opinions arrêtées d’avance » (Acte quatrième, scène II). Candidus veut dire blanc en latin. Le candidat est la somme de toutes les couleurs, y compris politiques.
Certains de mes livres trouvent une issue littéraire dans la mémoire, des souvenirs recomposés, une vie morte reconstituée. D’autre s’imposent à moi, heurtent de plein fouet une écriture, se présentent tels quels comme des modèles à figurer.
Ce sont des croquis d’aujourd’hui, extérieurs au for intérieur. « La fin des haricots » en prolonge les traits, fait écho à l’art des portraits. Il appartient au deuxième style, rosse et féroce. Car je ne considère pas comme fortuit le mot rire dans celui d’écrire. Rire et écrire procède du même élan, du même tourment, d’un même ricanement.
Ce dixième ouvrage se situe dans le droit fil d’un premier livre consacré à de Gaulle. Il témoigne d’un retour aux sources. Il s’affiche comme la chronique urticante d’un fiasco national.
Les personnages publics dont j’évoque les agissements fugitifs, dont je mentionne les noires impérities, obéissent au monde enfantin de la bande dessinée.
A vrai dire, j’observe un théâtre, non pas absurde mais burlesque, où l’acteur au pouvoir endosse la caricature comme une deuxième nature. Je regarde comment s’agitent les chefs à savoir bref.
L’actuelle gestuelle mécanique du pouvoir, à cadence saccadée, renvoie à des saynètes d’un cinéma disparu, aux délires de Louis de Funès, Tati, Chaplin, Keaton, Sennett ou Harold Lloyd. Le genre politique selon Macron ressortit de l’art burlesque.
Pour nous les gueux, les yeux de président n’étaient jamais bleus. Naguère, les regards n’étaient pas clairs. Ils étaient noirs. De de Gaulle à Hollande, l’œil de deuil prévalait. Avec Macron, la République change de prunelle comme de chemise, ou de paradigme. Elle impose une transparence glaciaire. Elle nous fusille du regard.
Jadis Hallier taxait Giscard de « colin froid ». Or aujourd’hui le pays est gouverné par un trio de colins hyper froids : Macron, Borne, Lemaire. Manu, Lili, Nono ont les yeux trop bleus. Glagla. Froid dans le dos. Ils nous réfrigèrent pour l’hiver.
C’était hier. A la table du conseil des ministres, on dénombre quatre présidents. De Gaulle est entouré de Pompidou, Giscard, Chirac. A sa droite André Malraux, « l’ami génial ».
Dans « Lettres à Roger Nimier », Jacques Chardonne apparente une assemblée de ministres à une « espèce de jet d’eau au centre de la capitale ».
Autour de Humble 1er, la magie hydraulique des fontaines atteint son paroxysme théâtral. Les ministres d’aujourd’hui pressentent qu’ils seront un jour président. Quatre d’entre eux, peut-être. Titulaire compris. C’est le record à battre.
Sous Humble 1er, le personnel a été renouvelé en grand. Personnellement, je vois bien Christophe Béchu à l’Elysée. Et même, plus tôt que prévu. Bérangère Couillard a ses chances. Marc Fesneau peut déjouer les pronostics. A moins que Rima Abdul-Malak ne décroche elle aussi la timbale. A vrai dire, on a l’embarras du choix. Les talents sont là.
Bref, le peuple se sent à l’étroit dans le nombril du monarque.
Christian de Maussion, essayiste, auteur de « La fin des haricots » (5 Sens Editions, décembre 2022)
« La fin des haricots » est sous-titré : « Chronique d’un fiasco national : 2017/2022 »