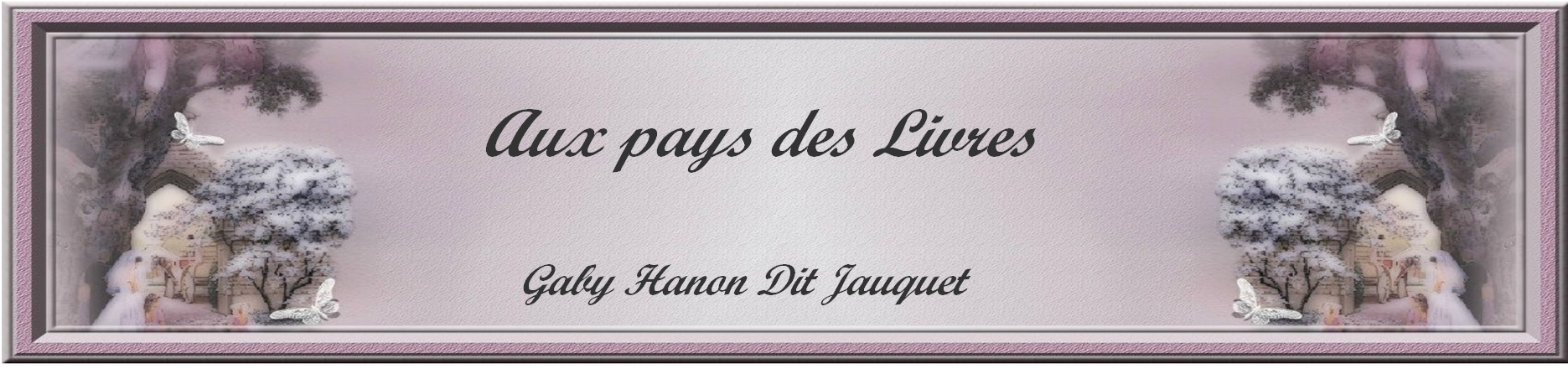Anne Bouillon rend au yoga la philosophie
Anne Bouillon est docteur en philosophie et est l’auteur de Gilles Deleuze et Antonin, l’impossibilité de penser, essai magistral sur deux êtres crucifiés par la vie, la maladie et le suicide. Elle a écrit également de nombreuses chroniques dans divers manuels scolaires, magazines ou sites Internet.
https://www.youtube.com/watch?v=MSZk-SHqidw&feature=emb_logo
 Après dix années d’enseignement universitaire, elle a décidé de prendre des chemins de traverse, comme dirait Deleuze, et vient de fonder un nouvel art original et fécond, fusion entre le yoga et la philosophie qu’elle exerce donc sous le nom de Gymnosophie, inspiré par les Présocratiques, notamment Parménide, à qui Platon attribuait la paternité de la philosophie, Héraclite l’obscur et Hippocrate lui-même, celui au nom de qui les médecins prêtent serment. Anne Bouillon se fait fort d’apporter du mieux-être aux Parisiens qui pratiquent avec elle cette discipline renouvelée, au nom fort ancien dont Platon évoquait lui-même l’importance pour retrouver l’équilibre entre le corps et l’esprit, retrouver son unité.
Après dix années d’enseignement universitaire, elle a décidé de prendre des chemins de traverse, comme dirait Deleuze, et vient de fonder un nouvel art original et fécond, fusion entre le yoga et la philosophie qu’elle exerce donc sous le nom de Gymnosophie, inspiré par les Présocratiques, notamment Parménide, à qui Platon attribuait la paternité de la philosophie, Héraclite l’obscur et Hippocrate lui-même, celui au nom de qui les médecins prêtent serment. Anne Bouillon se fait fort d’apporter du mieux-être aux Parisiens qui pratiquent avec elle cette discipline renouvelée, au nom fort ancien dont Platon évoquait lui-même l’importance pour retrouver l’équilibre entre le corps et l’esprit, retrouver son unité.
Selon Anne Bouillon, tous les problèmes nouveaux sont en fait très anciens : yogis, philosophes, penseurs et sages de tous pays et de toutes cultures les ont déjà portés et ont fourni des éléments de réponse.
Le mot sanskrit yoga signifie « relier » « unir ». Son contraire, la maladie, se nomme dans cette langue antique Roga. Yoga et Roga, on voit ainsi que la pensée indienne, à l’instar de la grande métaphysique occidentale, aime manier l’art du paradoxe, et pour y répondre, a développé l’idée du philosophe-médecin.
Fidèle à la tradition, Anne Bouillon nomme les asanas (postures de yoga) en sanskrit, car ces termes sont plus signifiants, profonds, essentialistes, si l’on veut, moins pâles que leurs traductions en Français ou en Anglais ; néanmoins elle enseigne un yoga occidental, ne se prétendant pas gourou, initié ou guide spirituel, mais ayant à cœur la quête de plénitude de ses contemporains.
Cette nouvelle approche du yoga apporte bien plus qu’un sport : elle permet de se retrouver, de se ressourcer et de découvrir en soi-même sa part de sacré.
Connais-toi toi-même
Yoga et philosophie visent la même connaissance de soi, le connais-toi toi-même de Socrate étant mis en exergue. Mais pour cela, il faut s’offrir du temps pour soi, afin qu’unies, philosophie et yoga donnent un sens à la vie, autrement, permettent de retrouver son propre centre.
Les postures du yoga ne sont qu’un moment de cette discipline ; lire des textes philosophiques ou mythologiques, se les approprier, les questionner, élaborer sa propre pensée en font également partie. Par exemple, quand il est difficile de méditer, une citation que l’on aime ou un poème, peut dans un premier temps servir de support à la concentration (dharana) qui rend ensuite possible la méditation (dhyana). La classe de Gymnosophie donne donc des clés, des outils, des réponses.
Les guides spirituels d’Anne Bouillon sont non seulement Gilles Deleuze et Antonin Artaud, qui, avec Spinoza, lui ont fait se poser la question de savoir quelles sont nos possibilités physiques et psychiques propres : et la réponse du yoga lui a fait comprendre que l’on pouvait, plutôt qu’à partir de l’intellect (celui de l’exigent Doctorat de philosophie), aller du plus grossier, du plus apparent, le corps physique, vers le plus subtil, afin de mieux se connaître soi-même à défaut de répondre à l’inéluctable question « Qui suis-je ? » Et pourtant, c’est Nietzsche qui propose une synthèse de cette enquête anthropologique avec son « corps je suis tout entier » – et nous voilà entièrement présent sur notre tapis de yoga – bien choisir son tapis semble alors très important !
La séance comprend un temps dédié sans jugement aux questions et aux réponses, pour tirer la synthèse de cette « leçon ».
Anne Bouillon reçoit en petit comité (sept personnes maximum) dans un magnifique appartement parisien : Chez Marguerite, au 14 avenue Victoria (Châtelet) – www.chezmargueriteparis.com (horaires et réservations).
Son propre site sera en ligne courant décembre : www.lagymnosophe.com, et en attendant, vous pouvez la retrouver sur sa page Facebook – La Gymnosophe, sur Instagram, la_gymnosophe, ou lui écrire à cette adresse : annegymnosophe@gmail.com, pour les cours particuliers ou les cours en entreprise. Anne Bouillon se déplace partout dans Paris.
Christian de Moliner
Crédit photo : DR
[cc] Breizh-info.com, 2019, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine
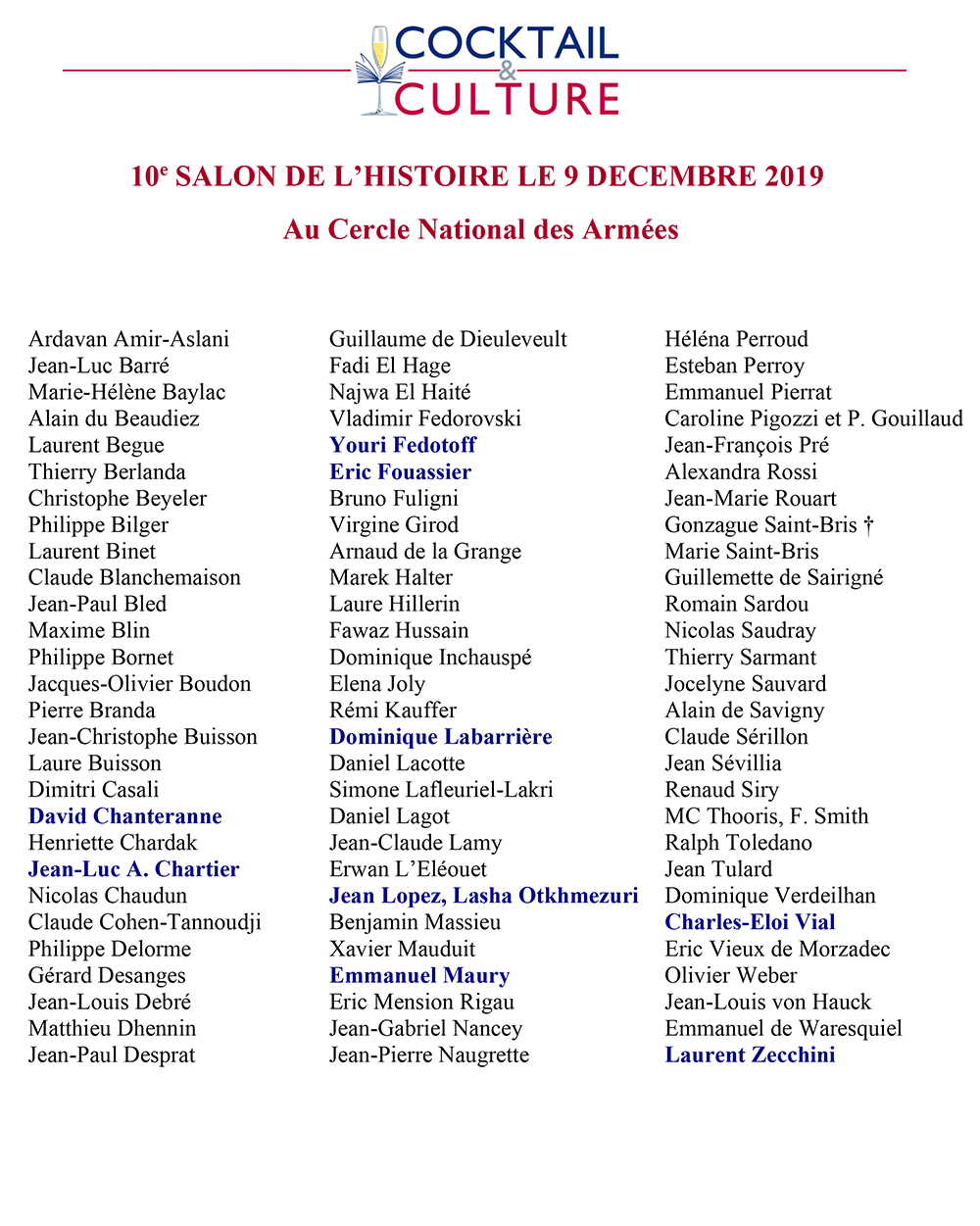
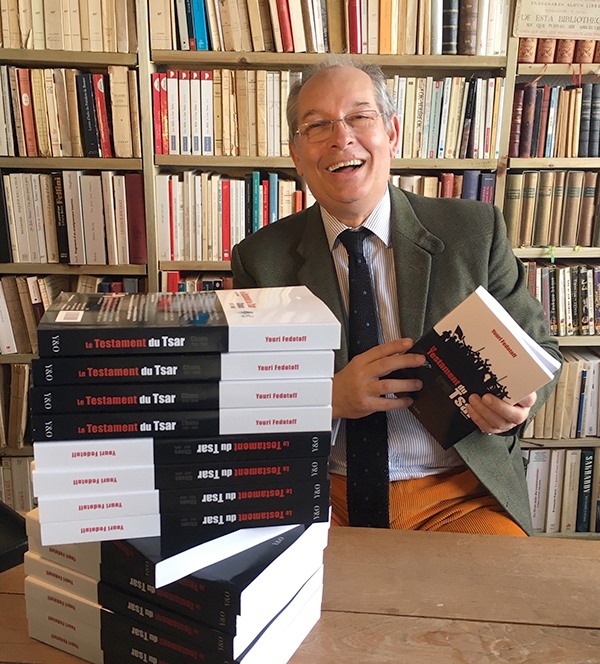

 La Défense d’aimer ou lorsque quarante ans seront passés
La Défense d’aimer ou lorsque quarante ans seront passés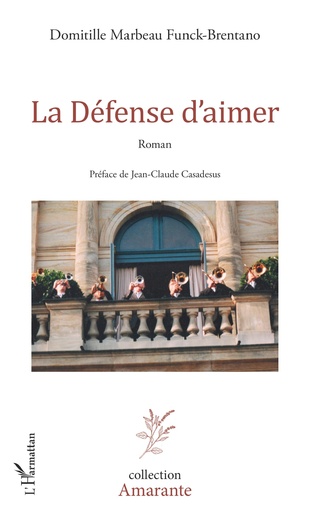 Pour témoigner du Ring du Centenaire, il y avait eu Histoire d’un « Ring », splendide ouvrage d’images et de mots (dont le beau texte de
Pour témoigner du Ring du Centenaire, il y avait eu Histoire d’un « Ring », splendide ouvrage d’images et de mots (dont le beau texte de  Version courte de l’interview de Thierry Camille Claudel pour la radio allemande
Version courte de l’interview de Thierry Camille Claudel pour la radio allemande
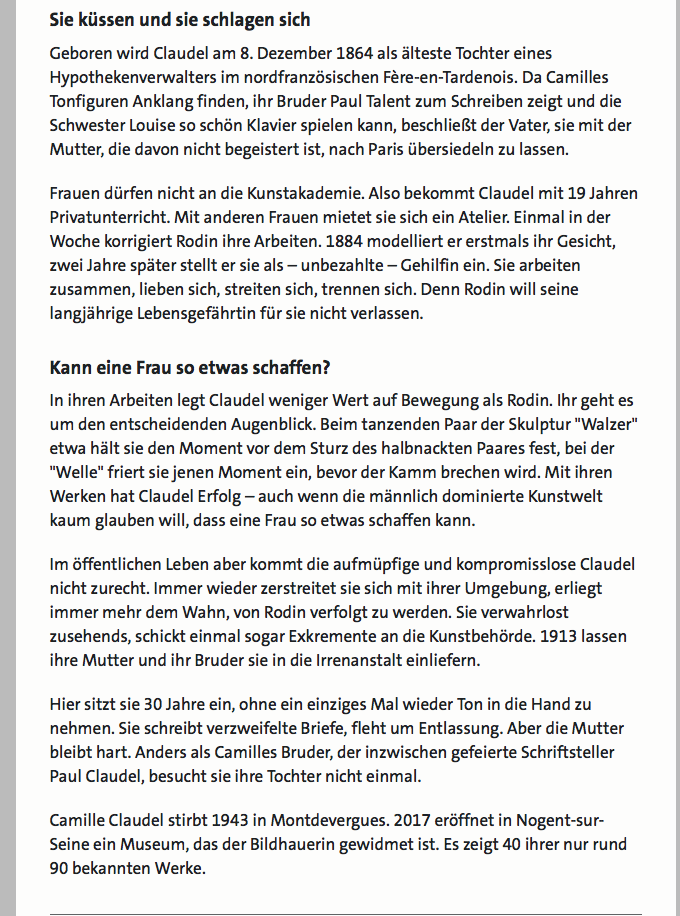
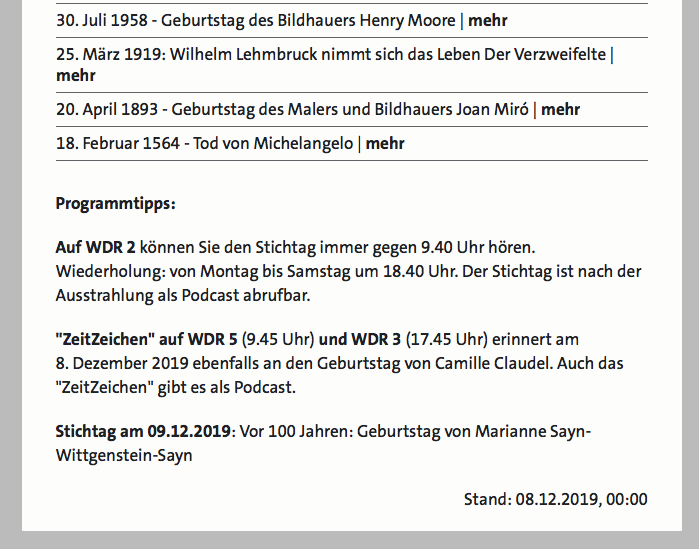
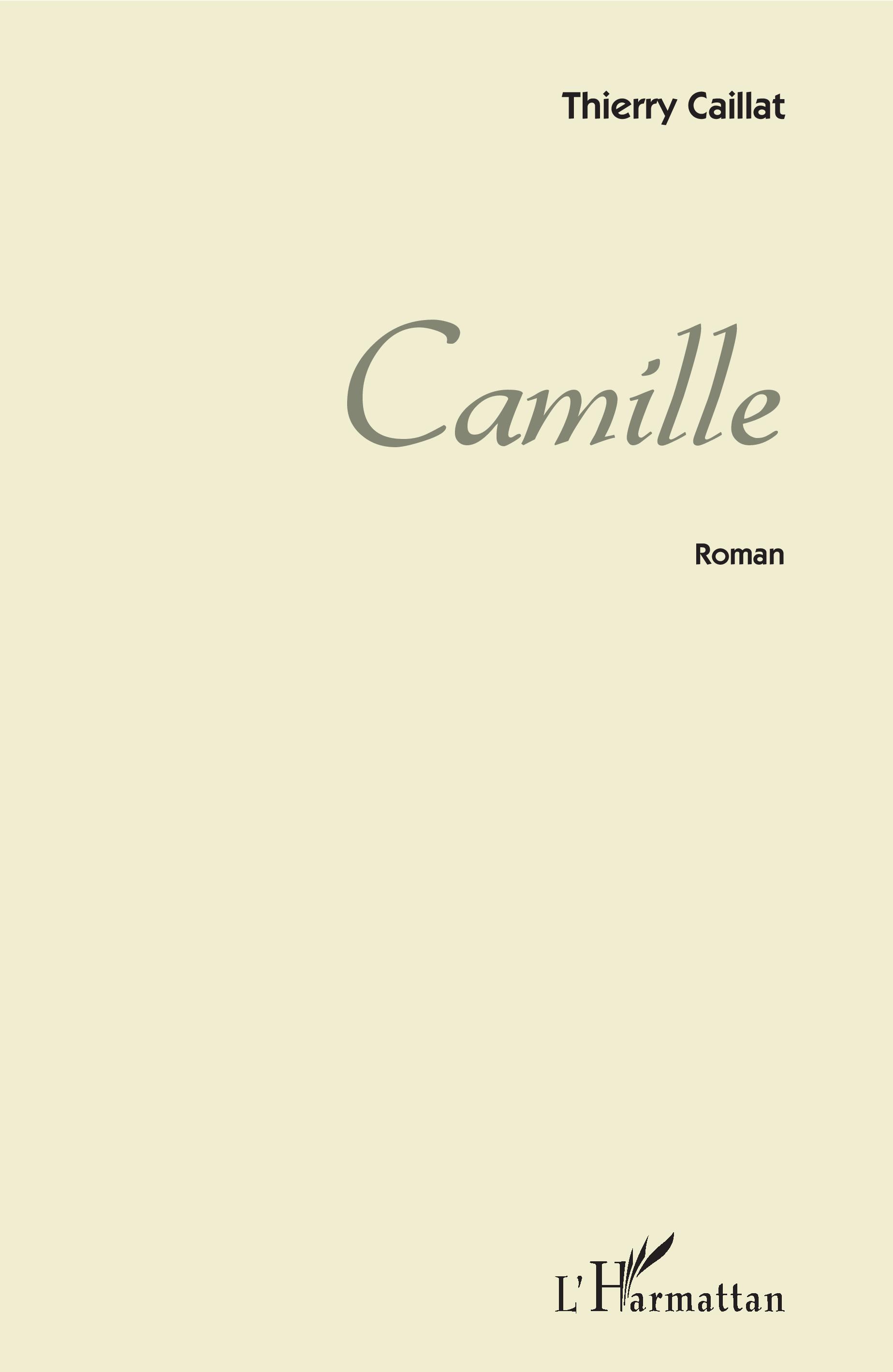 Emission sur Camille Claudel pour la radio allemande avec Thierry Caillat
Emission sur Camille Claudel pour la radio allemande avec Thierry Caillat
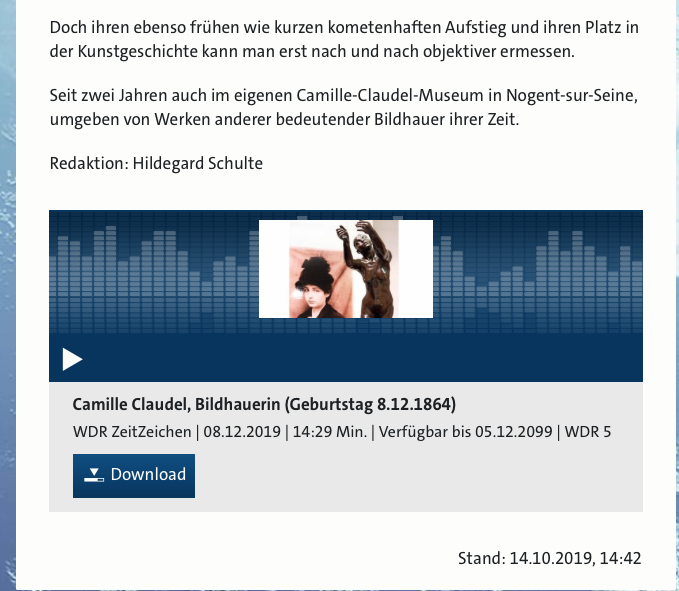
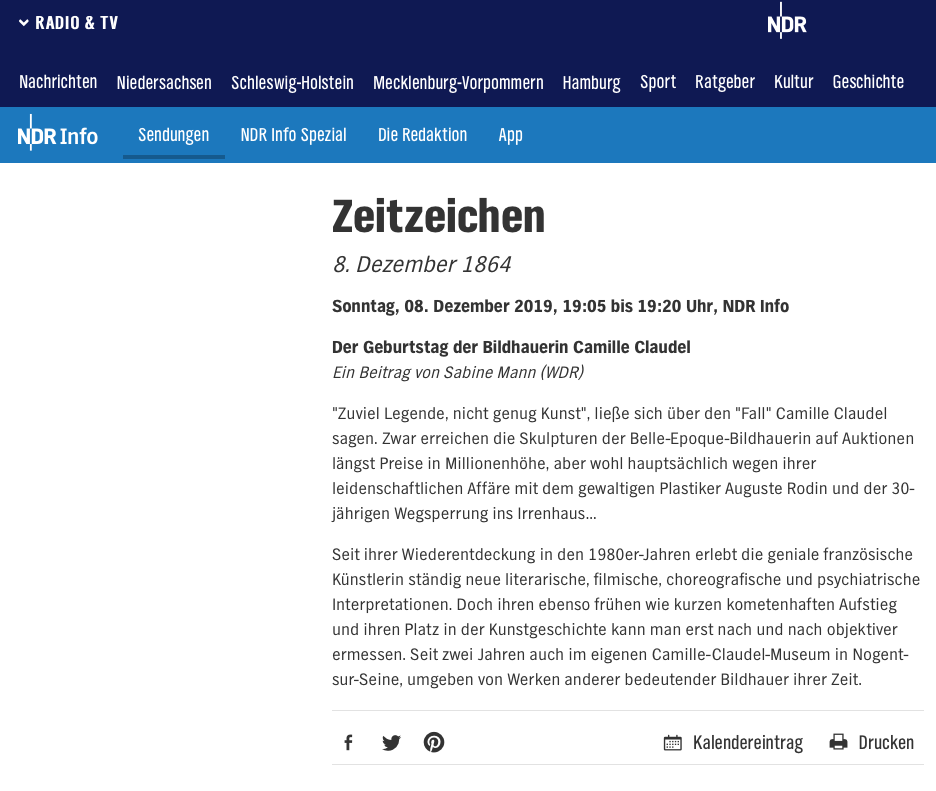

 e Leibowitz ou l’absence de Dieu, Daniel Horowitz explore la pensée politique et religieuse – controversée en Israël – de Yeshayahu Leibowitz. En quoi consiste sa foi paradoxale?
e Leibowitz ou l’absence de Dieu, Daniel Horowitz explore la pensée politique et religieuse – controversée en Israël – de Yeshayahu Leibowitz. En quoi consiste sa foi paradoxale? Daniel Horowitz. La pensée de Yeshayahu Leibowitz se situe au carrefour des deux questions les plus fondamentales que pose la condition humaine : comprendre commentle monde fonctionne d’une part, savoir pourquoi il fonctionne ainsi d’autre part. La science permet de trouver des réponses à la première de ces questions. La recherche scientifique est à la fois possible et infinie, parce que toute découverte ne fait au fond qu’ouvrir de nouvelles questions. Quant à comprendre le pourquoi du monde, ou plus simplement pourquoi il (et donc moi) existe, ou encore, en d’autres mots, à chercher à savoir si la vie a un sens, cette chose-là ne relève d’aucun savoir. Dès l’âge de raison j’ai compris qu’il était illusoire de s’en remettre à la religion pour tenter de résoudre cette énigme, parce que je savais intuitivement que le sens de la vie n’était pas une question à poser à qui que ce soit d’autre qu’à soi-même ; que la vie nous était donnée sans mode d’emploi ni sens, mais que nous pouvions lui en donner un à condition de le vouloir. Partant, l’homme a le devoir vis-à-vis de soi-même de se libérer de la contingence au moyen de sa volonté. C’est dans ce sens que le judaïsme de Leibowitz est un existentialisme et c’est pour cette raison que sa pensée m’intéresse et pourrait – je l’espère – intéresser d’autres.
Daniel Horowitz. La pensée de Yeshayahu Leibowitz se situe au carrefour des deux questions les plus fondamentales que pose la condition humaine : comprendre commentle monde fonctionne d’une part, savoir pourquoi il fonctionne ainsi d’autre part. La science permet de trouver des réponses à la première de ces questions. La recherche scientifique est à la fois possible et infinie, parce que toute découverte ne fait au fond qu’ouvrir de nouvelles questions. Quant à comprendre le pourquoi du monde, ou plus simplement pourquoi il (et donc moi) existe, ou encore, en d’autres mots, à chercher à savoir si la vie a un sens, cette chose-là ne relève d’aucun savoir. Dès l’âge de raison j’ai compris qu’il était illusoire de s’en remettre à la religion pour tenter de résoudre cette énigme, parce que je savais intuitivement que le sens de la vie n’était pas une question à poser à qui que ce soit d’autre qu’à soi-même ; que la vie nous était donnée sans mode d’emploi ni sens, mais que nous pouvions lui en donner un à condition de le vouloir. Partant, l’homme a le devoir vis-à-vis de soi-même de se libérer de la contingence au moyen de sa volonté. C’est dans ce sens que le judaïsme de Leibowitz est un existentialisme et c’est pour cette raison que sa pensée m’intéresse et pourrait – je l’espère – intéresser d’autres. 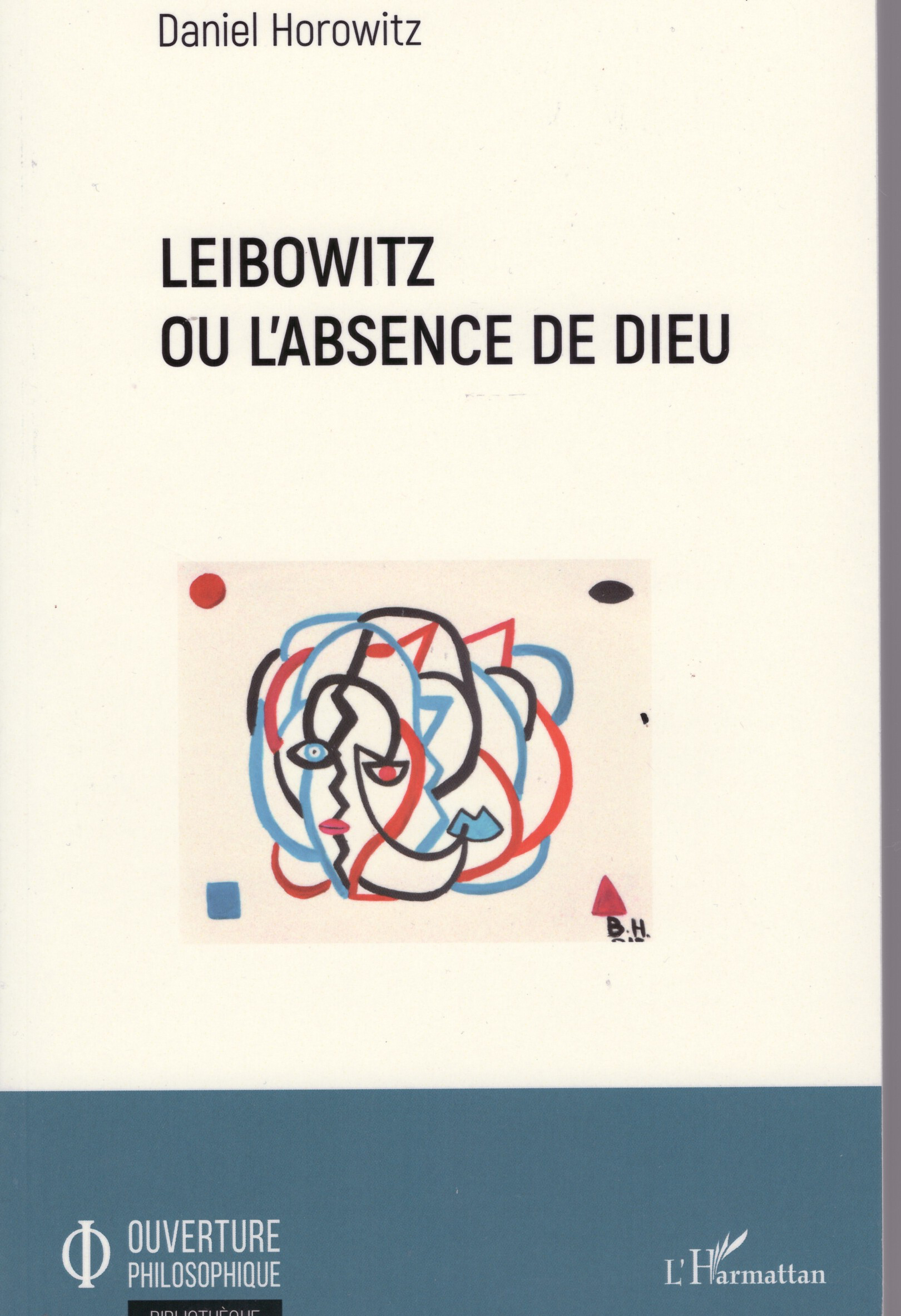 C’est justement sa conception d’un Dieu extérieur et « indifférent » au monde qui n’apporte ni consolation ni réponse aux grandes questions de l’existence qui vous permet de s’en passer totalement. Cependant, une religion n’est pas uniquement une philosophie. En s’adressant à l’humanité entière (en principe) peut-elle faire l’impasse sur les besoins profonds – affectifs, psychologiques et sociaux – des croyants ?
C’est justement sa conception d’un Dieu extérieur et « indifférent » au monde qui n’apporte ni consolation ni réponse aux grandes questions de l’existence qui vous permet de s’en passer totalement. Cependant, une religion n’est pas uniquement une philosophie. En s’adressant à l’humanité entière (en principe) peut-elle faire l’impasse sur les besoins profonds – affectifs, psychologiques et sociaux – des croyants ? 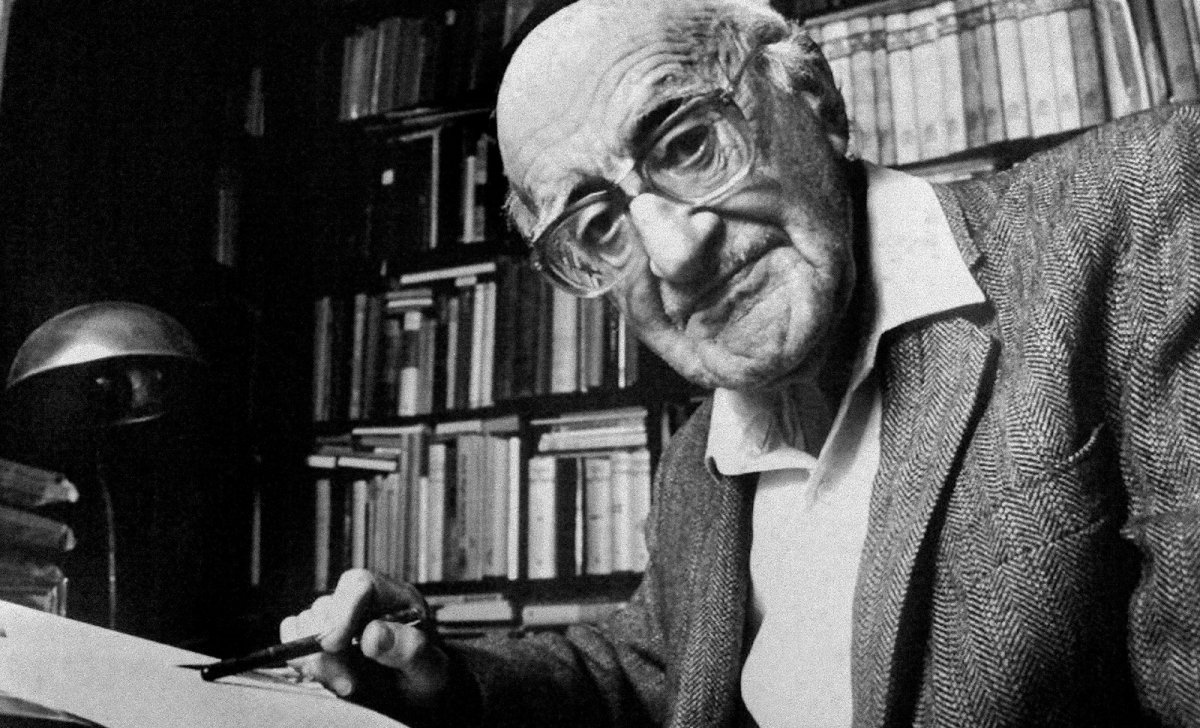 Pour vous Maïmonide, le scientifique et philosophe juif du 11-12e siècle a utilisé un double discours pour s’adresser au peuple d’un côté et a l’élite intellectuelle de l’autre. En conséquence, ses écrits « élitistes » et notamment le Guide des égaréssont ignorés par les écoles talmudiques et l’orthodoxie. Maïmonide avait-il tort de déguiser l’épouvantable vérité (la finitude et l’indifférence de Dieu) aux masses juives ?
Pour vous Maïmonide, le scientifique et philosophe juif du 11-12e siècle a utilisé un double discours pour s’adresser au peuple d’un côté et a l’élite intellectuelle de l’autre. En conséquence, ses écrits « élitistes » et notamment le Guide des égaréssont ignorés par les écoles talmudiques et l’orthodoxie. Maïmonide avait-il tort de déguiser l’épouvantable vérité (la finitude et l’indifférence de Dieu) aux masses juives ? 

 Livre jeunesse
Livre jeunesse