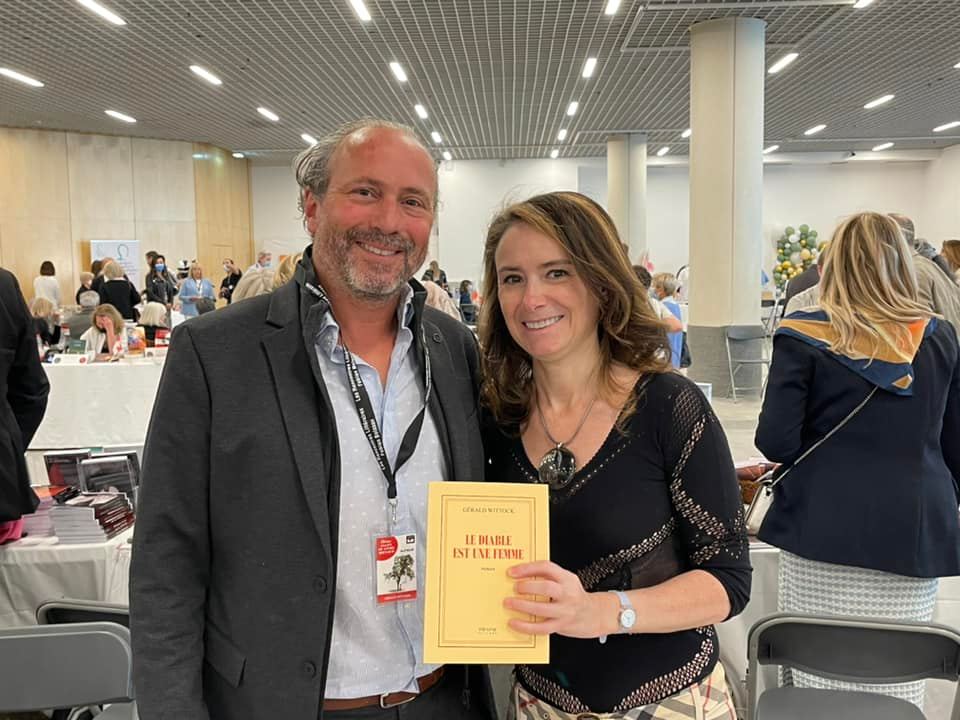L’INTERVIEW D’ESTEBAN FRÉDÉRIC
asophit | Publié le
 « La médiumnité est une porte ouverte sur de multiples univers ! »
« La médiumnité est une porte ouverte sur de multiples univers ! »
Interview d’Esteban Frederic, par Sophie Rey.
Pourquoi avoir choisi le parti pris du tutoiement ?
Il est vrai que dans l’introduction de mon livre, j’utilise le tutoiement. J’avais envie, dans ce premier texte, de créer un instant de complicité avec mon lecteur, de lui faire partager mon univers et le sens de ma démarche. En effet, j’ai écrit ma biographie comme un roman, afin de rendre cet ouvrage le plus accessible possible. Je ne voulais surtout pas rédiger un ouvrage ésotérique obscur et savant, qui au final n’intéresse que son auteur ! Bien au contraire, ma volonté était de faire découvrir au lecteur l’univers de la voyance, en restant accessible à tous. Initiés comme néophytes.
Pianiste ou voyant, quel métier demande le plus de travail ?
Que l’on choisisse d’être concertiste ou voyant, ce qui compte, avant toute chose, c’est le niveau d’exigence que l’on s’impose. Car, si vous choisissez d’évoluer à un niveau professionnel, vous ne pouvez pas vous permettre d’être dans « l’à peu près ». Vous devez viser l’excellence en permanence, et donc, vous entraîner chaque jour sans relâche. C’est ce que j’ai fait avec le piano, c’est ce que je fais aujourd’hui avec la voyance. L’entraînement quotidien est la clef du succès. Et cela, quelle que soit la carrière que l’on envisage.
Le don vient vers vous, en dehors de bien connaître la signification des cartes, comment travailler le don ?
Comment travailler le don ? C’est une question que l’on me pose souvent. Ainsi que je vous l’ai dit, il n’y a pas de solution miracle. Tout est une question de travail et de concentration. Car, à des degrés divers, nous sommes tous voyants. La différence entre un professionnel de la voyance et un débutant est la même que celle qui existe entre un sportif de haut niveau qui s’entraîne tous les jours et un amateur de sport qui dispute un match le dimanche avec ses amis. Chacun d’entre eux a des compétences, mais seul celui qui s’entraîne quotidiennement progresse de manière notable. Il en est de même pour la voyance. Les seuls conseils que je puisse donner à un débutant est : entraînez-vous, effectuez des tirages pour vos amis, travaillez votre concentration, lâchez prise et laissez parler votre instinct… Et surtout, faites-vous confiance !
Enfant, Anna ne vous quitte plus, vous-pensiez vous Schizophrène à l’époque ?
C’est une question que je me suis posée bien plus tard, vers l’adolescence. Non, enfant, je ne me posais pas de véritables questions. Les phénomènes paranormaux m’effrayaient parfois, mais je finissais toujours par les intégrer à mon univers d’enfant. Lorsque l’on est très jeune, on ne distingue pas ce qui relève de la normalité de ce qui relève du paranormal. Si le père Noël existe, pourquoi aurais-je dû m’étonner qu’Anna existe aussi ? Le fantastique fait partie de l’univers des enfants. C’est le jugement des adultes qui leur fait croire parfois qu’ils sont « déséquilibrés ». C’est une des raisons pour lesquelles j’ai voulu écrire ce livre. Si votre enfant est médium, ne l’envoyez pas chez un pédopsychiatre, il a juste besoin d’écoute et de compréhension. Et avant tout, d’être rassuré par ses proches.
P27, lors du récital et de cette transe médiumnique, pensez-vous vraiment que Chopin ait pris possession de votre corps ?
Je ne pourrai jamais expliquer ce qui s’est produit ce jour-là. C’est une sensation très étrange de ressentir que l’on perd le contrôle de son propre corps. Cependant, même si je suis resté conscient lors de cette expérience médiumnique, je n’ai pas réellement réalisé ce qui était en train de se produire. J’étais en transe, comme absent de moi-même. J’étais spectateur de la scène, totalement sous l’emprise d’une autre volonté que la mienne. Mais vous dire de qui émanait cette volonté, j’en suis bien incapable. Frédéric Chopin ? Cela serait me faire beaucoup d’honneur. En tout cas, je peux vous dire que cette entité connaissait la partition sur le bout des doigts, et qu’elle fut certainement un pianiste hors pair lors de son incarnation terrestre.
Vous écrivez que vous connaissez la fin d’un roman avant même de l’avoir fini, j’imagine que cela est vrai pour le cinéma aussi. C’est triste de ne pas pouvoir avoir accès à ces arts majeurs ?
Avec le temps, j’ai appris à pratiquer ce que j’appelle « l’amnésie médiumnique », c’est-à-dire à refouler les flashs, voire à les gommer immédiatement de ma mémoire, s’ils parviennent malgré tout à s’imposer à moi. Cela ne fonctionne pas toujours parfaitement, mais je vous rassure, j’arrive à prendre plaisir à lire un bon roman ou à suivre l’une de mes séries préférées à la télévision. Un livre ou film est avant tout une œuvre d’art. Et, la voyance ne m’empêchera jamais d’apprécier l’art sous toutes ses formes.
Concernant le contact avec les défunts, peuvent-ils nous confirmer l’existence de Dieu ? En savez-vous plus sur le Paradis et l’Enfer, le jugement dernier, la réincarnation ?
S’il est un sujet sur lequel les médiums ne reçoivent pas d’informations, c’est sur l’au-delà. Jamais l’un de nos Guides ne lèvera le voile sur ces mystères. En tant que médium, je ne peux douter de l’existence d’une force supérieure. Appelez-la comme bon vous semble, Dieu ou le Grand Architecte de l’Univers. Oui, il y a une vie après la mort, oui les Guides sont des êtres imprégnés de sagesse, et oui, il existe une entité infiniment puissante qui donne sa cohérence au tout. Je l’ai vérifié mainte fois par la médiumnité. Quant aux vies antérieures, je ne peux douter de leur réalité. Car, bien souvent, il me suffit de plonger dans les livres d’histoire pour vérifier la véracité des visions que je reçois sur les vies passées.
P63 À propos de Michel. A-t-il une femme dans sa vie ? » Pourquoi ne le savez-vous pas ?
Michel était un homme très discret et faisait rarement des confidences sur sa vie privée. Je sais qu’il a été marié et qu’il a eu un fils, suite à cette union. Mais il ne m’a jamais choisi comme confident sur ses problèmes intimes. J’étais si jeune qu’il a sans doute jugé que je n’étais pas apte à comprendre les problèmes sentimentaux d’une vie d’adulte. Il était très protecteur avec moi.
P89, Concernant l’entité du père d’Elodie. Elodie n’est pas voyante, pourquoi a-t-elle réussi à voir et dialoguer avec son père ?
Pour une raison très simple. A des degrés divers, nous sommes tous voyants, voire médiums. Ce que nous appelons le « sixième sens » est un sens commun à l’ensemble de l’humanité. Elodie possédait donc des capacités qu’elle ne soupçonnait pas. Par ailleurs, mes capacités exacerbées ont certainement favorisé ce phénomène de channeling. Bien involontairement, je « nourris » les entités de mon énergie, ce qui les rend capables de se manifester dans notre monde physique.
P85 « Mais rire avec les morts, est-ce bien raisonnable ? » Les défunts n’ont-ils pas d’humour ?
Bien sûr que les défunts peuvent faire preuve de sens de l’humour. Et, ils ne se privent pas d’en user lorsqu’ils décident de dialoguer avec un médium. Mais ce que je souligne dans le livre est le risque que prend un médium lorsqu’il décide de convoquer un disparu par le biais du spiritisme. Le médium ouvre une porte entre notre monde et l’au-delà, et ce faisant, il se met en danger. Car il peut laisser entrer dans notre univers physique une entité négative, totalement incontrôlable. Lorsque j’étais adolescent, j’ai pratiqué le spiritisme comme un jeu de société pour impressionner mes amis. J’ai appris à mes dépens à quel point j’avais tort et combien cela peut se révéler dangereux !
P100 vous avez un flash et vous voyez le jury vous applaudir, comment expliquez-vous ce flash alors qu’habituellement vous ne pouvez pas voir votre avenir ?
Il est vrai qu’un médium a du mal à voir son propre avenir. Mais il arrive que dans certains moments de stress important, nous ayons malgré tout un flash sur notre futur immédiat. Ce fut le cas, ce jour-là. La voyance n’est pas une science exacte, elle n’obéit pas à une règle absolue.
P119, plus qu’une question, une observation. C’est lorsque vous décidez de choisir la voie de la voyance que vous n’écrivez plus « don », mais « art », est-ce inconsciemment une nostalgie par rapport à l’abandon du piano ?
J’ai toujours gardé la nostalgie du piano. La passion de la musique est ancrée en moi, et elle ne me quittera jamais. Alors, lorsque j’ai écrit « art », plutôt que « don », peut-être était-ce un lapsus révélateur. Mais, malgré tout, je n’ai jamais regretté ce choix. La médiumnité m’a permis d’accéder à un univers envoutant dont je pense ne jamais me lasser.
Gabriel et Michel sont deux « accoucheurs », les deux faces d’une même pièce, qu’en pensez-vous ?
Il est certain que ces deux hommes m’ont beaucoup appris sur l’univers de la voyance. Et vous avez raison de dire que chacun d’entre eux a été un « accoucheur », les deux faces d’une même pièce. Sans eux, je ne serais jamais devenu ce que je suis. L’un m’a enseigné la part d’ombre et l’autre la part de lumière du monde la voyance.
Il y a peu de femmes dans vos rencontres avec les voyants. La sensibilité masculine est-elle, selon vous, plus disposée à recevoir le Don ? (Même si j’ai vu que sur votre plateforme en ligne, il y a une majorité de femme).
Ne croyez pas cela. Le don nous est donné à tous, femmes comme hommes. Quel que soit notre sexe, nous tous porteurs du don à des degrés divers. Comme vous le souleviez à l’instant, les hasards de l’existence ont fait que j’ai croisé la route de deux voyants masculins qui ont marqué ma vie. Mais n’oubliez pas qu’existent de grandes dames de la voyance comme Maud Kristen ou Yaguel Didier. Elles sont des références dans le monde de la voyance.
Ne pensez-vous pas que votre destin était de toutes façons d’être connu et reconnu, puisqu’en tant que concertiste vous l’auriez, probablement été aussi ?
Je n’aurais pas cette prétention ! Et, vous savez, je n’ai jamais recherché la notoriété. Bien au contraire, je fuis les soirées mondaines, et je réponds assez rarement à des interviews. Je suis adepte de l’adage « pour vivre heureux, vivons cachés ! » J’exerce mon métier avec conscience, et ce qui m’a fait connaître est avant tout le « bouche-à-oreille ». Un consultant qui me recommande à son entourage est la meilleure des publicités. Je n’en recherche pas d’autre.
Quel est votre rapport à Dieu ? Vous êtes issu du christianisme catholique, vous sentez-vous toujours proche de cette religion ?
Mes parents n’étaient pas très intéressés par la religion, ils cultivaient une certaine indifférence par rapport à l’Eglise. Je n’ai donc pas suivi de cours de catéchèse dans ma jeunesse. Mais quelle que soit la proximité que l’on entretient avec la religion, il est vrai qu’elle laisse une empreinte sur les valeurs familiales. Cependant, en tant qu’adulte, confronté à des phénomènes paranormaux, je n’ai eu d’autres choix que de faire évoluer les croyances de mes jeunes années. La Bible n’explique pas ce que je vis au quotidien. Pas plus qu’un autre texte sacré, je pense. Les livres religieux nous enseignent une philosophie de vie hautement respectable. Mais la réalité d’un médium lui fait connaître une tout autre dimension. Une dimension qui nous renforce cependant dans l’idée que, oui, il existe une force supérieure. Chacun lui donnera le nom qu’il souhaite. Je n’ai sur ce point aucune certitude, ni même aucune volonté de nommer les choses.
Pouvez-vous voir à très long terme, plusieurs dizaines d’années ?
Tout dépend de quoi l’on parle. Je pense que si on s’intéresse au futur d’un pays comme la France, ou si, dans un sens plus global, on explore l’avenir du monde, oui, un voyant a la capacité de percevoir les évolutions majeures. Et j’ai la certitude que rien ne pourra les empêcher, car nous sommes face à des tendances lourdes. Mais, lorsque l’on effectue une voyance pour une personne, là, je pense que des prédictions sur plusieurs décennies ont peu de valeur. Pourquoi ? Parce que si lors d’une consultation, j’avertis un consultant d’un danger immédiat, il sera armé pour l’éviter. Libre à lui de m’écouter ou pas, bien sûr. Mais s’il suit mes conseils, il change le cours de son futur. Ainsi que je le dis souvent, nous sommes « les architectes de notre destin ». Une consultation de voyance vous indique ce qui peut vous arriver (si vous ne changez rien à votre manière de vivre), et non, ce qui va forcément vous arriver. Le libre arbitre de chacun permet de modifier le futur. J’en suis persuadé, car je l’ai maintes fois vérifié, en gardant le lien avec mes consultants, et en dialoguant avec eux plusieurs mois après une consultation.
Que pensez-vous de cette théorie qui explique que pour se réincarner, les défunts choisissent une âme en particulier ? si oui, pourquoi alors choisir une âme que le défunt sait en souffrance ?
Comme je vous l’ai dit en début d’entretien, nous les médiums recevons peu d’informations sur des sujets tels que le Paradis, l’Enfer, ou les principes qui guident une réincarnation. Ce sont des tabous sur lesquels aucun de nos guides ne peut s’exprimer. Je ne peux donc vous livrer que ma propre analyse. Chaque être a un karma qui a été forgé par ses vies antérieures. Et, oui, je pense que nous choisissons des vies parfois difficiles pour parvenir à relever « les défis manqués » des vies passées. Si je prends un exemple un peu caricatural, un homme puissant qui aura abusé de son pouvoir, se réincarnera en homme du peuple, lui-même sous le joug d’un homme puissant. Afin qu’il comprenne la nocivité d’un pouvoir mal utilisé. Chaque incarnation est une leçon de vie.
Avez-vous un truc pour distinguer les véritables voyants des charlatans ?
Un charlatan se reconnaît en premier lieu à son discours. Celui qui vous promet « un retour d’affection » contre quelques centaines ou milliers d’euros est à fuir de toute urgence ! Par ailleurs, aussi extraordinaire que cela puisse paraître, un voyant chevronné reconnait un autre voyant, sans même lui adresser la parole. De subtiles ondes circulent entre eux. Donc, non, je n’ai pas de « truc » pour reconnaître un voyant. Je sais naturellement si j’ai affaire à quelqu’un qui a des capacités hors normes, ou si je suis face à un mythomane ou un escroc.
Pourquoi ne pas avoir filmé les phénomènes poltergeist en Amérique latine ?
A aucun moment, nous n’avons pensé à cela ! Vous savez, lorsque vous êtes enfermé dans une maison qui semble prise de folie, où les meubles se déplacent, où les cadres se fracassent au sol, où des coups sont donnés dans les murs et dans les portes… vous pensez avant tout à vous protéger, et à protéger vos amis présents sur place ! Car si l’entité nous avait physiquement agressés, au regard de sa puissance, nous aurions pu être blessés, voire pire… Notre niveau de stress était tel que nous étions très loin de penser à enregistrer une vidéo pour You Tube ! D’ailleurs, je ne souhaite à personne de vivre une telle expérience. Elle peut se révéler traumatisante pour des personnes sensibles.
Avez-vous entendu parler de Tyler Henry dont la vie est adaptée sur Netflix (A l’écoute de l’au-delà) ?
Oui, bien sûr, car c’est un médium qui fait une véritable carrière télévisuelle aux Etats-Unis. En quelques années, il est devenu un véritable star de la voyance là-bas. J’ai regardé, en partie, la série qui lui est consacré, et je dois avouer que les prestations de Tyler Henry sont bluffantes. Sa spécialité est la communication avec les disparus, ce que je me refuse à faire pour les raisons que j’ai évoquées précédemment. Pour ma part, je préfère dialoguer avec les vivants, et sonder les méandres de leur avenir. Mais, qui sait ? Peut-être que Netflix s’intéressera aussi à cet aspect de la médiumnité un jour prochain ? La médiumnité est une porte ouverte sur tellement d’univers différents qu’elle peut faire l’objet d’innombrables séries !
« Mon sixième sens » Esteban Frédéric.
Éditions De Vinci
Contact :https://guilaine-depis.com/



 Entreprises : « Comment les LBO peuvent réduire les inégalités sociales »
Entreprises : « Comment les LBO peuvent réduire les inégalités sociales » Tribune. Il y a dix ans, participant comme orateur à une conférence sur le « private equity », je disais à une salle médusée que tous les salariés devaient tirer parti des opérations de LBO et de la création de valeur à laquelle ils ont contribué et pas seulement quelques cadres triés sur le volet. Les réactions furent amusées, pas très amènes. J’avais appelé cela les dividendes du travail, terme aujourd’hui repris par certains économistes pour illustrer la nécessité d’améliorer les mécanismes actuels d’intéressement des salariés.
Tribune. Il y a dix ans, participant comme orateur à une conférence sur le « private equity », je disais à une salle médusée que tous les salariés devaient tirer parti des opérations de LBO et de la création de valeur à laquelle ils ont contribué et pas seulement quelques cadres triés sur le volet. Les réactions furent amusées, pas très amènes. J’avais appelé cela les dividendes du travail, terme aujourd’hui repris par certains économistes pour illustrer la nécessité d’améliorer les mécanismes actuels d’intéressement des salariés.



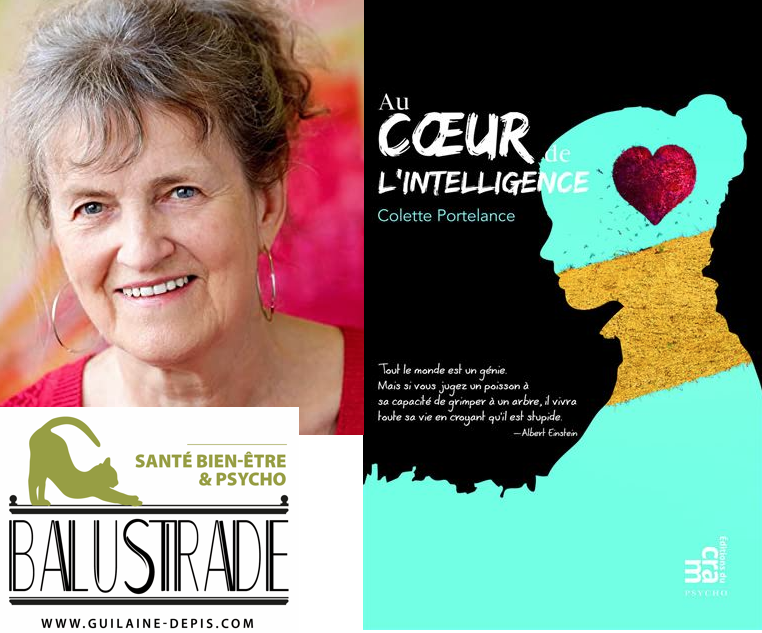 AU CŒUR DE L’INTELLIGENCE
AU CŒUR DE L’INTELLIGENCE