
RCF/Radio Notre Dame reçoit Frédéric Vissense, réécoutez ici
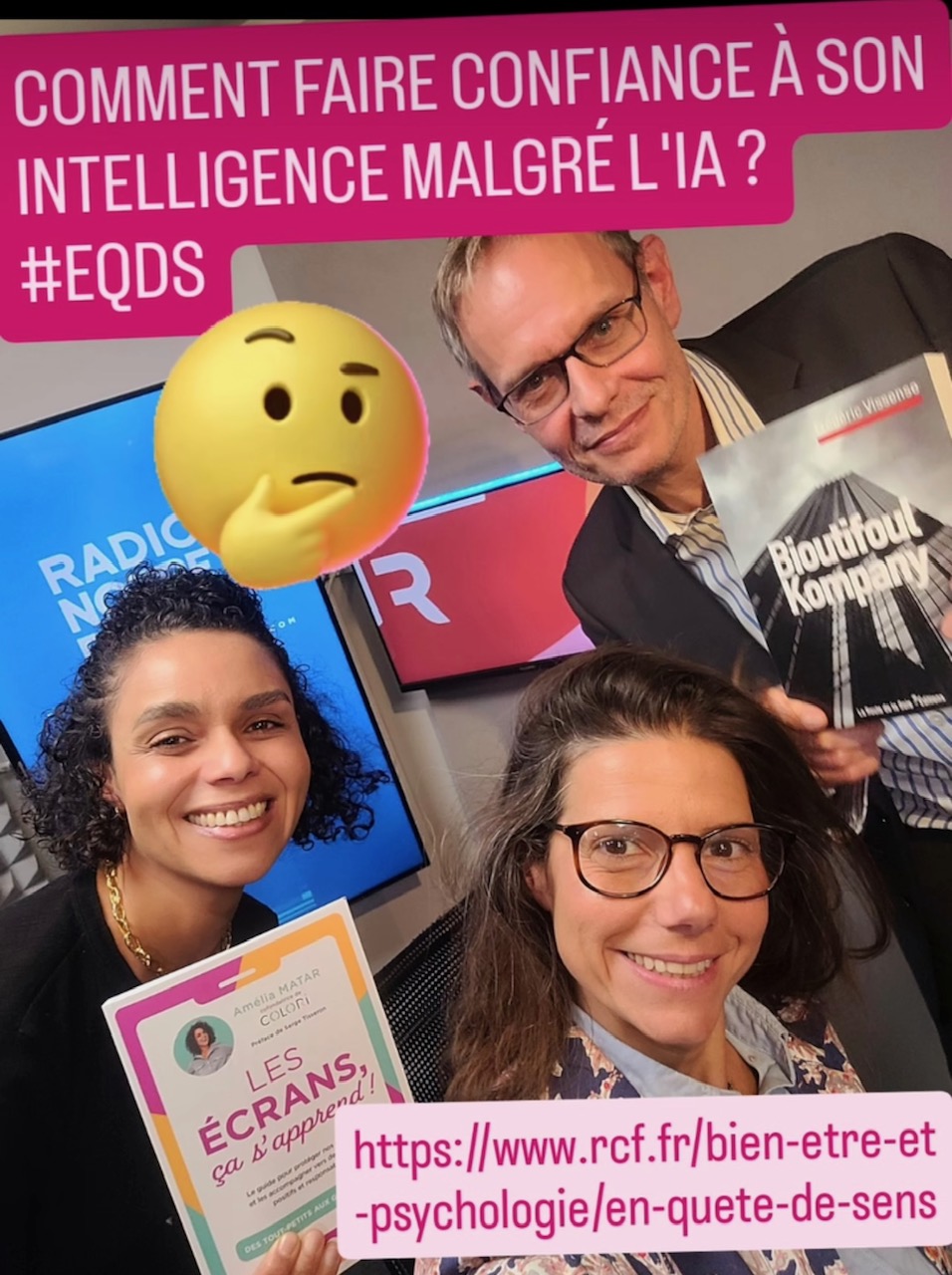
Guilaine Depis, attachée de presse (Balustrade)
Rampe de lancement ! Appuyez-vous sur la balustrade !

Dans son roman intitulé « Bioutiful Kompany », Frédéric Vissense raconte avec un humour féroce les tribulations de la Compagnie universelle d’innovation pour dénoncer les stratégies absurdes et le management cruel des grandes organisations. Grâce à la littérature, des millions d’individus sont ainsi vengés.
La couverture a été très bien pensée par l’éditeur du livre. La Trump Tower à New York, un gratte-ciel au fade style moderne avec sa façade en verre et en aluminium recouvert d’une teinte cuivrée, qui l’assombrit fortement. Vu en contre-plongée, l’édifice provoque un sentiment d’oppression, d’écrasement. Il est le siège d’une « Bioutiful Kompany », en l’occurrence la Compagnie universelle d’innovation dans laquelle travaillent les personnages du roman : la « Bioutiful Kompany » est en fait un monde en soi et totalisant – de la vie des personnages en dehors du bureau, (si jamais ils ont en une), on ne saura jamais rien – et elle en devient une allégorie de l’Entreprise. Et, à ce titre, les personnages sont des personnages types, souvent sans prénom (ou alors seulement avec un diminutif un peu ridicule, comme Fifi ou comme Manu, qui demande d’ailleurs qu’on l’appelle Man…), ou bien réduits à leur fonction (le Machiniste, le Philosophe, le Directeur Général…), avec emploi obligé de la majuscule. Et comme dans le célèbre gratte-ciel new-yorkais, un homme règne en maître, assimilé au type du monarque, ici John III.
Humour à tous les étages
On peut autant parler de fresque ou de (sinistre) épopée que de roman, puisque c’est une aventure collective que raconte le livre de Frédéric Vissense. La Compagnie universelle d’innovation connaît des hauts et des bas. Elle a d’abord opté pour un management issu de la philosophie zen, incarnée par le galet des jardins japonais. Qu’est-ce qu’un galet ? Un caillou dur, lisse et léger, trois caractéristiques qui sont aussi dans l’esprit de John III et de son éminence grise, le Philosophe, les trois qualités de l’employé idéal. L’atmosphère dans les bureaux de la Compagnie se « nipponise » et, comme dans une maison traditionnelle de l’archipel japonais, on élève des murs en papier, laquelle matière « présente l’avantage de mieux laisser passer la lumière et de rendre l’observation des gestes aux alentours possible à tout instant. » Cette nouvelle stratégie ne va pas donner de très bons résultats. La sentence est impitoyable : « Vos employés crissent comme des graviers quand ils devraient crisser comme des galets. »
Ni ressources, ni humanité
Bioutiful Kompany est une satire réussie. Doté d’un très bon style, où l’on reconnaît un habitué des bons livres et un véritable amoureux de la littérature, Frédéric Vissense dresse un portrait à charge du monde de l’entreprise. Il manie habilement le paradoxe pour critiquer l’obsession de la productivité : « Grâce à cette méthode infaillible [celle des galets], nous fabriquerons dès demain autant de qualité que de quantité, et plus encore. » Il recourt aux possibilités plaisantes de la rhétorique et des figures de styles, comme le zeugme, lorsqu’il est question d’« un jeune manager versé dans les théories iconoclastes, revenu d’un voyage en Extrême-Orient, et ayant croisé le Doktor dans des séminaires de cohésion managériale et de joie de vivre ». Il faut dire aussi que, dans la réalité, nos chers managers tendent la verge pour se faire battre tant ils savent se montrer cyniques. Il suffit de les laisser parler et certaines phrases de Bioutiful Kompany sonnent tellement vrai que l’on jurerait qu’elles ont été proférées dans une de ces salles aux murs tout blancs et aux ampoules blafardes, que les salariés du tertiaire connaissent bien ; on pense aux conseils donnés à John III par l’Assistante Adjointe: « Si, en plus, vous devez ramener le cigare et la Ferrari, des années de dialogue social et de sourires forcés seront anéanties : le jeu n’en vaut pas la chandelle : des milliers de rictus maladroits, de poignées de main moites, et pour quoi ? » Un humour grinçant et une ironie désinvolte traversent le livre. Les titres de certains chapitres sont éloquents : « C’est alors que le temps passa », « Le cerveau masculin archaïque franchit la ligne rouge » ou « Notre respect avéré du dress code et des codes en général ». Et est souvent moquée, en rappel du titre, l’affreux globish des product owners et autres marketers. D’autres chapitres sont des morceaux de bravoure : celui qui est intitulé « Le nitrocarbohydrométadone » est drôle de bout en bout et il est aussi l’un des tournants du récit, puisque c’est à ce moment-là que le Herr Docktor Stürmer présente sa toute nouvelle invention, qui fait clairement basculer le roman dans la dystopie.
Comme dans un épisode de Black Mirror, pilules miracles ou implants du dernier cri forment le décor quotidien des employés de la Compagnie universelle d’innovation. Si ces avancées technologiques sont prometteuses par certains aspects, elles induisent aussi des conséquences potentiellement catastrophiques. Reste la Communication pour sauver ce qui peut l’être et faire la part du feu, car « la communication, c’était toujours ce qu’il fallait faire quand on n’avait pas d’idée précise de ce qu’il fallait faire ». En refermant Bioutiful Kompany, on se met à rêver d’un débat entre Frédéric Vissense et la philosophe Julia de Funès, auteure de plusieurs essais sur la vie en entreprise et très critique d’un certain type de management.
Frédéric Vissense
Bioutiful Kompany
La Route de la soie Éditions, 490 pages

C’est un monde de l’absurde que décrit l’auteur, sous pseudo par précaution managériale. Issu des sciences politiques, il a intégré le monde de l’entreprise. Après des expériences variées dans les secteurs à dominante technologique, en France et ailleurs, il est devenu DRH. Il décrit la dérive machiniste du management des grandes entreprises, l’ironie de ses contradictions, les limites inhumaines de la bureaucratie. Ce monde devient de plus en plus notre monde – à moins que le néo-capitalisme des ploucs des collines à la JD Vance, tonitrué par le vaniteux bouffon à mèche blonde, ne change la donne pour un retour à Hobbes, là où l’homme est un loup pour l’homme (ne parlons même pas de la femme !).
Le DRH moderne n’utilise plus les tests de personnalité tangents, ni les entretiens d’embauche soumis aux biais cognitifs. Le management a inventé une machine à scanner les pensées, même les plus intimes. Une sorte de détecteur de mensonges (dont on sait qu’il a peu de fiabilité), mais qui se veut omniscient. L’IA pénètre les cerveaux pour évaluer – régulièrement – chaque employé. Cette « note » (manie omniprésente de notre monde informatisé) mesure l’adhésion consciente et inconsciente aux « valeurs » de la compagnie (qui ne sont le plus souvent que des slogans creux). Tout écart est enregistré, analysé, menant à une correction pouvant aller d’une simple remarque au licenciement pur et simple : pas assez conforme !
Fifi est un salarié moyen qui tente de naviguer entre conformité et survie dans ce monde-là. Ce n’est pas pour rien que ses collègues le surnomment le Prudentissime. Une fois branché à la machine de la Compagnie Universelle d’Innovation, il focalise ses pensées sur des images neutres, et sur une couleur : le gris de l’uniformité, le métissage de toutes les teintes en une seule. Cette neutralité mentale peut rapidement devenir suspecte. Le Doktor Stürmer, ancien consultant berlinois reconverti en architecte du management des esprits, s’interroge : pourquoi ce salarié anonyme, qui ne fait pas parler de lui, diffère-t-il tant de ses collègues qui, eux, ne peuvent s’empêcher de penser en-dehors ?
L’objectif est de faire de chaque employé de la Kompany un galet bien lisse, permettant de rouler sur les autres galets sans aspérité qui accroche. Un management d’huile, pour bien faire actionner les rouages. Car l’entreprise est de plus en plus perçue par les technocrates « consultants » qui la gouvernent comme une vaste machine, qu’il s’agit de faire tourner au mieux. Efficacité : tel est le mantra. Toute émotion humaine interfère avec l’application des règles ; toute humanité est bannie des processus ; tout salarié est soumis volontaire pour devenir galet brillant. Agrippine est la souveraine de la novlangue d’entreprise ; elle pense à votre place.
J’ai connu les prémisses de cette évolution d’un capitalisme « de papa », volontiers paternaliste et que certains ont appelé « rhénan » pour le distinguer du capitalisme purement comptable des Américains. Au début des années 1990, les banquiers issus des meilleurs lycées de la capitale, bons élèves conformistes, se sont mis au « management » (mot qu’ils découvraient) ; ils ont singé l’anglais globish (sans comprendre le plus souvent les faux-amis, comme ce « benchmark » qui ne signifie ni objectif à atteindre, ni carcan à respecter, mais simple niveau de référence). J’en ai ri. Je l’ai subi. J’en suis parti en creusant mon trou là où la machine technocratique ne pouvait pas m’atteindre : dans l’intelligence du métier (qui n’avait rien d’artificielle).
J’ai vu comment le management pouvait devenir une doctrine totalitaire comme celle du parti communiste, avec ses experts « scientifiques » suivant les lois de l’Histoire (américaine), avec sa hiérarchie (mesurée au conformisme le plus absolu), avec ses employés réduits à l’état de béni oui-oui et de rouages anonymes, répudiant toute amabilité au nom d’une efficacité de papier. Il fallait se soumettre (en apparence), faire chorus aux réunions (obligatoires) à la majorité (qualifiée selon la hiérarchie). Une servitude volontaire était exigée ; ainsi était-on récompensé par une prime ou par une promotion. Les plus méritants devenaient « directeurs », soumis à plus directeurs qu’eux. Il fallait adopter les bons discours, afficher les bons sentiments, exprimer son engagement (enthousiaste) dans des processus validés par l’entreprise.
Les outils ont pris le pouvoir dans les grands machins bureaucratiques que sont devenues les firmes d’une certaine taille. Les hommes s’effacent derrière la régulation, l’humanité derrière les process. Les nouvelles technologies imposent leur logique, chacun doit s’y adapter sous peine de disparaître. Même si, comme le Grand Actionnaire du livre, on s’alarme dans les bureaux feutrés des dirigeants d’une « baisse continue de la productivité, l’absentéisme, les défaillances techniques ». Sans en chercher les causes : la machine ne saurait défaillir, il n’y a que des rouages usés ou rouillés, à remplacer. « Il est urgent que d’autres machines viennent ajouter un peu d’humanité au sein du Groupe », dit le Directeur général persistant et signant dans l’erreur conceptuelle (p.93).
La transparence, exigée du monde puritain yankee sous prétexte (religieux) de traquer les péchés les plus cachés, prend prétexte d’efficacité et de performance (de société) pour contrôler les humains (ces bêtes à dresser). La technologie de contrôle, de surveillance, et les réseaux, le système de notations exigé à chaque action, y aident grandement. « Voyons Fifi : de nos jours on ne peut plus faire comme si un fantasme était affaire privée ne prêtant pas à conséquence collective, ce serait inconscient, avec tous les outils de communication qui existent ! » p.126. Cette contrainte s’exerce sans violence ouverte, l’intériorisation de la norme pousse chacun à se rendre employable, à noter selon la norme admise, non par ce qu’il pense. Il se lisse, comme un galet ; ceux qui regimbent se poussent d’eux-mêmes vers la sortie.
Il manque une belle histoire pour faire de ce roman un émule d’Orwell et de son 1984, mais l’auteur livre un bon diagnostic sur les tares du management actuel, ce délire corporatif. Il est peut-être déjà insuffisant : l’IA et les idéologues autour de Trompe ne nous préparent-ils pas pire ?
Frédéric Vissense, Bioutifoul Kompany, 2025 éditions La route de la soie, 488 pages, €27,00
(Mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)
Attachée de presse BALUSTRADE : Guilaine Depis, 06 84 36 31 85 guilaine_depis@yahoo.com
Dans un monde où la machine pense à votre place, où le management devient une doctrine totalitaire et où l’individu n’est plus qu’un “galet” poli par la performance, Frédéric Vissense nous livre une satire dystopique du monde de l’entreprise.
Seule une plume rompue aux arcanes du management pouvait accoucher d’un tel récit, à la fois glaçant et terriblement familier. À croire que l’auteur a longtemps œuvré dans les coulisses du monde RH, là où se prennent les décisions qui transforment peu à peu les hommes en ‘galets’. Entre Orwell et Kafka, son récit interroge notre renoncement collectif à l’humanité au nom d’une efficacité sans âme.
L’entreprise comme nouvelle Inquisition
Dans Bioutifoul Kompany, l’entreprise n’est plus seulement un lieu de travail : c’est une entité totalisante, une matrice qui façonne les individus jusqu’au plus intime de leur pensée. « Il faut se préparer à la résistance, du moins : à la prise de conscience de notre déchéance prochaine », prévient un personnage, conscient de l’intrusion de la machine dans l’esprit humain.
Vissense reprend ici une vieille angoisse littéraire : et si le management devenait une nouvelle forme d’Inquisition ? Comme dans 1984, où Big Brother s’immisce jusque dans les pensées, la Kompany scanne les cerveaux de ses employés. Le dispositif est perfectionné : alors qu’Orwell décrivait la peur de l’œil qui surveille, Vissense met en scène la soumission volontaire. Sous prétexte d’optimisation, les travailleurs s’abandonnent à un système qui les dépossède de leur propre intériorité.
L’ère du management par les galets
L’un des concepts les plus saisissants du roman est celui du management par les galets. Dans cet univers, la perfection se mesure à la capacité de lisser chaque aspérité, chaque écart de conduite, chaque originalité. « Un monde où la quête de la qualité totale nous transforme en galets lisses, prêts à glisser sans faire de bruit ».
On pense aux Temps modernes de Chaplin, où l’ouvrier est broyé par la machine. Mais ici, il ne s’agit plus seulement d’une aliénation physique : l’entreprise façonne aussi les émotions, rendant ses employés interchangeables. L’efficacité est retenue comme seul critère de jugement, et la subjectivité individuelle est sacrifiée sur l’autel de la rationalité productive.
Le wokisme et l’IA redessinent le management
Si Bioutifoul Kompany nous parle d’un futur dystopique, il résonne pourtant étrangement avec l’idéologie managériale actuelle, qui se drape de vertus progressistes pour mieux contrôler ses employés. Aujourd’hui, la recherche de la conformité ne passe plus uniquement par la productivité, mais aussi par l’adhésion à un ensemble de valeurs jugées incontestables. L’idéologie woke, initialement pensée comme un mouvement de justice sociale, s’est trouvée récupérée par les grandes entreprises, non pour libérer, mais pour discipliner. On ne demande plus seulement à un salarié d’être performant, mais aussi d’adopter les bons discours, d’afficher les bons sentiments, et d’exprimer son engagement dans des causes validées par l’entreprise.
Dans le roman, la machine de la Kompany ne se contente pas d’évaluer l’efficacité, elle détecte aussi les émotions et les pensées dissidentes : « Je vous rappelle que le principe de notre appareil sans équivalent dans le monde humain consiste à visualiser les pensées qui vont naître spontanément de votre esprit à l’écoute des différentes valeurs de notre entreprise… »
Toute erreur d’alignement avec les valeurs officielles est perçue comme suspecte, et comme le rappelle un technicien de la Kompany, certaines pensées sont jugées « plus appropriées » que d’autres. Cette logique rappelle celle des grandes multinationales qui, sous couvert d’inclusivité, imposent une doxa idéologique : toute réserve, toute nuance se mue en faute professionnelle potentielle.L’intelligence artificielle est ainsi un bras armé du management émotionnel : elle évalue les réactions, surveille les prises de position et façonne les individus en fonction d’un cadre idéologique imposé. Dans Bioutifoul Kompany, la surveillance atteint son paroxysme lorsque l’un des personnages comprend que même le silence peut être une faute : « Et si je ne pense à rien malgré tout ? Sans aucune mauvaise volonté, je tiens à le préciser. » (…)
« Mais, mais, ce n’est pas possible voyons ! Quand on dispose d’un cerveau humain, l’on pense nécessairement à quelque chose… »
Sous couvert d’inclusivité et de diversité, ne sommes-nous pas en train de bâtir une Kompany bien réelle, où l’IA et la surveillance idéologique décident de qui est digne de travailler et de qui doit être débranché ?
La machine comme modèle humain
Le roman explore un basculement fondamental : et si les machines devenaient les employés parfaits, et les humains des variables obsolètes ? Dans l’une des scènes les plus troublantes, un personnage décrit l’évolution de l’outil : « Arriva un jour, même s’il n’est point daté, disons fin du XXème siècle dans une société innovante, où les outils en vinrent à servir leur propre développement, sans se préoccuper du monde extérieur ».
Difficile de ne pas penser ici à Günther Anders et à sa Honte prométhéenne, où l’homme, dépassé par ses propres créations, se sent inférieur à la machine. Là où les premiers outils servaient l’homme, les nouvelles technologies imposent aujourd’hui leur propre logique, et l’humain doit s’y adapter sous peine de disparaître.
L’absurde serait une arme de subversion
Si le propos du roman est sombre, son ton ne l’est pas. Vissense manie l’humour absurde et la satire avec brio. La structure de l’entreprise, poussée à son paroxysme, y apparaît comme une caricature délirante de la bureaucratie moderne. La scène où le Grand Actionnaire s’alarme que « la baisse continue de la productivité, l’absentéisme, les défaillances techniques » risquent de nuire aux bénéfices rappelle les logiques absurdes des comités de direction incapables de voir qu’ils sont eux-mêmes la source du problème.
On pense aux dialogues absurdes de Beckett ou aux descriptions kafkaïennes d’une administration aussi rigide qu’inefficace. La Kompany, en cherchant la perfection, ne produit au final que du chaos et de l’angoisse.
La servitude volontaire à l’ère du numérique
L’un des aspects les plus troublants de Bioutifoul Kompany est sa capacité à faire écho à notre monde contemporain, où la frontière entre travail, surveillance et contrôle social s’amenuise chaque jour un peu plus. Dans un univers où nos moindres actions sont tracées, analysées et optimisées par des algorithmes de productivité, la question de la servitude volontaire prend un tour nouveau. Comme l’avait anticipé La Boétie, l’homme ne se contente pas d’être soumis : il collabore activement à sa propre domestication. À l’instar des employés de la Kompany, qui acceptent sans broncher que leurs pensées soient scannées, nous fournissons volontairement nos données à des plateformes numériques, participant ainsi à la construction de notre propre cage dorée. Le philosophe Byung-Chul Han souligne que nous sommes entrés dans une société de la transparence, où l’exigence de visibilité totale – sous couvert d’efficacité et de performance – produit en réalité un monde de contrôle subtil, où la contrainte s’exerce sans coercition.
L’uberisation de l’existence : un monde sans aspérités
Le management par les galets décrit dans le roman trouve un écho direct dans l’uberisation du travail et la précarisation généralisée des employés du XXIe siècle. L’idéal du salarié fluide, adaptable et sans revendications rappelle la figure du travailleur indépendant d’aujourd’hui, forcé de se conformer aux exigences des plateformes sans jamais pouvoir négocier. Le sociologue David Graeber, dans Bullshit Jobs, dénonçait déjà cette logique où la soumission ne passe plus par des ordres explicites, mais par l’intériorisation d’une norme qui pousse chacun à se rendre employable, c’est-à-dire à gommer tout ce qui pourrait faire obstacle à sa rentabilité. Comme chez Vissense, le monde du travail contemporain ne tolère plus le doute, l’imprévisibilité ou l’ironie : tout doit être mesurable, lisse et immédiatement productif. Mais à force d’optimiser l’humain, ne risque-t-on pas, comme dans Bioutifoul Kompany, d’accoucher d’une humanité désincarnée, où seuls les algorithmes peuvent encore prétendre à l’excellence ?
Le management toxique : une stratégie RH
Dans certaines entreprises , la réduction des effectifs ne passe plus par des licenciements massifs, mais par une pression psychologique progressive visant à pousser les salariés vers la sortie. On ne licencie pas, on use les employés : réorganisations incessantes, mutations arbitraires, objectifs intenables, isolement progressif. L’objectif est simple : rendre la situation de travail insoutenable pour que l’employé, épuisé, parte de lui-même.
Dans Bioutifoul Kompany, cette logique se retrouve dans la manière dont la Kompany surveille et façonne les pensées de ses employés. L’entreprise n’a pas besoin d’annoncer de restructuration, elle sait que la pression exercée sur ceux qui ne sont pas en parfaite adéquation avec ses valeurs finira par faire le tri naturellement. Comme l’explique un supérieur à un employé pris dans le système : « Eh bien, hum, nous allons prendre du retard sur le programme ; il va cependant de soi que des pensées négatives, je dis bien négatives, pourraient laisser entendre que votre perception des valeurs de notre entreprise s’avère erronée ; mais nulle crainte à avoir, nous saurons alors procéder aux ajustements nécessaires. »
Ces ajustements nécessaires rappellent certaines pratiques bien réelles dans le monde du travail. Plutôt que de prendre la responsabilité d’un départ forcé, l’entreprise met en place un climat où les employés dissonants finissent par se sentir de trop, jusqu’à ce qu’ils choisissent eux-mêmes la porte de sortie.
Des entreprises comme Amazon ont été accusées de recourir à ce type de pressions, en instaurant des rythmes de travail intenables et une surveillance permanente. Les témoignages d’anciens employés décrivent un environnement où l’angoisse et l’épuisement moral ne sont pas des dommages collatéraux, mais des outils de gestion.
Dans le roman, cette mécanique est poussée à son extrême : il ne suffit plus d’être productif, il faut penser correctement. Lorsqu’un employé comprend que même son inconscient peut être jugé, il s’affole : « Mais alors, il va dévoiler ses pensées vis-à-vis de l’entreprise ?
– Peut-être pire : ses pensées qui ne concernent pas l’entreprise. »
C’est là tout le paradoxe du management contemporain : les entreprises promeuvent la bienveillance, l’épanouissement, mais traquent le moindre signe de fatigue ou de scepticisme comme une menace. Ce que Bioutifoul Kompany met en scène, ce n’est pas une simple dystopie, c’est la rationalisation ultime d’une pratique déjà en germe dans le monde du travail.
Bioutifoul Kompany ou l’ultime dystopie du monde corporate
Frédéric Vissense nous offre ici une critique mordante de l’ère du contrôle absolu, où l’entreprise ne se contente plus d’encadrer le travail, mais façonne aussi l’âme de ses employés. En transposant les codes de la dystopie à l’univers du management, il renouvelle un genre tout en pointant les dérives bien réelles d’un monde où la technologie et l’idéologie de la performance ont remplacé l’humain.
Une lecture qui résonne comme un avertissement : et si Bioutifoul Kompany était déjà notre présent ?