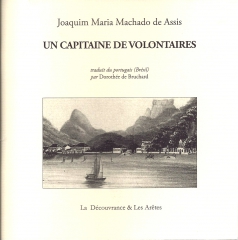 Un capitaine de volontaires (cliquez pour voir l’argumentaire)
Un capitaine de volontaires (cliquez pour voir l’argumentaire)
–
Joachim Maria Machado de Assis
traduit du brésilien par Dorothée de Bruchard
En partance pour l’Europe, peu après la proclamation de la République, Simão de Castro fit l’inventaire de ses lettres et ses notes ; il déchira le tout. Ne lui resta que le récit que vous allez lire ; il le confia à un ami, le priant de le faire imprimer une fois qu’il aurait pris le large. L’ami n’agréa pas sa demande, trouvant dans cette histoire quelque chose qui pouvait sembler pénible, ce qu’il lui expliqua dans une
lettre. Simão répondit qu’il s’en remettait tout à lui ; n’ayant guère de velléités littéraires, peu lui importait d’être publié ou pas. Maintenant qu’ils sont tous deux décédés et ce scrupule n’existant plus, on donne le manuscrit à la presse.
Nous étions deux, et elles, deux. Nous y allions tous deux en visite, par habitude, par délassement, et finalement par amitié. Je devins l’ami du maître de maison, et lui devint mon ami. Le soir, après dîner – l’on dînait tôt en 1866 –, j’y passais pour fumer un cigare. Le soleil entrait encore par la fenêtre, d’où l’on voyait une colline avec des maisons. La fenêtre opposée donnait sur la mer. Je ne citerai ni la rue ni le quartier ; je puis citer la ville, c’était Rio de Janeiro. Je tairai le nom de mon ami ; mettons une lettre, X***. Elle, l’une d’elles, s’appelait Maria.
Lorsque j’arrivais, il était déjà dans sa chaise à bascule. Les meubles du salon étaient peu nombreux, les ornements rares ; toute simplicité. X*** me tendait sa main large et forte ; j’allais m’asseoir auprès de la fenêtre, un oeil sur le salon, un oeil sur la rue. Maria, si elle n’était déjà là, se montrait peu après. Nous n’étions rien l’un pour l’autre; seule l’affection de X*** nous liait. Nous bavardions ; je les quittais pour rentrer chez moi ou pour une promenade, eux restaient et allaient se coucher.
Parfois nous jouions aux cartes, et les derniers temps c’est là que je passais la plupart de mes soirées.
Tout, en X***, me surpassait. Son apparence, d’abord. Il était robuste, j’étais frêle; ma grâce féminine, chétive, s’éclipsait face à son allure virile, ses fortes épaules, ses fortes hanches, sa jambe vigoureuse et son pied solide qui frappait ferme sur le sol en marchant. Prêtez-moi une fine et maigre moustache ; voyez-lui de longs favoris, épais et bouclés, et l’un de ses gestes habituels, réfléchissant ou écoutant, était de les entortiller en y passant les doigts. Les yeux terminaient le portrait, non seulement parce qu’ils étaient grands et beaux, mais parce qu’ils riaient plus et mieux que sa bouche. Outre l’apparence, l’âge ; X*** était un homme de quarante ans, je n’en avais guère que vingt-quatre. Outre l’âge, la vie ; il avait beaucoup vécu, dans un autre milieu, d’où il était sorti pour se blottir dans cette maison, avec cette dame ; moi, je n’avais rien vécu avec personne. Enfin – et c’est là un trait capital – il y avait en lui une fibre castillane, une goutte de ce sang qui circule dans les pages de Calderón, une attitude morale que je puis comparer, sans mépris ni raillerie, à celle du héros de Cervantès.
Comment s’étaient-ils aimés ? Cela datait de loin. Maria avait alors vingt-sept ans, et semblait avoir reçu quelque éducation. On me dit que leur première rencontre avait eu lieu lors d’un bal masqué, à l’ancien Teatro Provisório. Elle portait une jupe courte et dansait au son d’un pandeiro. Elle avait des pieds admirables qui furent, ou ce fut son destin, la cause de l’amour de X***. Jamais je ne lui demandai l’origine de cette (en a-t-il déjà parlé ?) alliance ; je sais seulement qu’elle avait une fille, qui se trouvait en pension et ne venait jamais à la maison ; c’était sa mère qui allait la voir. Nos rapports étaient véritablement respectueux, et le respect allait jusqu’à accepter la situation sans l’examiner.
Quand je commençais à y aller, je n’avais pas encore mon emploi à la banque. Je ne l’eus que deux ou trois mois plus tard et ne cessai pas de les fréquenter pour autant. Maria jouait du piano ; avec son amie Raimunda elles parvenaient parfois à entraîner X*** au théâtre ; je les accompagnais. Nous prenions ensuite le thé dans un salon privé et, une fois ou l’autre, les nuits de pleine lune, nous terminions la soirée en allant à Botafogo en voiture.
Barreto, qui ne commença que plus tard à fréquenter la maison, n’était pas de ces parties-là. C’était cependant un bon compagnon, gai et bouillonnant. Un soir, alors que nous sortions de là, il dirigea la conversation vers les deux femmes et m’invita à les courtiser.
— Tu en choisis une, Simon, et moi, l’autre.
Je m’arrêtai en frémissant.
— Ou plutôt, j’ai déjà choisi, continua-t-il ; j’ai choisi Raimunda. Elle me plaît beaucoup, Raimunda. Toi, tu choisis l’autre.
— Maria ?
— Et qui d’autre ?
Le trouble où me jeta ce tentateur fut tel que je ne trouvais nul mot de refus, nul mot ni geste. Tout me parut alors naturel et nécessaire. Oui, je fus d’accord pour choisir Maria ; elle était de trois ans mon aînée, ayant toutefois l’âge qu’il fallait pour m’apprendre à aimer. Maria, c’est convenu. Nous nous mîmes à nos conquêtes avec ardeur et ténacité. Barreto n’eut pas beaucoup à vaincre ; son élue n’avait pas d’amours, mais elle en avait souffert jusqu’à récemment et avait dû rompre contre son gré, son amant ayant épousé une jeune fille de Minas Gerais.
Elle se laissa vite consoler. Barreto vint un jour, alors que je déjeunais, m’annoncer avoir reçu une lettre d’elle, qu’il me montra.
— Vous vous êtes entendus ?
— Oui. Et vous ?
— Moi, rien.
— Alors, c’est pour quand ?
— On verra bien, je te le dirai.
Je me sentis, ce jour-là, quelque peu vexé. Malgré la meilleure volonté du monde, en effet, je n’osais parler à Maria de mes sentiments. Ne vas pas imaginer là une quelconque passion. Je n’éprouvais aucune passion, plutôt de la curiosité. Quand je la voyais, fraîche et élancée, toute vie et chaleur, je me sentais envahi par une force mystérieuse et nouvelle; mais si, d’une part, je n’avais jamais aimé, Maria était, d’autre part, la compagne de mon ami. Je ne cherche pas par là à expliquer des scrupules, mais juste à faire comprendre ma gêne. Ils vivaient ensemble, l’un pour l’autre, depuis quelques années. X*** me faisait confiance, une confiance absolue, il m’entretenait de ses affaires, me racontait des choses de sa vie passée. En dépit de la différence d’âge, nous étions semblables à des étudiants de la même année.
Comme j’en venais à penser plus souvent à Maria, il est probable que par quelque geste je lui aie dévoilé mon état récent ; le fait est qu’un jour, en lui serrant la main, je sentis que ses doigts s’attardaient plus longuement entre les miens. Deux jours plus tard, me rendant à la poste, je l’y trouvai timbrant une lettre pour Bahia. N’avais-je pas encore dit qu’elle était Bahianaise ? Elle était Bahianaise. Ce fut elle qui m’aperçut en premier et qui vint me parler. Je l’aidai à mettre le timbre, puis nous prîmes congé. À la porte, j’allais dire quelque chose, lorsque j’aperçus X*** devant nous, immobile.
— Je suis venue poster ma lettre pour Maman, s’empressa-t-elle de dire.
Elle nous dit adieu et rentra chez elle ; lui et moi prîmes une autre direction. X*** en profita pour faire l’éloge de Maria. Sans entrer dans le détail de l’origine de leur relation, il m’assura que ça avait été un grand coup de foudre pareillement partagé, et conclut que sa vie était dès lors toute tracée.
— Je ne me marierai plus désormais ; je vis maritalement avec elle, avec elle je mourrai. Je ne regrette qu’une chose, c’est de devoir vivre séparé de ma mère. Ma mère le sait, dit-il en s’arrêtant. Puis, reprenant sa marche : elle le sait, elle m’en a même déjà fait une allusion, très vague et lointaine, mais j’ai saisi. Il semble qu’elle ne me désapprouve pas ; elle sait que Maria est une fille bonne et sérieuse, et du moment que je suis heureux elle n’en demande pas davantage. Le mariage ne m’apporterait rien de plus…
Il me dit bien des choses encore, que j’écoutais éperdu ; mon coeur battait ferme, mes jambes marchaient flasques. Je ne trouvais aucune réponse appropriée ; les quelques mots que je prononçais s’étranglaient dans ma gorge. Au bout d’un moment, il perçut mon état et interpréta de travers ; jugeant que ses confidences m’ennuyaient, il me le fit remarquer en riant. Je rétorquai d’un ton sérieux :
— Je t’écoute avec intérêt, au contraire, et il s’agit de gens très dignes de considération et d’estime.
Je pense aujourd’hui que je cédais là inconsciemment à un certain besoin d’hypocrisie. L’âge des passions est un âge confus, et je ne peux bien discerner, dans cette situation, les sentiments et leurs causes. Il n’est toutefois pas exclu que je cherchais alors à dissiper dans l’esprit de X*** toute ombre de méfiance. Toujours est-il qu’il m’écoutât reconnaissant. Ses grands yeux d’enfant m’enveloppèrent en
entier, et lorsque nous prîmes congé, il me serra vigoureusement la main. Je crois même l’avoir entendu qui disait : « Merci ! ».
Je n’étais pas accablé en le quittant, ni touché de remords préalables. La première impression de cette confidence se dissipant, ne restait que la confidence, et je sentis croître en moi l’agitation de la curiosité. X*** m’avait parlé de Maria comme d’une personne chaste et conjugale ; aucune allusion à ses attributs physiques, mais mon âge me dispensait de toute référence directe. Là, dans la rue, je me représentais par coeur l’image de la jeune femme, ses gestes aussi languides que robustes, et je me sentais de plus en plus bouleversé. Sitôt rentré, je lui écrivis une lettre longue et diffuse que je déchirais au bout d’une demi-heure, puis je sortis dîner. Après dîner, je me rendis chez X***.