J’ai eu la chance d’assister aujourd’hui pour la 3ème fois en 8 jours à « Siegfried » à l’Opéra Bastille (invitée par 3 personnes différentes !) et pense, malgré les excellents moments passés encore ce dimanche, que c’est tout de même très inférieur à la version Chéreau-Boulez dont voici un extrait http://www.youtube.com/watch?v=OeqHvN5qGFw
Auteur : Guilaine Depis
Dédicace de « Confessée » par Marie L. / mon article sur son livre
« Tu étais délicieuse comme toujours… Très touchée par ta présence hier chez Colette… et que vive encore longtemps Walter Steiger ! » m’écrit Marie L. après m’avoir embrassée à sa dédicace chez Colette ce samedi 5 mars… Son éditeur, Emmanuel Pierrat, était présent, ainsi que plusieurs amis. Voici mon article sur son livre paru dans Le Magazine des Livres de mai 2011.
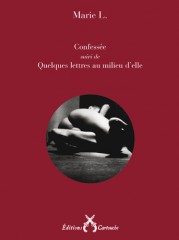 L’écriture de l’extrême limite, par Guilaine Depis
L’écriture de l’extrême limite, par Guilaine Depis
Amie de feu Pierre Bourgeade avec lequel elle coécrivit un livre, L’Autre Face (Arléa, 2000), Marie L. est un sacré phénomène d’existence comme d’écriture. Miracle de la Vie ou maîtresse de la Mort, c’est selon : la belle est partie dès son plus jeune âge explorer le penchant sombre du monde, ses poubelles – dans lesquelles elle adore réaliser des photos artistiques – afin de regarder droit dans les yeux les pires obscénités. Celles imposée par la société où le Mal partout rayonne, faisant sa loi en totale impunité et celles dont elle s’est sentie capable. Supérieures bien entendu. Histoire de mater le réel, de lui montrer qui dominait, qu’elle pouvait lui tenir la dragée haute. Car à quoi bon s’avilir et souffrir le martyr si ce n’est pas pour triompher des crasses non choisies intrinsèques à cette salope de vie ? Intrusion dans l’intime de l’auteur, aucun sordide ne nous est épargné dans ce récit autobiographique frappant par son unique impudeur, son goût de sperme et de sang mêlés, sa jouissance détournée, son mysticisme perverti. Quête d’une inatteignable transcendance, Confessée s’inscrit dans la grande tradition poétique et/ou romantique qui magnifie la douleur comme inspiratrice. Quelques lettres au milieu d’elle, abécédaire ajouté dans la présente réédition, nous livre des épisodes plus récents de la chute, préalable à un spectaculaire rebond, de cette âme si torturée et paradoxalement confiante dans sa création littéraire et photographique. Rilke aurait certainement aimé Marie L. dont l’ultime plume ne connaît ni limite ni frein, car son expression revêt toujours un aspect nécessaire. Sa fragilité absolue mi-sainte mi-sorcière lui confère une puissance diabolique et surhumaine. La splendeur de ses errances métaphysiques vient probablement du fait que fort éloignée d’un quelconque aveuglement ou prosélytisme masochiste, elle pose un regard on ne peut plus lucide et sain sur ses névroses. S’avoue prise au piège de ses folles ambitions de pouvoir et nous fait craquer par cette honnêteté. On a envie de la sauver en même temps qu’on envie son sort hors du commun, son destin dément de volupté tour à tour infernale puis céleste grâce à la sublimation dans l’écriture rédemptrice.
Confessée (première édition chez Climats, 1996) suivi de Quelques lettres au milieu d’elle, par Marie L., éd. Cartouche, 263 pages, 18 euros.
« Cendrillon » de Jules Massenet à l’Opéra Comique
la générale du « Cendrillon » de Jules Massenet à l’Opéra Comique : pas mes goûts, un peu trop « léger »… http://www.opera-comique.com/fr/cendrillon/cendrillon.html
Thibault Isabel et les éditions de la Méduse
J’ai découvert les éditions de la Méduse dans un dîner du Cercle Orwell autour de son penseur-fondateur, docteur en esthétique et anthropologue, Thibault Isabel http://www.thibaultisabel.com/
« Les femmes du 6ème étage »
adoré « Les Femmes du 6ème étage » avec Fabrice Luchini
Yves Christen « L’animal est-il une personne ? »
un dîner au Bistrot Jadis avec le Cercle Orwell dont le conférencier ce soir était Yves Christen, ancien du G.R.E.C.E., sur le thème « L’animal est-il une personne? »… PASSIONNANT ! http://www.youtube.com/watch?v=jibbySZxTAc
Pietro Giuseppe à l’Espace Cardin
Vue ce soir à l’Espace Cardin, l’exposition de bronzes vénitiens du sculpteur Pietro Giuseppe Tito http://www.italieaparis.net/actualite/news/pietro-giuseppe-tito-11123/
« Les Niebelungen » de Fritz Lang (1923)
Je vais voir « Les Niebelungen » de Fritz Lang (1923) à 14h. Une projection exceptionnelle au Cercle Wagner dont je suis membre bienfaiteur.http://www.arte.tv/fr/Film-muet–Les-Nibelungen/3174656.html
Michèle Iznardo à la Galerie Nabokov
Allez voir la galerie Nabokov ! 26 place Dauphine : peintures de Michèle Iznardo http://www.galerienabokov.com/Expositions.html
Colloque sur Céline au Centre Pompidou
Colloque sur Céline au Centre Pompidou, qui continue jusqu’à demain soir…avec le grand Francois Gibault