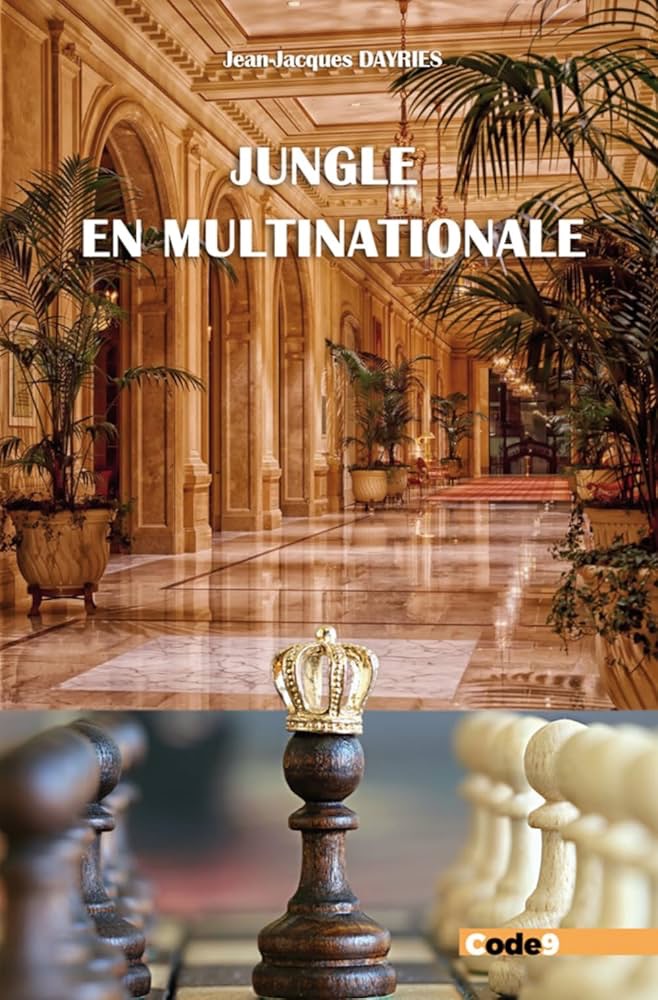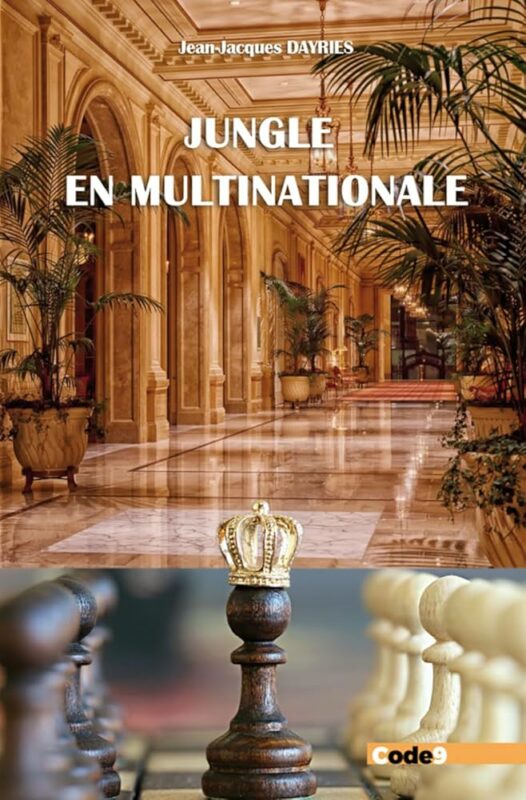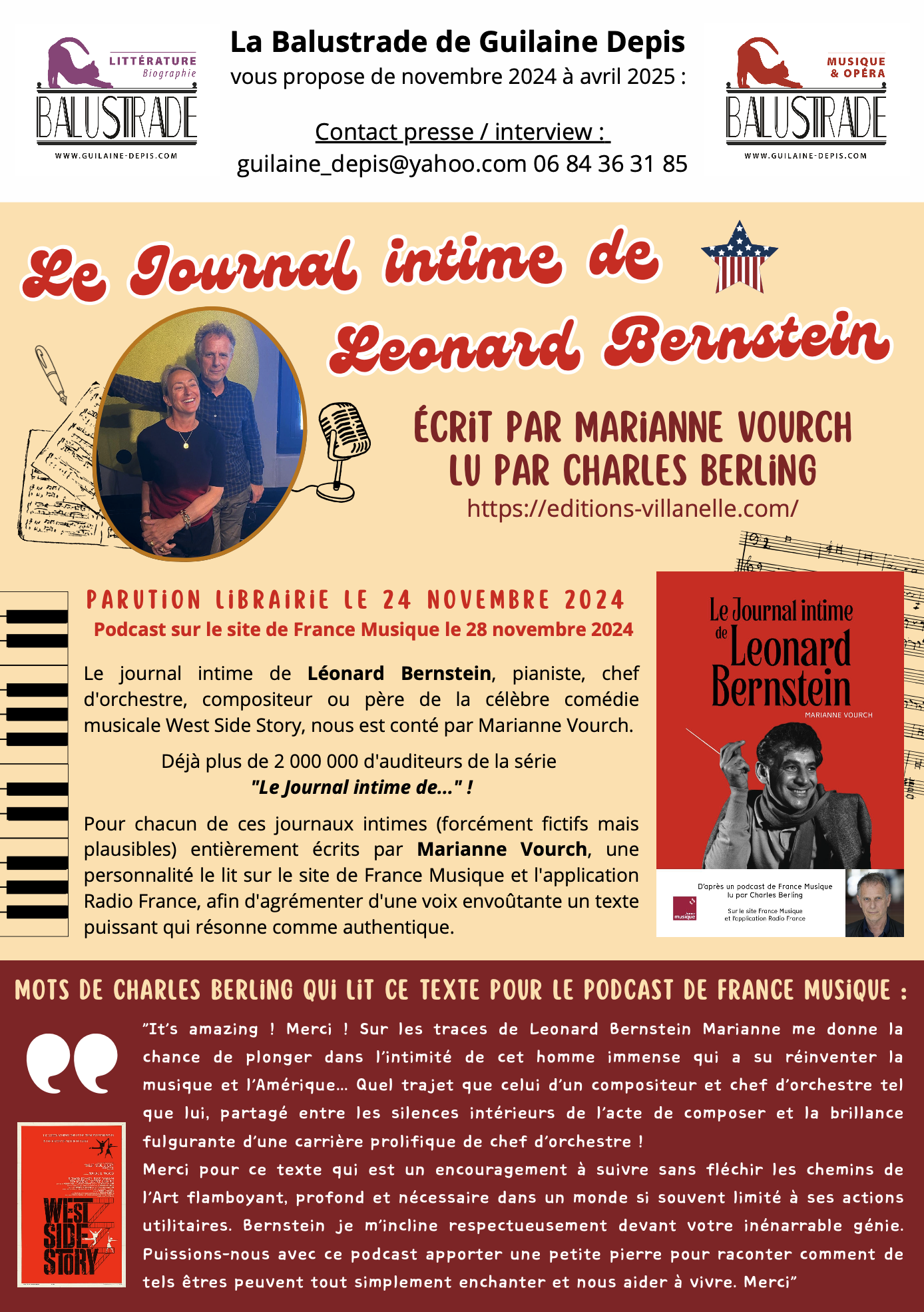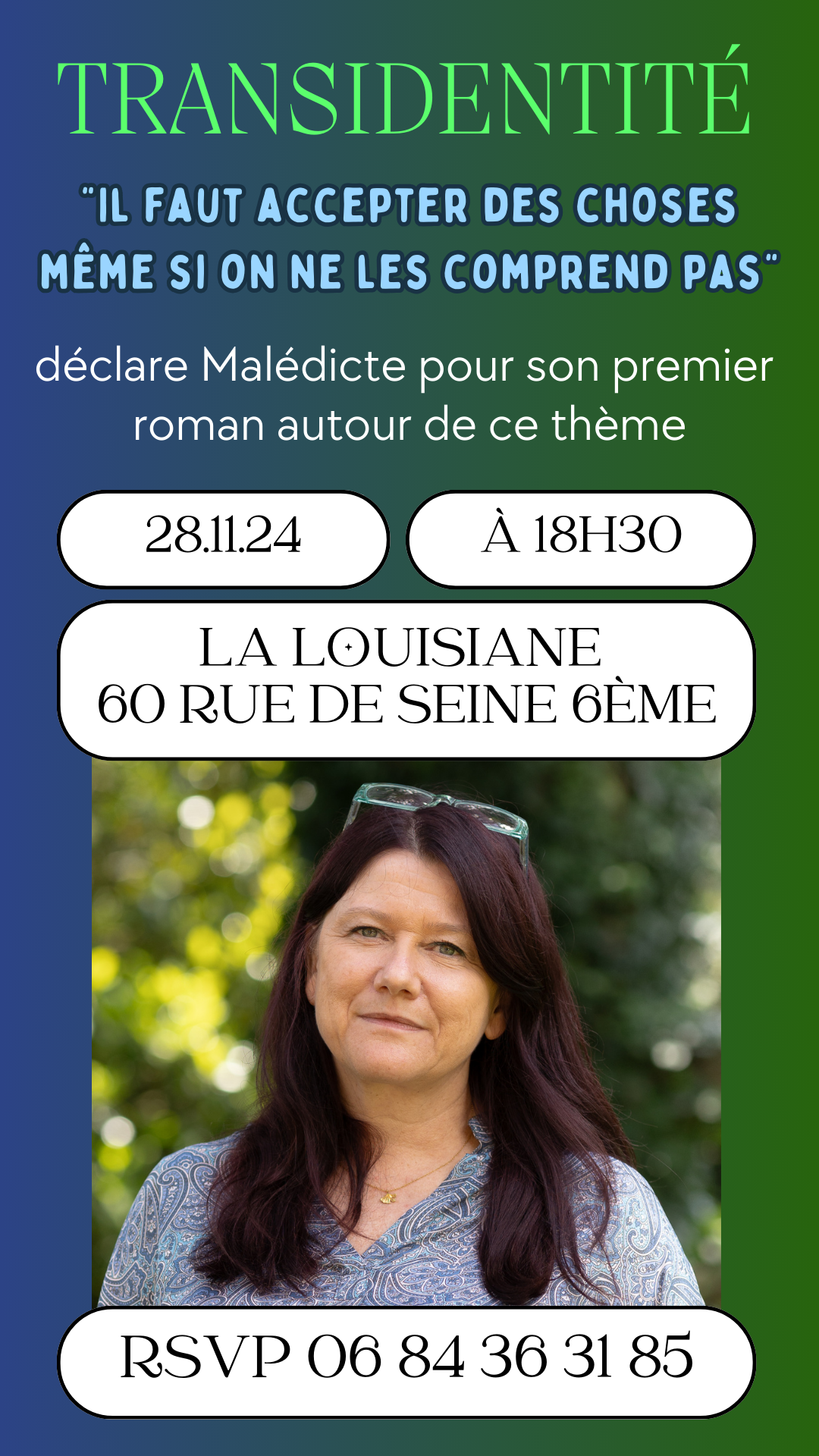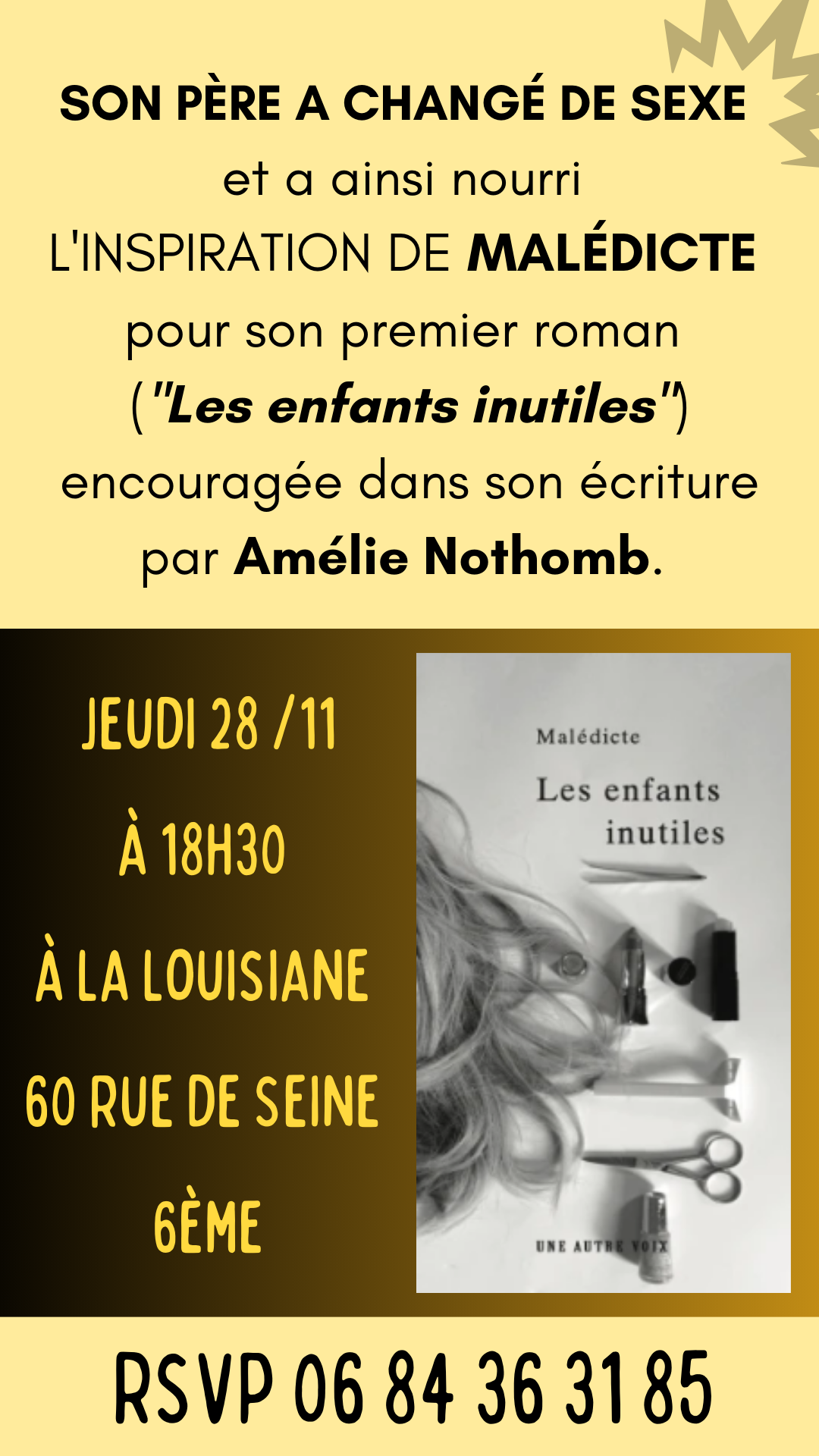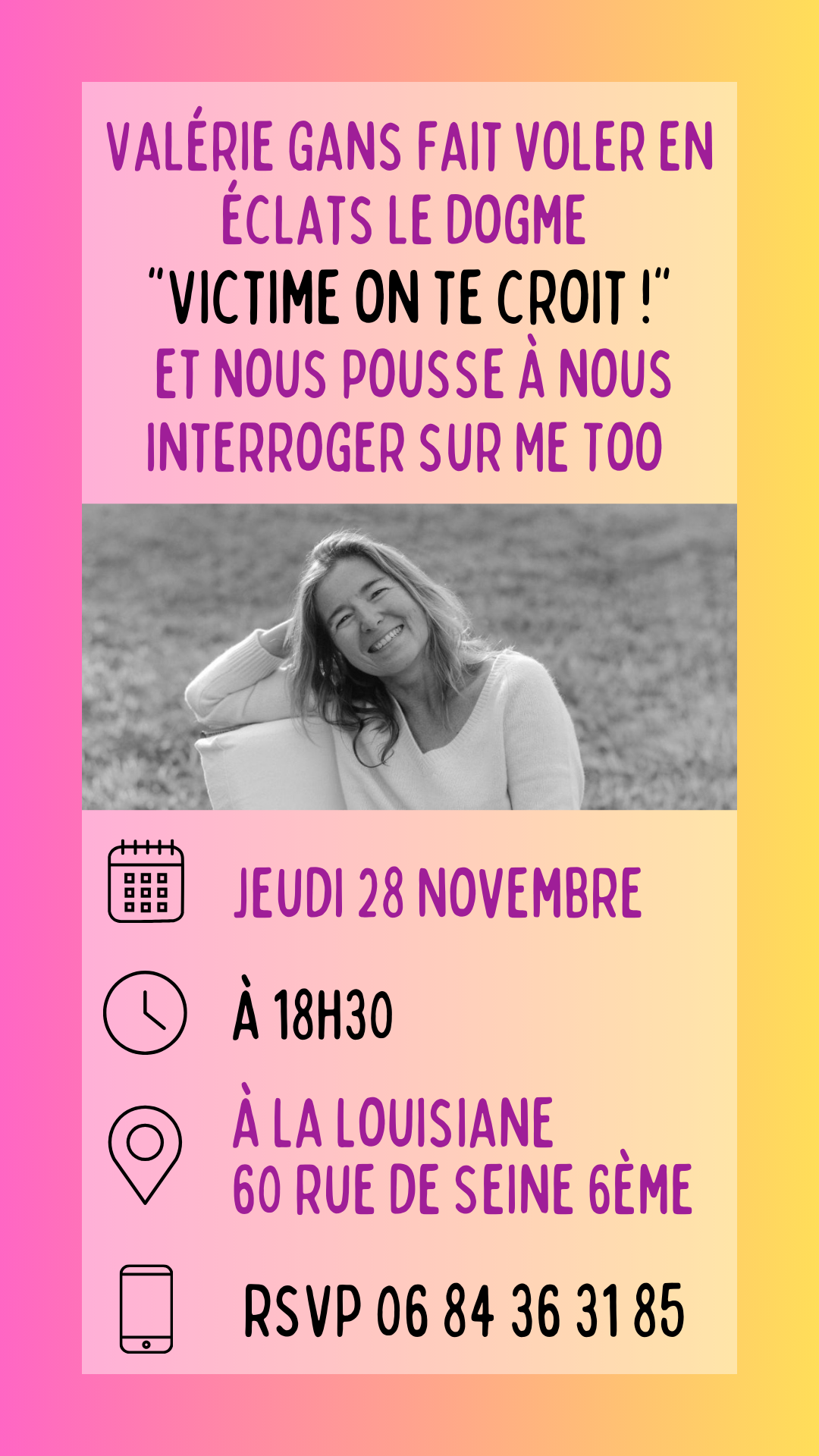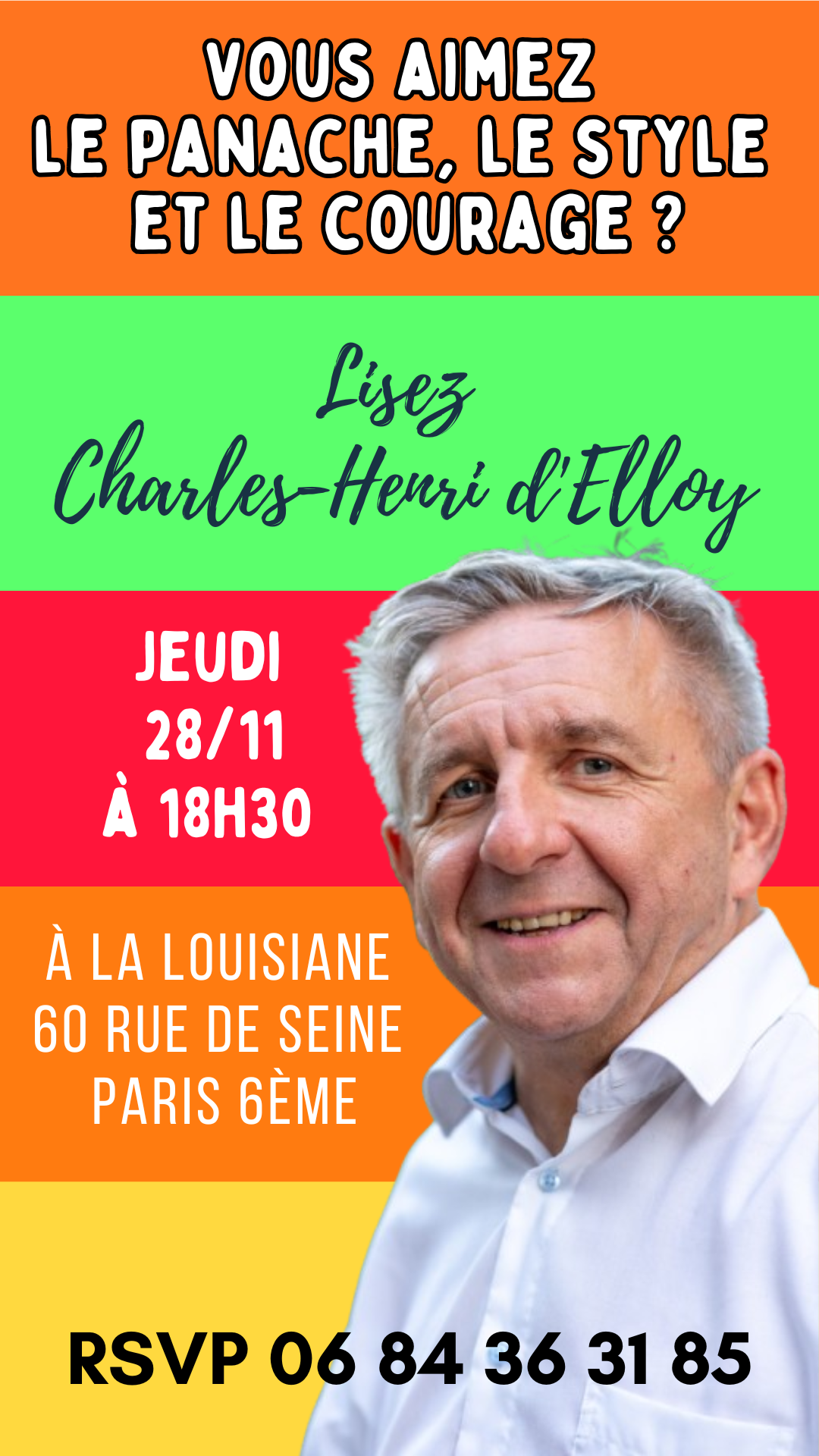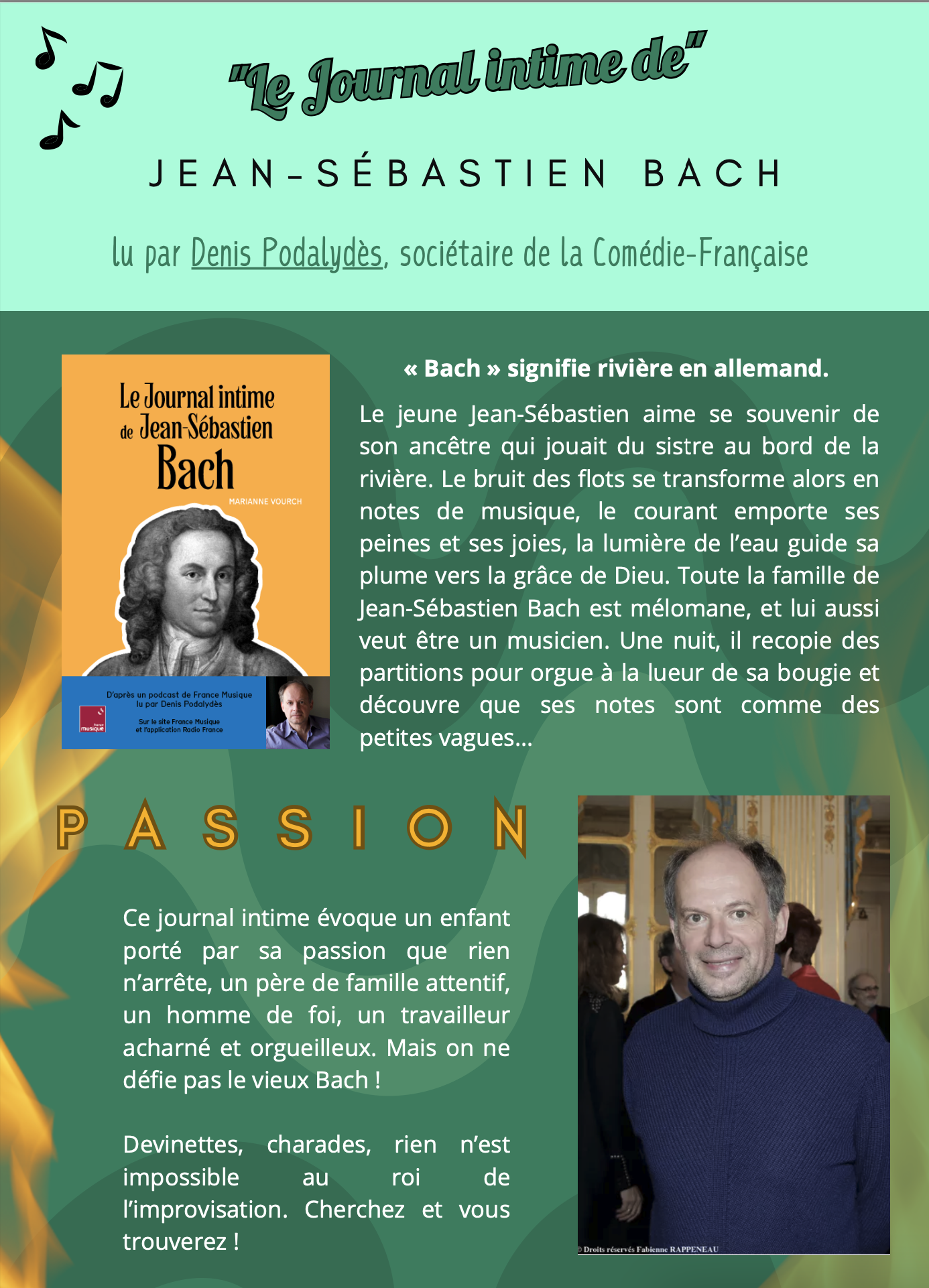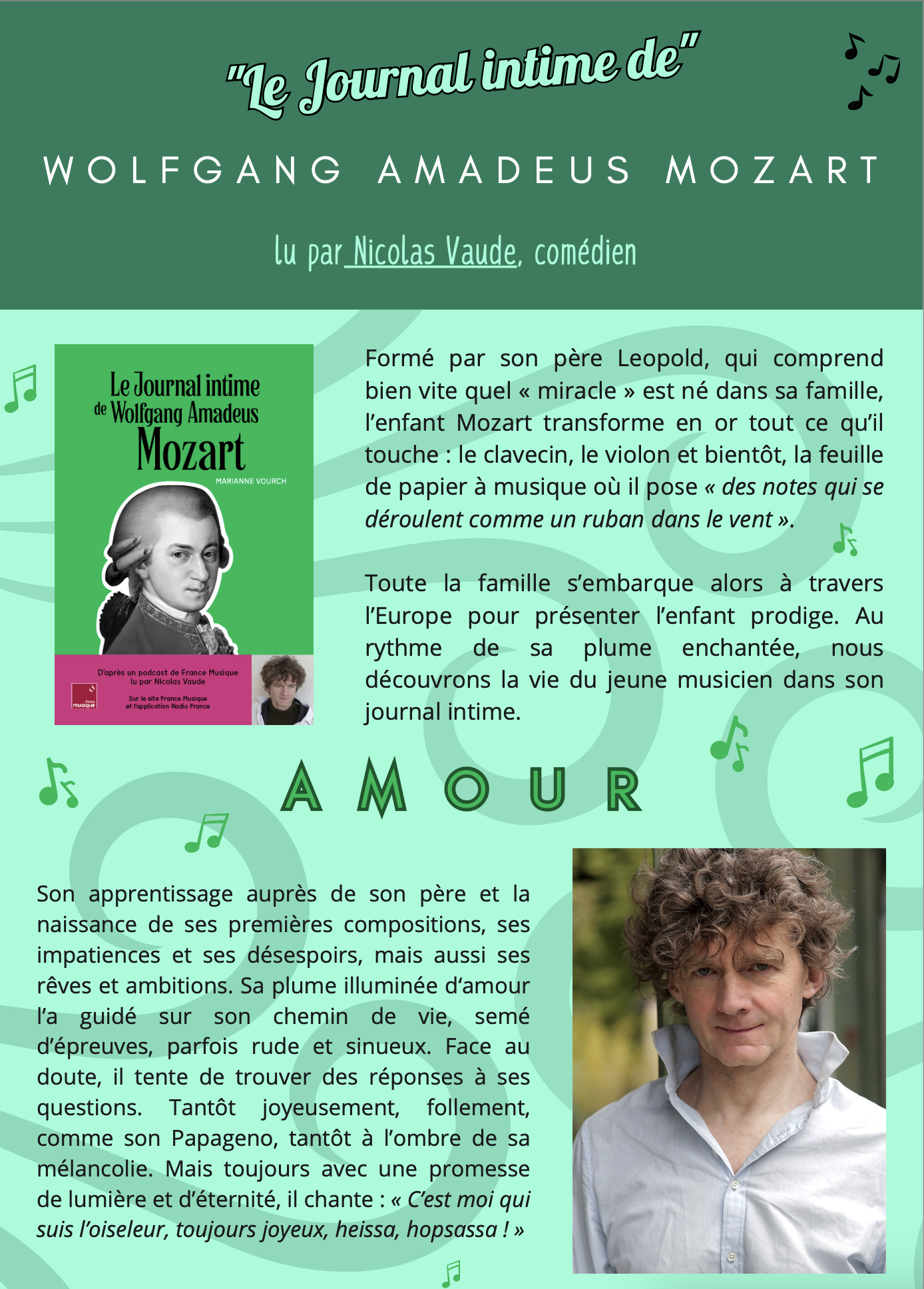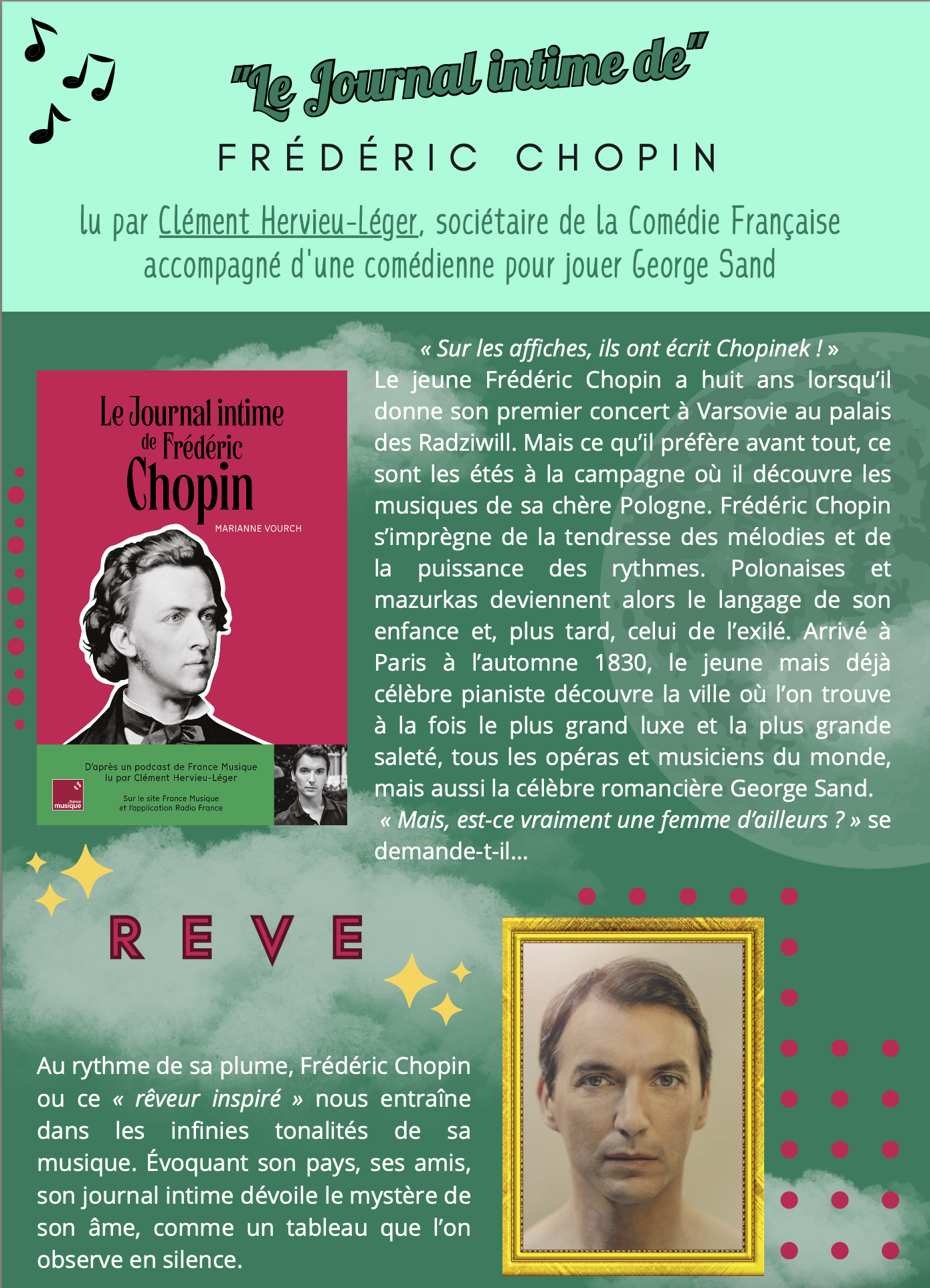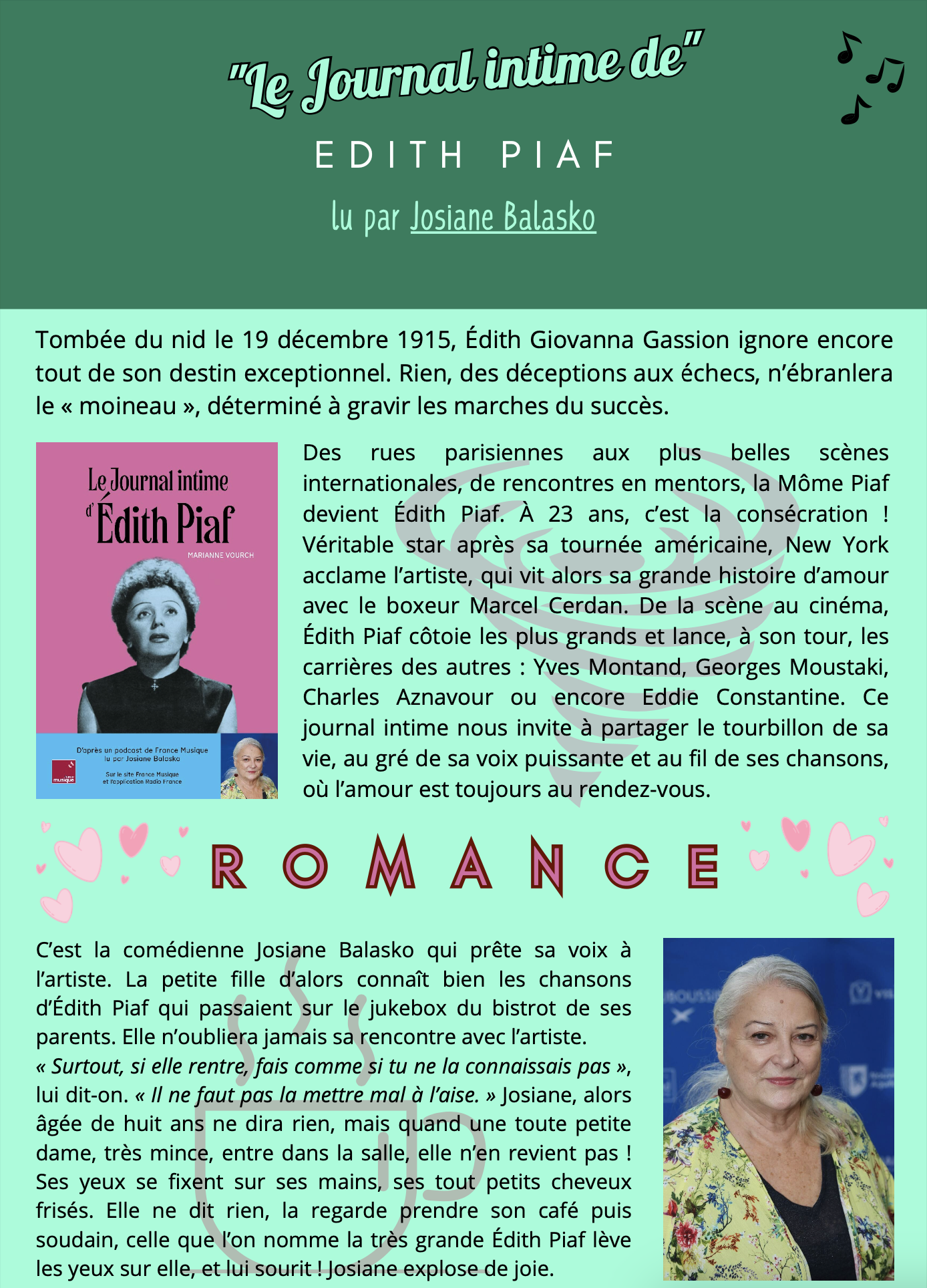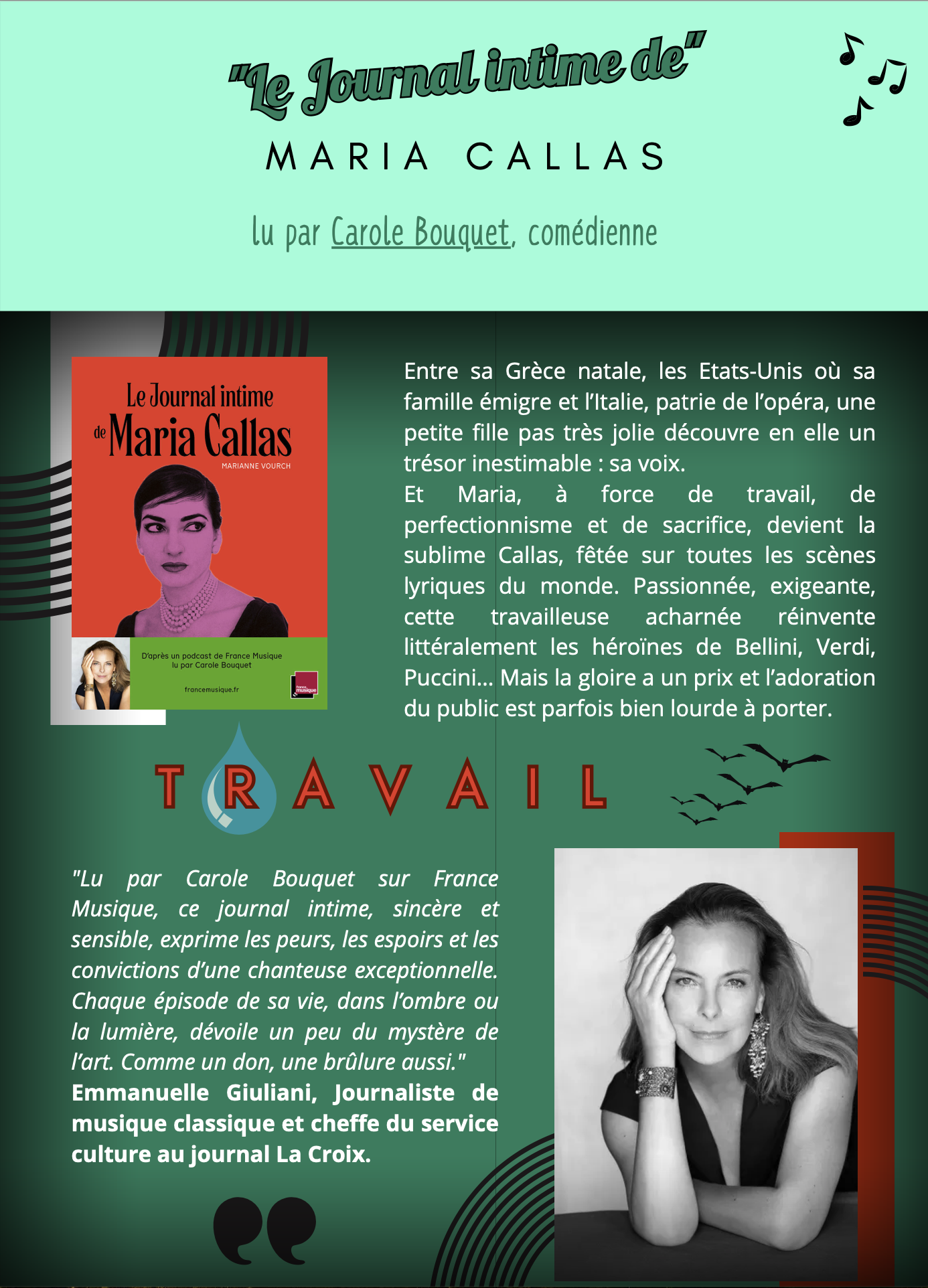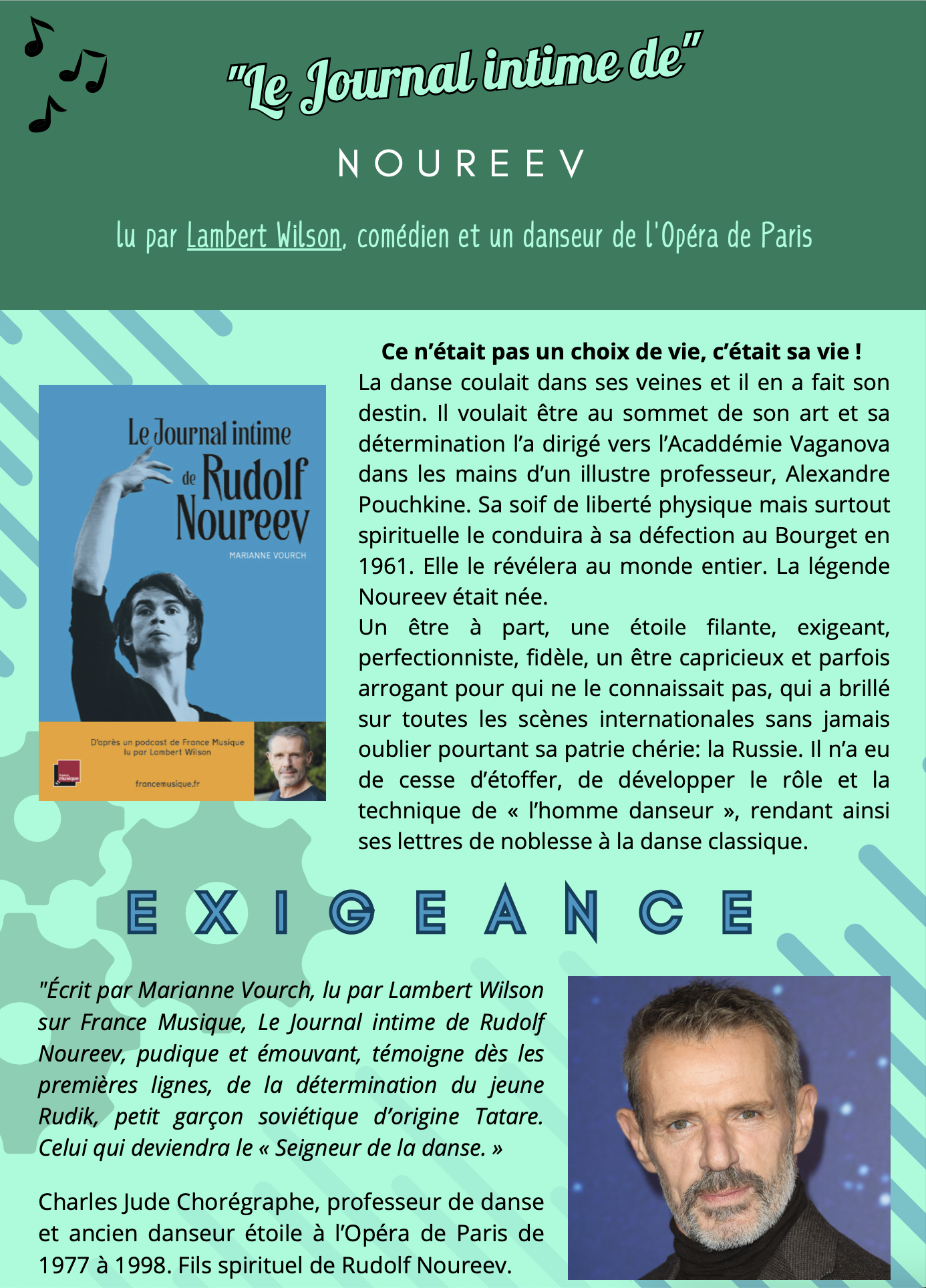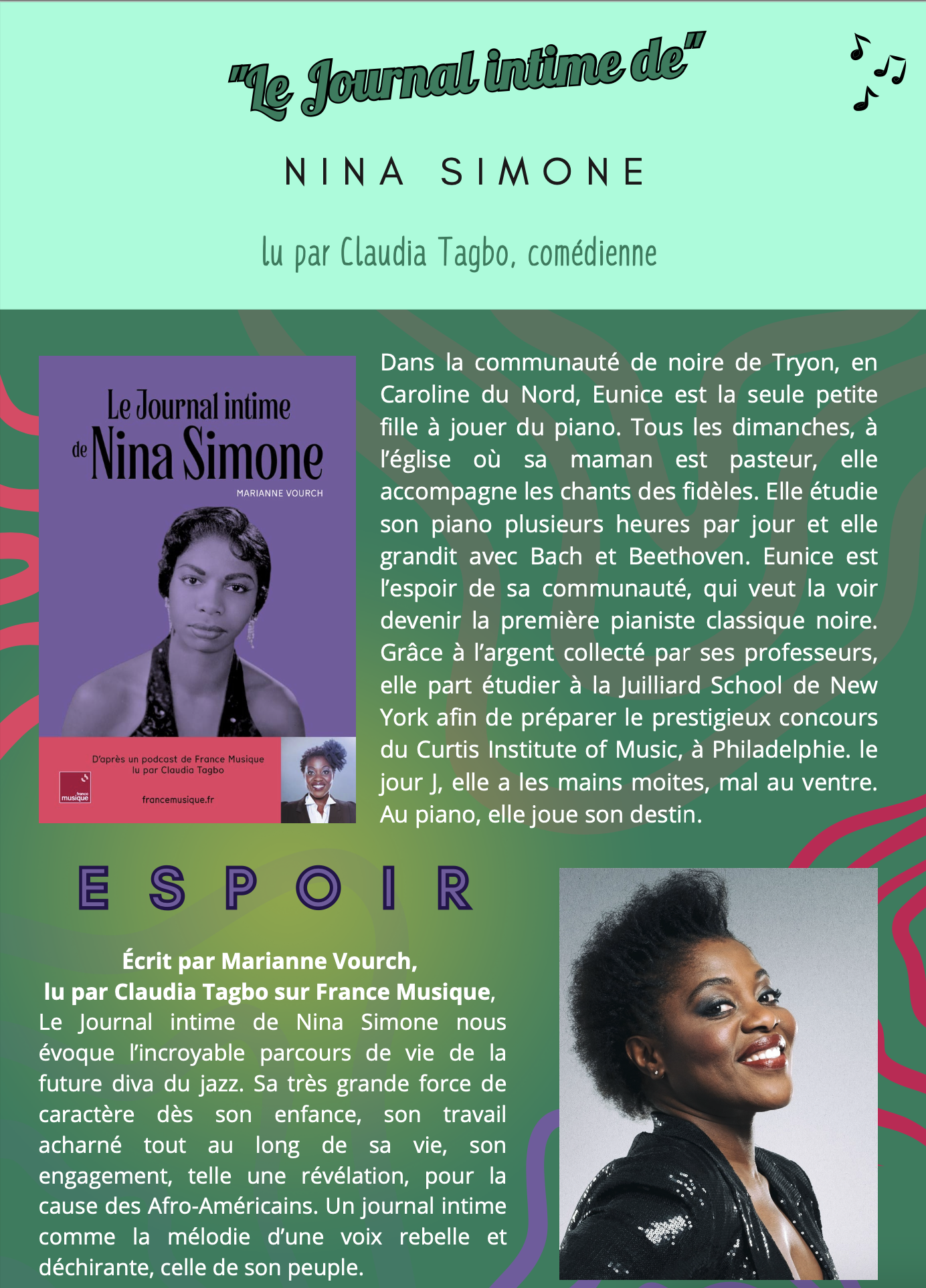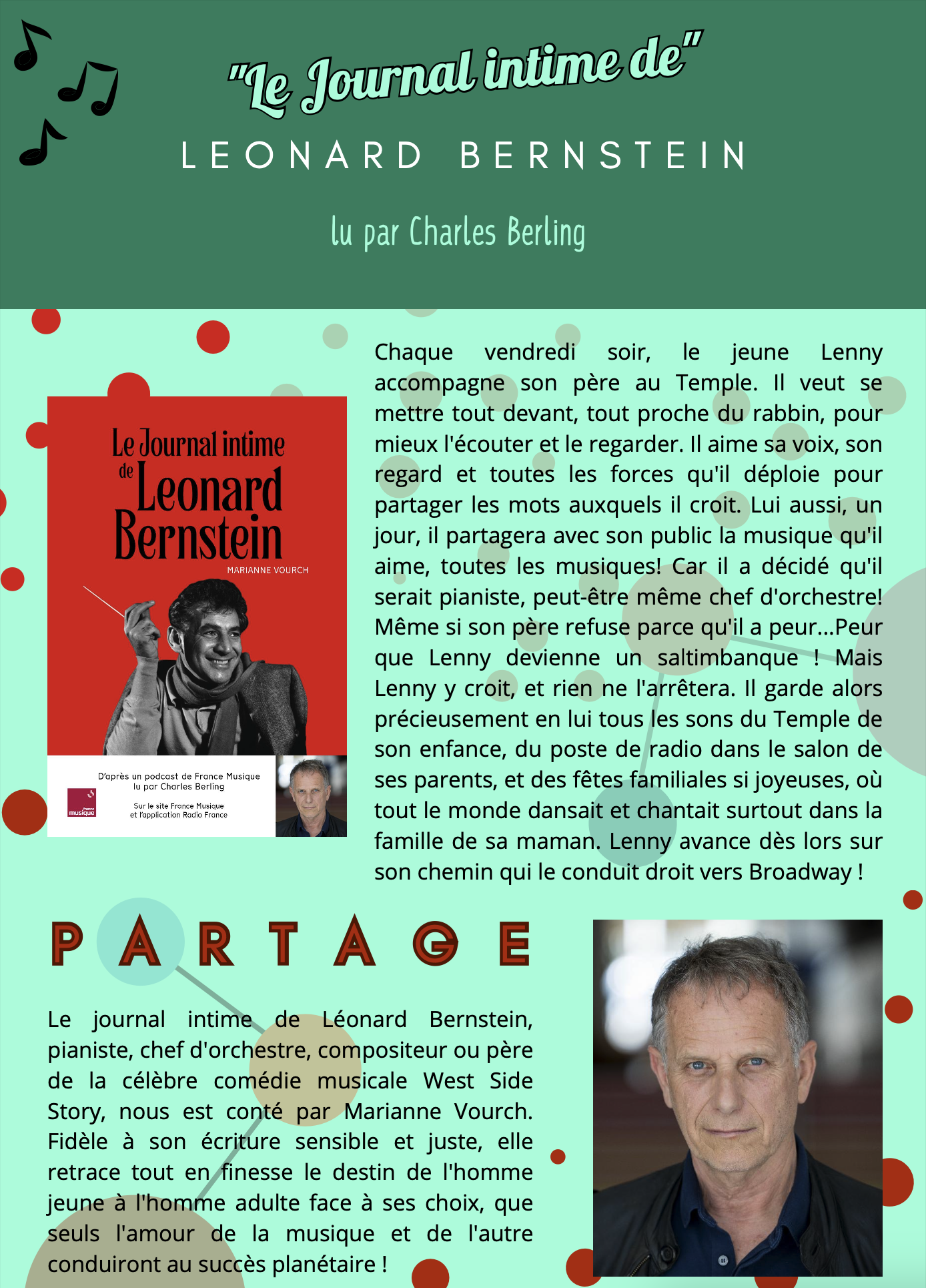Histoires de Veillées : Une trilogie enchanteresse pour les tout-petits, loin du tout
Histoires de Veillées : Une trilogie enchanteresse pour les tout-petits, loin du tout
Par Yves-Alexandre Julien
 Après le lancement du captivant premier tome Le Bois de Caruos, les enfants pourront bientôt découvrir deux nouvelles aventures : La Journée Mystère à l’Envers le 17 février 2025, et Mystère, Mystères le 14 avril 2025. Éditée par les Presses d’Île-de-France, cette série éveillera la curiosité des jeunes lecteurs tout en les guidant à travers des récits riches en enseignements et en merveilles visuelles.
Après le lancement du captivant premier tome Le Bois de Caruos, les enfants pourront bientôt découvrir deux nouvelles aventures : La Journée Mystère à l’Envers le 17 février 2025, et Mystère, Mystères le 14 avril 2025. Éditée par les Presses d’Île-de-France, cette série éveillera la curiosité des jeunes lecteurs tout en les guidant à travers des récits riches en enseignements et en merveilles visuelles.
À une époque où les écrans captent une attention croissante, cette collection de bandes dessinées jeunesse propose une alternative audacieuse. Avec ses intrigues fantastiques et ses personnages attachants, elle célèbre des valeurs universelles comme le courage, l’amitié et la découverte. Les héros, Théo et Myla, grandissent à travers des aventures empreintes de magie et de mystères.
Des histoires pour nourrir l’imaginaire
Chaque tome plonge les jeunes lecteurs dans des univers où la nature, l’aventure et l’entraide remplacent la digitalisation omniprésente. À travers leurs périples, Théo, Myla et leurs amis découvrent des mondes invisibles, rencontrent des créatures fantastiques et apprennent des leçons essentielles pour grandir. Ces récits célèbrent le courage et la curiosité, rappelant que le véritable pouvoir réside dans l’imagination et l’exploration.
Pourquoi lire cette collection ?
Les aventures de Théo et Myla ne se contentent pas de stimuler l’imagination. Elles abordent aussi des thèmes profonds et inspirants. Chaque tome invite les lecteurs à s’interroger : que signifie grandir ? Quelles sont les valeurs essentielles de l’amitié ? Que peut nous enseigner la nature sur nous-mêmes ?
Cette collection incite les enfants à voir au-delà des apparences et à explorer un monde riche de mystères. Une invitation rafraîchissante à poser les écrans et à redécouvrir la richesse du réel.
Des albums qui éveillent et accompagnent
Loin des distractions numériques, Histoires de Veillées offre une expérience immersive avec des récits concis, des illustrations vibrantes et des valeurs intemporelles comme l’entraide et la sincérité. Destinée aux enfants dès trois ans, la série propose des histoires riches en symboles, peuplées de créatures extraordinaires et bienveillantes.
Dans Le Bois de Caruos, Théo rêve de camper avec sa grande sœur Myla. Mais cette veillée au coin du feu prend une tournure magique : il doit sauver le Roi Feu, une figure mythique incarnant l’esprit des feux de camp. Guidé par le sylphe Blogane, Théo traverse une forêt peuplée de créatures fantastiques et apprend à surmonter ses peurs et à faire preuve de courage. Ce premier tome introduit un univers enchanteur où la nature dévoile ses secrets à ceux qui savent écouter.
« La Journée à l’Envers » : Une aventure renversante
Dans ce deuxième tome, Théo, Myla et leurs amis sont miniaturisés et découvrent un monde où les insectes deviennent leurs guides. Cette transformation leur offre une perspective nouvelle et leur enseigne le courage et l’humilité.
L’histoire débute avec Myla, frustrée de ne pas être cheftaine, qui entraîne ses amis au pied d’un arbre enchanté. Ignorant l’avertissement du sylphe Kawane, les enfants se retrouvent réduits à la taille d’insectes. Ils doivent alors naviguer dans ce monde immense, où chaque brin d’herbe est un défi. Cette aventure pousse les jeunes lecteurs à réfléchir sur la responsabilité et la coopération.
« Mystère, Mystères ! » : Un voyage initiatique au cœur de la forêt
Pour leur dernière veillée de l’année, Théo, Myla et leurs amis se lancent dans une chasse au trésor mystérieuse. Une série de signes tracés sur des arbres les guide, mais un hibou sage les avertit : « Méfiez-vous des apparences. »
La forêt devient le théâtre d’un périple initiatique rempli de surprises et d’énigmes. Les enfants apprennent à se fier à leur intuition et à compter les uns sur les autres. L’histoire explore l’importance de la solidarité et montre que le véritable trésor réside dans les leçons apprises en chemin.
Un livre-objet à chérir
À l’ère du numérique, ces albums rappellent l’importance du livre physique : un objet que l’enfant peut explorer et s’approprier. Les illustrations immersives de Neyptune transportent les lecteurs dans des paysages oniriques où chaque détail invite à l’émerveillement. Sa vision sensible de la nature rappelle l’approche de Claude Ponti ou Maurice Sendak, avec des images qui nourrissent à la fois l’imagination et les émotions.
Des récits universels au-delà du scoutisme
Bien que les aventures s’inspirent du scoutisme, elles abordent des thèmes universels comme l’amitié, le respect de la nature et la quête de soi. Chaque page invite les enfants à grandir, à s’ouvrir aux autres et à devenir plus autonomes. Ces albums, bien plus que de simples divertissements, sont des outils d’éveil moral et social.
Un duo créatif en parfaite harmonie
Le texte poétique de Hemvé s’allie parfaitement aux illustrations vibrantes de Neyptune. Ensemble, ils créent un univers à la fois accessible et enchanteur, où chaque détail invite à la contemplation et à l’imaginaire. Neyptune joue avec les couleurs et les formes pour donner vie à un monde magique qui dialogue directement avec les jeunes lecteurs.
Un jeu-concours pour les petits créateurs
Pour célébrer cette collection, un jeu-concours intitulé « Théo, Myla et Vous » invite les enfants à créer leur propre aventure inspirée de Le Bois de Caruos. Les récits gagnants seront mis à l’honneur lors d’un événement spécial à la librairie Libre Champs, avec des récompenses comme une œuvre exclusive de Neyptune.
Une invitation à grandir autrement
Avec Histoires de Veillées, les enfants découvrent des récits qui nourrissent leur imagination tout en les connectant au monde réel. Chaque tome explore des valeurs essentielles : le courage, la curiosité et l’amitié. Une série qui, loin des écrans, invite à ralentir, à rêver et à explorer.
Prêts à embarquer dans l’univers de Théo et Myla ? Laissez-vous porter par ces récits enchanteurs qui éveillent l’esprit et le cœur des petits et des grands.


 Jérôme Enez-Vriad a lu “Jungle en multinationale” de Jean-Jacques Dayries
Jérôme Enez-Vriad a lu “Jungle en multinationale” de Jean-Jacques Dayries