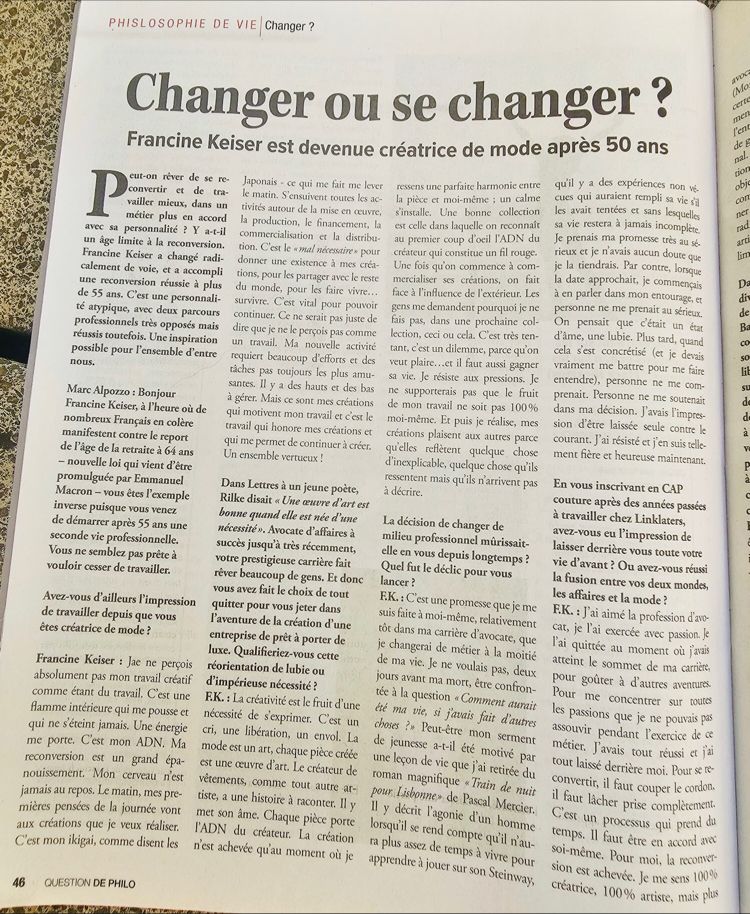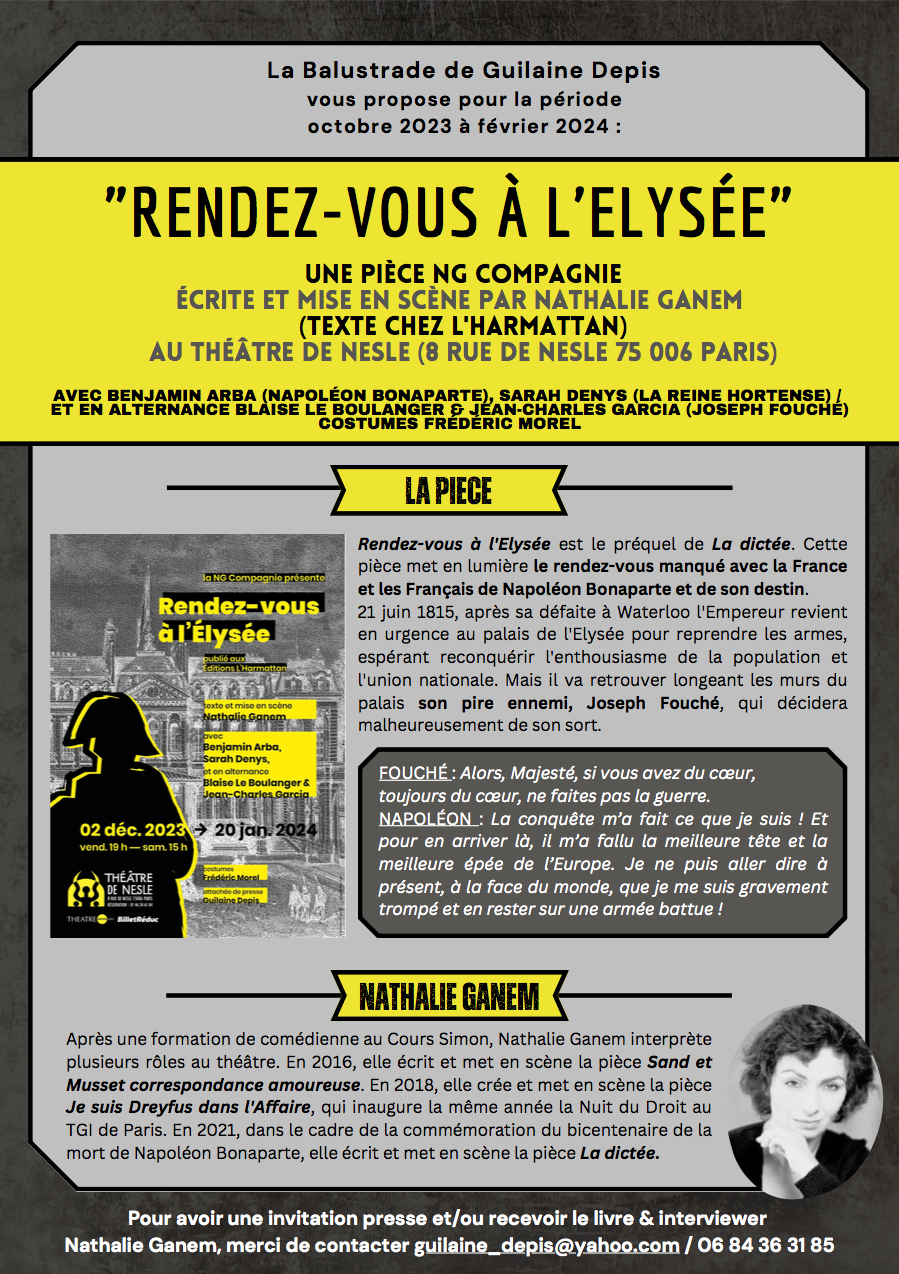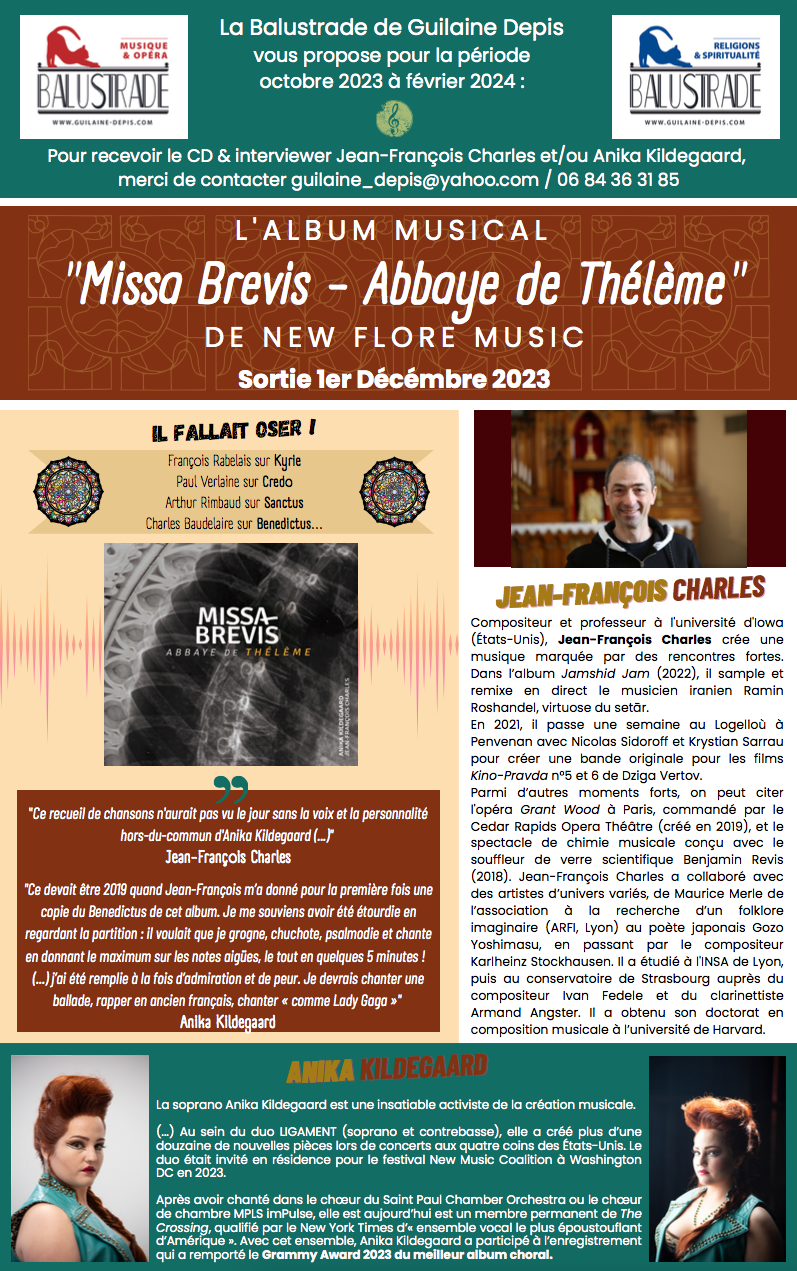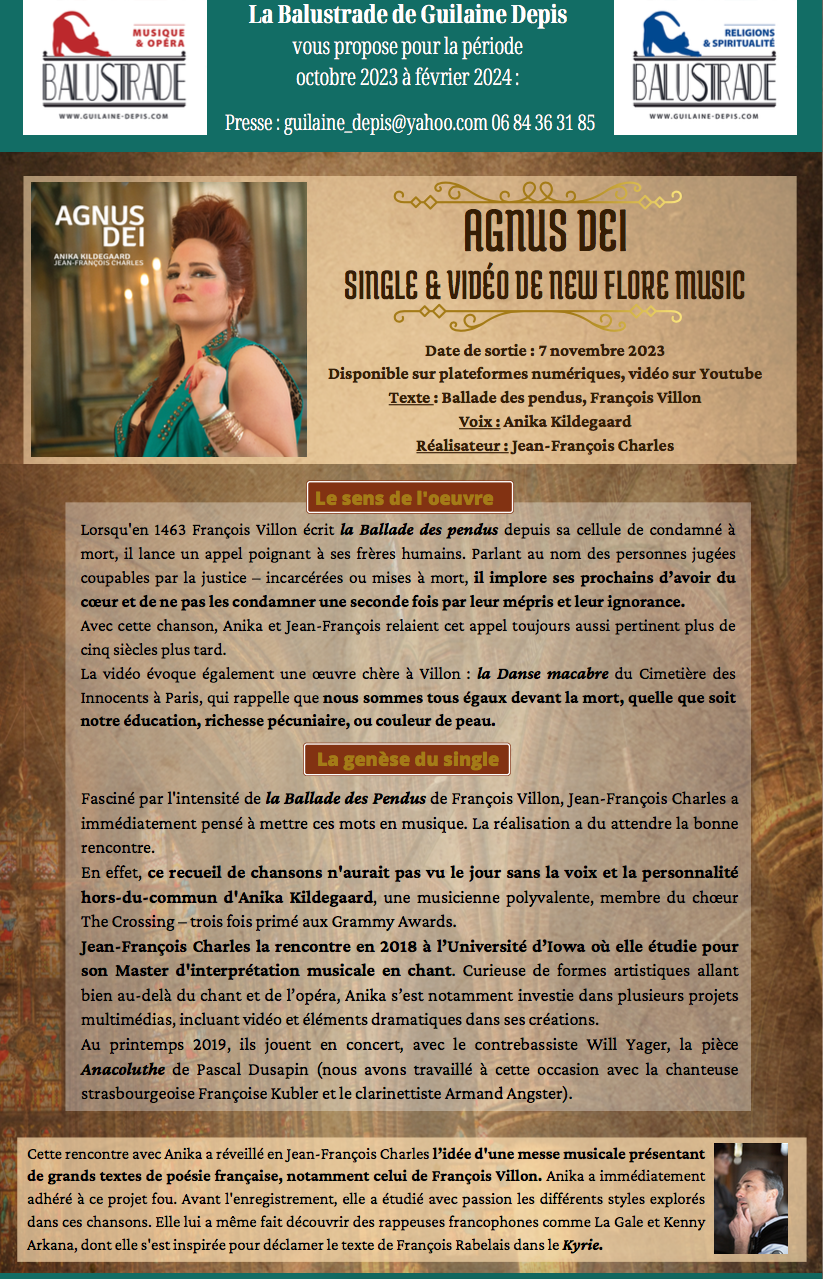Étienne Ruhaud est critique littéraire et directeur de collection aux éditions Unicité.
Doper son esprit critique… Essai au titre programmatique, le nouveau livre d’Emmanuel-Juste Duits, cofondateur du site Wikidébats, nous invite à dépasser notre confort intellectuel, nos certitudes, et définit ce qui pourrait être le fondement d’un authentique esprit d’ouverture, et ce au cœur d’un monde complexe, mondialisé, multiculturel, où chacun semble se replier sur ses valeurs. Soucieux d’éviter le double écueil du relativisme, comme de l’idéologisme et de l’enfermement, l’homme-réseau défini par l’auteur devrait ainsi pouvoir réellement dialoguer, au sens socratique du terme. Pour ce faire, plusieurs pistes sont envisagées: cela passerait à la fois par une nouvelle approche de l’information, du principe même du débat, mais aussi par une autre façon d’envisager l’école, entre autres.
Phénomène récent, postérieur aux années 1980, la mondialisation créée une société complexe, où se croisent plusieurs groupes ethniques et sociaux, aux valeurs différentes, ce qui peut générer un stress constant. Aujourd’hui, l’Occidental moyen peut choisir divers systèmes de valeurs, somme toute très différents. Certains sont tentés, dès lors, par le repli sur soi, sur des valeurs anciennes ou sur le communautarisme, quand d’autres se lancent dans une course sans fin à la consommation. Le philosophe propose, lui, un changement de paradigme, en commençant par renoncer aux anciennes idéologies, qui ont échoué (particulièrement dans le cas du communisme), pour inventer quelque chose d’autre, sans pour autant sombrer dans le relativisme.

Le point de départ consisterait à accepter la nature multiculturelle de notre société, afin d’éviter tout affrontement communautaire et de réinventer un mode de vie enthousiasmant. Il ne s’agirait pas de choisir nécessairement tel ou tel système de pensée, ni de tout mélanger en un syncrétisme finalement peu opérant, mais bien d’adopter des «actions adaptées à un monde mouvant et complexe» (p. 17), afin notamment de pouvoir vivre ensemble de manière harmonieuse. Le but du philosophe semble donc ambitieux, peut-être à ranger dans la catégorie des utopies, comme il l’admet fort bien lui-même.
Face au monde «mouvant et complexe» (p. 17), il nous faut mener, de front, une «révolution intérieure» et extérieure, afin de muer en ce que Emmanuel-Juste Duits appelle un «homme réseau», soit un homme capable d’aborder la complexité du monde afin de devenir citoyen, au sens noble et entier du terme. Offrant apparemment une multiplicité de points de vue, de perspectives et d’idéologies, la mondialisation aboutit paradoxalement à une forme d’uniformisation, essentiellement sur le modèle américain. Nous ne sommes pas dans le spectre de l’arc-en-ciel, mais bien plutôt dans une sorte de grisé, comme si toutes les couleurs, en se confondant, perdaient leur caractère propre. Cela semble effectivement contradictoire.
En premier lieu, face aux multiples modes de vie proposés (hindouisme, église de Jéhovah, etc.), quel choix opérer? Tous les gourous semblent se valoir, car tous paraissent au moins aussi convaincus, et donc convaincants. Le syncrétisme, qui amène au relativisme, est généralement impossible. On ne peut adopter deux modes de pensée qui s’annulent l’un l’autre, sauf à être divisé: devenir par exemple chrétien et communiste, ou musulman et bouddhiste. Nombreux sont ceux qui préfèrent rester dans leurs certitudes, ce qui aboutit à la rigidification, et donc au conflit plus ou moins larvé.

Étrangement, nous n’avons pourtant jamais eu accès à autant d’informations. Nous sommes littéralement bombardés de news. Pourtant, cet excès ne mène pas à l’ouverture, car chacun choisira sa chaîne, ou son journal, en fonction de ses opinions préétablies, du biais de confirmation. Bien des éléments intéressants ne sont pas transmis à la majorité car ils se trouvent sur des sites partisans, et les grands médias eux-mêmes participent de la désinformation, en ne mentionnant pas certains aspects du réel. Dans l’idéal, il faudrait consulter les sites dits extrémistes, sinon conspirationnistes, pour entendre justement un autre son de cloche, et se faire une opinion personnelle. La chose semble nécessaire, notamment en ce qui concerne les élites, généralement déconnectées des attentes et des préoccupations des milieux populaires, devenus inaccessibles.
La société ne s’en trouve ainsi que davantage fragmentée. Emmanuel-Juste Duits parle de «plurivers». Un cadre croisera un jeune de cité à Châtelet, mais n’aura absolument pas les mêmes préoccupations que lui, ni le même regard sur le monde. Et finalement les gens finissent par s’observer avec hostilité.
L’opinion est largement fabriquée par l’information. Un média de gauche rendra ainsi la révolution cubaine et la figure de Che Guevara sympathiques, quand un média de droite les rendra horribles. Il faut également prendre en compte le moment: être communiste avant la chute de l’URSS apparaissait comme une forme d’humanisme. On constate enfin que beaucoup s’engagent dans une cause qu’ils estiment juste, précisément par manque d’informations. De fait, il faut essayer de comprendre le cheminement intellectuel de mon interlocuteur, même si nous ne partageons pas les mêmes options, et donc apprendre à penser la complexité.
Pareille activité suppose aussi de confronter ses propres idées au réel, sachant que nous pratiquons tous l’activité prédictive, c’est-à-dire que nous cherchons finalement confirmation de nos présupposés à travers l’information que nous choisissons. Or, accéder à la vérité suppose de s’informer à des sources diverses, soit d’écouter plusieurs vérités, de décloisonner. Mais comment savoir qui écouter? A priori, pour savoir si quelque chose est vrai, ou juste, il suffirait de définir quel est l’effet escompté, et si les éléments soumis permettent de parvenir à ce même effet. Dans les faits, rien n’est si simple. On peut d’ores et déjà établir que certaines informations, ou certaines «grandes vérités» assénées ne sont pas recevables, dans la mesure où elles sont par trop incompatibles avec les faits établis, qu’elles présentent trop d’échecs dans leurs prédictions mêmes, et qu’enfin elles manquent de cohérence interne.

Une nouvelle difficulté apparaît cependant. L’épistémologue Paul Feyerabend démontre que l’expérience concrète ne permet pas toujours de contredire telle ou telle assertion. Ainsi, la théorie de l’évolution fut longtemps considérée comme antichrétienne car elle détruisait le mythe créationniste. Pourtant, Teilhard de Chardin a su relier les thèses darwiniennes au christianisme, et ainsi même à démontrer l’existence de Dieu.
On constate également que la plupart des idéologies balaient les éléments contrariants, en les qualifiant souvent de fake news, et donc en les disqualifiant. Karl Popper parle de «système clos» et de diversion. Face à une contradiction, un marxiste accusera ainsi son interlocuteur d’être un petit-bourgeois ou un fasciste, et donc ne lui répondra pas sur le fond. «On peut toujours s’arranger pour garder ses croyances, quels que soient les faits», déclare ainsi Emmanuel-Juste Duits (p. 69). Tel est le fondement du totalitarisme.
Dans une démocratie idéale, au contraire, il faut multiplier les grilles de lecture en s’abreuvant à des sources qui nous paraissent incongrues. Cela ne signifie pas d’admettre n’importe quoi, mais d’examiner honnêtement toutes les propositions. La tâche semble immense. Feyerabend parle d’un «océan toujours plus vaste d’alternatives mutuellement incompatibles» (p. 71). C’est en observant et en soupesant des points de vue parfois inconciliables que nous accéderons à une meilleure conscience, et donc deviendrons de meilleurs citoyens.
Cela suppose aussi de dépasser trois attitudes néfastes:
– Le sophisme, qui consiste à tout justifier par le mensonge, la mauvaise foi, soit une posture que dénonçait déjà Socrate.
– Le dogmatisme, soit un mode de pensée fermé sur lui-même, totalement imperméable à la contradiction.
– Le scepticisme, qui mène au relativisme absolu. Rien ne serait vrai, et donc on ne peut rien affirmer.
Construire une pensée complexe et adaptée exige également de se départir de trois approches:
– Celle de certains scientifiques, qui estiment toutes les vérités provisoires, et qui ne peuvent donc rien affirmer de solide et de tangible.
– Celle du philosophe qui refuse l’expérience sensible et qui se base sur la pure logique sans vouloir jamais vérifier les faits de façon sensible et concrète, ce qui aboutit à des incohérences, et donc sur une inadaptation avec le monde.
– Celle du mystique qui renonce à la connaissance pour se réfugier dans une sorte de révélation, qui est aussi une fuite hors du réel.

Si nous ne pouvons changer entièrement le monde, il nous appartient en revanche d’en modifier certains aspects, par une série de «révolutions minuscules». Jamais effectivement nous n’avons bénéficié d’autant de temps libre. Jamais non plus nous n’avons pu à ce point nous saisir de l’outil Internet, ce qui nous permet de définir un autre type de pouvoir, non contrôlé par les instances étatiques. Hélas trop de gens ont tendance à se perdre sur la toile, ce qui impliquerait de créer justement des sites fonctionnant tels des réseaux.
L’éclatement de la connaissance et sa parcellisation ne menacent pas seulement le champ social, mais également le champ scientifique. De plus en plus spécialisé, séparé en différentes branches, le savoir se divise en de multiples champs qui ne communiquent pas entre eux, ce qui aboutit souvent à des erreurs liées au manque de communication. Ces erreurs génèrent de la technocratie (ainsi, les architectes et les urbanistes ont-ils construit, à partir des années 1960, de grands ensembles urbains sans consulter les habitants, les artistes, les travailleurs sociaux…). Pour aboutir à une authentique démocratie participative, il conviendrait donc de briser les bulles informationnelles en faisant communiquer les différents acteurs, sans pour autant écouter tout et n’importe quoi, en particulier les fake news qui mènent au populisme. Il s’agirait d’aller au-delà des clivages politiques pour aboutir à ce qu’Emmanuel-Juste Duits appelle de ses vœux: la constitution d’authentiques états généraux d’initiative populaire, pour des résolutions concrètes.
Cette communication trouverait son point d’aboutissement dans un ambitieux (et utopique) projet: le «Jardin des Possibles». Porté par Paul Faure, ce nouveau concept devrait réunir des minigroupes autogérés, réunis autour d’un intérêt commun (comme l’agriculture biologique ou la religion). Ces différents groupes se donneraient pour mission de se confronter à des contradicteurs réels, d’écouter tous les points de vue, puis de livrer leurs conclusions aux autres minigroupes, afin de faire circuler l’information et de toujours se remettre en cause. On objectera que pareil dessein n’aurait pour résultat que la rencontre de quelques idéalistes, que cela n’aurait aucun impact. Ce à quoi on répondra que cet espace de réflexion accompagnerait l’émergence de nouvelles idées, et donc de nouvelles décisions, y compris sur le plan politique global. Dès lors, la constitution d’un «jardin des possibles» serait complétée par le réseau «Connexions», présentant les conclusions des minigroupes et confrontant une nouvelle fois les contraintes, dans un état d’esprit d’ouverture maximale.

L’objectif demeure de penser collectivement, en utilisant différemment Internet. Dans ce domaine, il manque effectivement un espace commun, et le foisonnement même de la toile ressemble à un marécage où l’on se perd rapidement. Généralement, les internautes cherchent d’ailleurs un biais de confirmation, soit des éléments les confortant dans leur propre vision préétablie. Ce pour quoi il paraît nécessaire de concevoir les IRP (Instituts de Recherche Philosophique), d’après l’idée du penseur Christian Camus. Ces IRP seraient des espaces de débats illimités. Chaque partisan d’un point de vue particulier pourrait désigner ses propres délégués. Dans le même temps, une commission d’éthique veillerait à bannir les injures et autres diatribes haineuses. Chaque citoyen, en participant à ces forums, se sentirait ainsi membre d’une démocratie représentative au sens strict. Ce type de projet a déjà trouvé une forme d’aboutissement à travers «Wikidébats», site inspiré par Wikipédia, encyclopédie libre et participative. Comme les IRP, «Wikidébats» propose une sorte de synthèse collective et dynamique. Emmanuel-Juste Duits a participé à l’élaboration de ce site.
Comme nous l’avons souligné en introduction, la société cosmopolite actuelle peut mener à des conflits si rien n’est entrepris pour apaiser les relations entre les communautés. Milieu souvent fermé, tourné vers le savoir pur et non vers l’entreprise dans le secondaire, l’école est en outre sectorisée, puisque les différentes orientations (scientifiques, littéraires, économiques…) ne communiquent pas assez entre elles. Il conviendrait, dans un premier temps, de systématiser les rencontres à l’extérieur (avec des associations, dans les musées, etc.). Il conviendrait ensuite de favoriser un dialogue entre les diverses croyances (en visitant une mosquée, puis une synagogue, puis une église et/ou un temple bouddhiste par exemple). On repenserait dès lors la laïcité. Celle-ci comporte un aspect austère (le fait d’interdire les symboles religieux), mais aussi un aspect joyeux (aller à la rencontre de l’autre, et donc s’enrichir). On introduirait en outre la pratique philosophique dès l’école primaire, sans imposer des schémas de pensée préétablis.
Parvenus à l’âge adulte, les citoyens devraient redéfinir la base même du dialogue, en exposant d’abord ce qui les pousse à penser ainsi (un militant vegan admettrait ainsi être devenu vegan après avoir vu des animaux souffrir en abattoir). Nous verrions ainsi que rien n’est totalement objectif dans un point de vue, mais que beaucoup relève en fait de l’expérience personnelle, plus ou moins douloureuse. Les acquis de la PNL (Programmation neurolinguistique) seraient appliqués au dialogue même. On envisagerait enfin une authentique formation complète au «sens critique», formation qui s’appuierait sur les sciences humaines, et plus particulièrement sur la psychanalyse, la psychologie sociale, l’épistémologie, l’étude du sens hypercritique, l’étude des médias.
Cette approche «ouverte» permettrait donc de dépasser l’idéologie dure et sectaire, et le relativisme, pour un renouveau qui nous permettrait de vivre en harmonie et de fonder les bases d’une authentique démocratie représentative. Le pari semble considérable.
Dès l’introduction, Emmanuel-Juste Duits admet l’aspect utopique de son livre. On pourra effectivement reprocher au philosophe une trop grande ambition, ainsi qu’un certain irénisme. Les vastes projets définis semblent difficiles à réaliser, nonobstant les fiches «pratiques» établies par l’auteur à la fin du volume. De surcroît, on peut se sentir parfois perdu, à la lecture de Doper son esprit critique, tant les propositions abondent, tant les champs abordés semblent infinis. Il faudrait sans doute plusieurs tomes pour définir précisément les aspirations concrètes d’Emmanuel-Juste Duits. On saluera toutefois l’audace du penseur, qui tente de rétablir la pratique d’un authentique esprit critique, dans la continuité des Lumières. Certaines propositions ici émises méritent d’être donc pleinement étudiées, sinon appliquées, afin de redéfinir le sens du forum et de la discussion, si capital pour la vie de la cité.
 GEOPOLITICO SCANNER
GEOPOLITICO SCANNER
 COCO CHANEL : UNE FEMME LIBRE QUI DÉFIA LES TYRANS
COCO CHANEL : UNE FEMME LIBRE QUI DÉFIA LES TYRANS Elle a tout inventé du vestiaire de la femme moderne. Les tailleurs gansés… L’accessoire devenu bijou… La tenue « liberté » pour les irrévérencieuses… Le sac à main tenu sur l’épaule… Les parfums numérotés… Et surtout une mode de vie, un style : le sien. Que n’aura-t-on dit sur elle, digressé sur ses origines, sa sexualité, ses relations avec les Grands de l’époque : Cocteau, Picasso, Stravinsky, … et, bien entendu, à propos de son attitude pendant la dernière Guerre Mondiale ? L’hostilité viscérale à laquelle se heurta Coco Chanel dès 1944 est aujourd’hui rarement apaisée par ses biographes, tant s’en faut, alors que la plus célèbre couturière au monde n’a jamais été condamnée pour fait de Collaboration ni quoi que ce soit dont son honneur de patriote eut pu rougir.
Elle a tout inventé du vestiaire de la femme moderne. Les tailleurs gansés… L’accessoire devenu bijou… La tenue « liberté » pour les irrévérencieuses… Le sac à main tenu sur l’épaule… Les parfums numérotés… Et surtout une mode de vie, un style : le sien. Que n’aura-t-on dit sur elle, digressé sur ses origines, sa sexualité, ses relations avec les Grands de l’époque : Cocteau, Picasso, Stravinsky, … et, bien entendu, à propos de son attitude pendant la dernière Guerre Mondiale ? L’hostilité viscérale à laquelle se heurta Coco Chanel dès 1944 est aujourd’hui rarement apaisée par ses biographes, tant s’en faut, alors que la plus célèbre couturière au monde n’a jamais été condamnée pour fait de Collaboration ni quoi que ce soit dont son honneur de patriote eut pu rougir. Ce que nos vêtements révèlent de nous
Ce que nos vêtements révèlent de nous