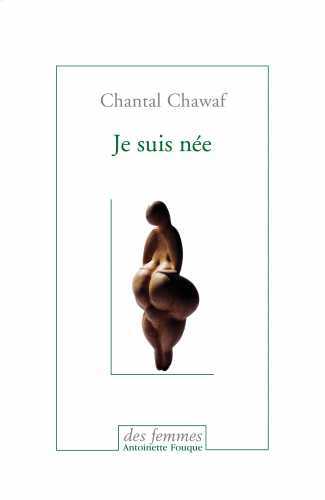 La Quinzaine littéraire du 1er au 15 mai 2010
La Quinzaine littéraire du 1er au 15 mai 2010« Je suis née » de Chantal Chawaf, en couverture de La Quinzaine littéraire (1er au 15 mai 2010) – Article de Laurence Zordan
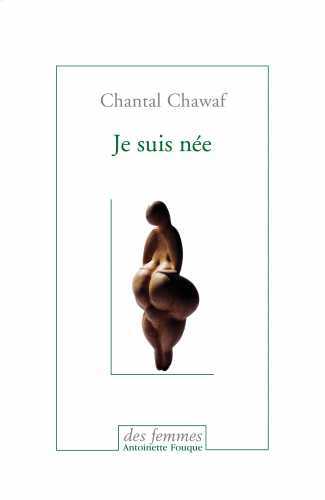 La Quinzaine littéraire du 1er au 15 mai 2010
La Quinzaine littéraire du 1er au 15 mai 2010Guilaine Depis, attachée de presse (Balustrade)
Rampe de lancement ! Appuyez-vous sur la balustrade !
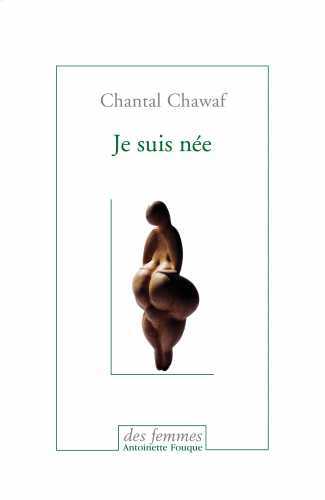 La Quinzaine littéraire du 1er au 15 mai 2010
La Quinzaine littéraire du 1er au 15 mai 2010 LA QUINZAINE LITTERAIRE – Du 1er au 15 janvier 2010
LA QUINZAINE LITTERAIRE – Du 1er au 15 janvier 2010
 LA QUINZAINE LITTERAIRE DU 16 AU 30 NOVEMBRE 2009 – SOCIETE
LA QUINZAINE LITTERAIRE DU 16 AU 30 NOVEMBRE 2009 – SOCIETE Saba Mahmood
Saba Mahmood A l’occasion du millième numéro de La Quinzaine Littéraire, Gilles Nadeau a interviewé les membres du comité de rédaction. Si vous préférez regarder les extraits vidéos de l’interview de Laurence Zordan, écrivain, spécialiste en géopolitique et stratégie et collaboratrice de La Quinzaine Littéraire depuis mai 2008, plutôt que d’en lire le décryptage ci-dessous, suivez le lien : http://laquinzaine.wordpress.com/tag/laurence-zordan
A l’occasion du millième numéro de La Quinzaine Littéraire, Gilles Nadeau a interviewé les membres du comité de rédaction. Si vous préférez regarder les extraits vidéos de l’interview de Laurence Zordan, écrivain, spécialiste en géopolitique et stratégie et collaboratrice de La Quinzaine Littéraire depuis mai 2008, plutôt que d’en lire le décryptage ci-dessous, suivez le lien : http://laquinzaine.wordpress.com/tag/laurence-zordan
1) Géostratégie et littérature
L’originalité de la Quinzaine c’est de ne pas en rester à des sujets extrêmement pointus ou spécialisés, qui forment le quotidien de mon activité, puisque je suis plutôt spécialisée dans les questions, les thèmes de géostratégie et de sécurité. Le propre de la Quinzaine ça a été de me permettre d’écrire sur ces sujets mais en intégrant mes contributions dans un ensemble évidemment plus vaste. Et, à une époque où on parle de pluridisciplinarité, de fécondation croisée, de fertilisation croisée des savoirs, c’était quand même une formidable opportunité que de voir un article sur le terrorisme voisiner avec la recension de tel ouvrage romanesque. Donc c’est cette façon de se côtoyer qui me semble éminemment intéressante. Et j’avoue que, non sans malice j’y ai vu l’occasion de rapprocher les sujets les plus austères de ceux qui sont beaucoup plus – je n’ose pas dire léger ce serait péjoratif – mais plus pétillants.
Cette curiosité n’est pas morbide mais on ne peut cultiver non plus le déni et faire comme si cela n’existait pas. Ce serait au contraire le conforter que d’en nier l’existence et de fermer les yeux, de jeter quelque voile pudique. Donc je crois qu’il y a un effort de lucidité et dans lucidité il y a lumière. Et quand je disais à l’instant que Maurice Nadeau était aussi un éveilleur, et pas simplement un fondateur ou un découvreur, Il y a une façon aussi de lire, d’apprendre à lire, car finalement on découvre, en écrivant, qu’on ne sait pas lire : à la limite on s’informe, on cherche à se divertir, mais lire c’est-à-dire essayer de relier, de faire en sorte que ce qui est étrange soit familier et, inversement, ce qui est bien connu soit non pas de la routine mais quelque chose d’étrange à son tour : ça c’est un véritable effort de lecture. Donc marcher en quelque sorte les yeux grand ouverts et non pas dans une espèce de somnanbulisme ambiant qui ferait que l’on se satisfait des images que l’on voit en croyant être informé. Donc, je le répète, pour moi, la lecture n’est pas seulement information ou divertissement, elle est effort de clairvoyance, de perspicacité.
2) Le décalage entre le monde et sa représentation dans nos esprits
Tout récemment encore, j’essaye de rapprocher deux ouvrages, l’un du Prix Nobel d’économie que je citais Paul Krugman sur la crise – il s’intitule Pourquoi les crises reviennent toujours – Et l’autre, celui du Professeur d’économie de l’Ecole Normale Supérieure Daniel Cohen La prospérité du vice. Et ce qui est tout à fait frappant c’est que ces deux ouvrages sont d’une limpidité phénoménale, et pour des sujets qui ont la réputation d’être abscons, être limpide c’est véritablement un tour de force, une prouesse, un défi, mais on aurait tort de croire que la limpidité ça consiste à être simplement éclairant. La limpidité ça consiste aussi à être clairvoyant et lorsqu’on traite de la crise et que l’on songe que la crise a été marquée par un accès au crédit en quelque sorte débridé, on s’aperçoit que, d’un côté, il y a accès au crédit et de l’autre information inaccessible et donc, dans un tel contexte, la limpidité devient un instrument de combat. Quand je parle de clairvoyance, c’est une limpidité pugnace, pour faire en sorte que les lecteurs soient non seulement informés, alertés, avertis, mais développent une certaine puissance de réflexion et finalement un langage critique.
Il y a cette incompréhension radicale tout au début, au principe des choses et, alors qu’on pouvait imaginer que les crises seraient récurrentes, eh bien non il y a une sorte d’aveuglement et c’est cela l’une des principales leçons. Les hommes font l’histoire mais ils ne savent pas l’histoire qu’ils font. Les plus grands – j’allais dire les plus grands exégètes des temps modernes – sont parfois impuissants à décrypter la réalité, donc, ça c’est la première leçon. La deuxième leçon c’est … qu’il n’y a pas de leçon, hélas, il n’y a pas de recette. On voudrait tellement formater, formaliser, modéliser, mais, à un moment donné, il y a quelque chose qui, dans la réalité, échappe et c’est la réalité elle-même et dans la réalité il y a res, la chose et les choses ne sont pas nos idées. Il y a quand même un décalage entre le monde et sa représentation dans nos esprits.
3) Le terme même d’idéologie est suspect
Le terme même d’idéologie à l’heure actuelle paraît extrêmement suspect parce qu’on a tellement glosé sur la fin, la mort des idéologies que je finis par me demander si le thème de la mort des idéologies n’est pas à son tour une idéologie. Sans vouloir jouer sur les mots, Il est vrai que il n’y a plus d’idéologie dominante. Néanmoins, le déclin des idéologies ne peut pas tuer les idées, et ne peut pas faire abstraction des représentations. La question est de savoir si nos représentations dictent le réel ou sont dictées par le réel. Je crois que la question ne se pose pas, non plus, en ces termes et qu’on ne peut pas se contenter d’inverser les termes de la célèbre phrase de Marx « L’heure n’est plus à l’interprétation du monde, il faut le transformer ». Là, on aurait tort de croire que il faut inverser les termes en disant « L’heure n’est plus à la transformation du monde il faut l’interpréter ». Je crois qu’il faut sortir de ce clivage interprétation- action, réflexion- prise de décision. Non, ce n’est plus comme cela que les choses se passent et lorsque je disais que la grande leçon c’est qu’il n’y a pas de leçon.. .à l’heure du cyberespace, à l’heure finalement de la révolution numérique, on ne réfléchit plus comme avant. On est obligé, nous sommes en tout cas invités, il nous est en tout cas fortement suggéré de trouver d’autres pistes et l’idéologie, pour répondre plus concrètement à votre question, consiste peut-être à redonner une certaine place au logos – Idéologie, idée et logie c’est-à-dire le logos, la parole et non plus simplement à des clics d’ordinateur : je crois qu’il faudrait une certaine éloquence. J’en appelle au sentiment de la rhétorique, à l’art oratoire …pourquoi pas.
4) Questions sur l’arbitraire
Je m’interroge toujours sur l’arbitraire : qu’est-ce qui me pousse à commenter tel ouvrage plutôt que tel autre, qu’est-ce qui me pousse à choisir un texte plutôt qu’un autre, quand on est devant une telle surabondance, et qu’est-ce qui me pousse à montrer la nécessité d’un texte – un texte – un vrai texte – un bon texte – un ouvrage dense, c’est un ouvrage nécessaire. Un ouvrage nécessaire qui fait que s’il n’avait pas existé, s’il n’avait pas été écrit, on n’aurait pas compris le monde de la même façon. Donc, lorsque vous m’interrogez sur les questions que vous auriez pu ou dû me poser, vous renvoyez, vous mettez l’accent, vous mettez le doigt puissamment sur cette question de l’arbitraire. Pourquoi m’avez-vous posé telle question plutôt que telle autre et c’est ça qui est plus que redoutable, c’est absolument terrible, parce que, d’un coup, le lecteur ou celui qui ose prendre la plume – car il faut une certaine audace – est renvoyé à l’arbitraire, à l’air du temps : il se demande si, justement, il n’a pas tiré au sort le texte en question comme on piquerait des olives dans un cocktail – excusez-moi d’être aussi triviale – Mais c’est une question majeure que vous me posez là et c’est peut-être la vraie question. Il n’y a pas de réponse parce que si on vous répond, là c’est une pirouette et c’est très facile, c’est trop facile, et ça manquerait non seulement d’honnêteté intellectuelle mais singulièrement d’intérêt. Parce que montrer la nécessité d’un concept, montrer la nécessité d’un ouvrage et montrer la nécessité de sa lecture, c’est ça qui doit nous animer et c’est ça qui doit être un horizon que l’on n’atteint jamais : c’est le propre de tout horizon.

Pomme Jouffroy signera son nouveau livre et premier polar, « De la rhubarbe sous les pylones » au Marché de la Poésie, samedi 20 juin à partir de 16 h. (puis vous pourrez la revoir jeudi 25 juin 2009 à partir de 17 h à la librairie Le Divan, 203 rue de la Convention, 75015 Paris)

 Catherine Weinzaepflen, Laurence Zordan, Michèle Ramond, Françoise Collin (à confirmer) seront également heureuses de rencontrer leurs lecteurs à cette occasion. Dès 16 heures également le samedi 20 juin. « Tableau d’honneur » de Guillemette Andreu, actuellement candidat à la sélection au Prix Marguerite Audoux et au Prix Marguerite Duras, sera disponible à la vente (et sous réserve de confirmation, représenté par les filles de l’auteure).
Catherine Weinzaepflen, Laurence Zordan, Michèle Ramond, Françoise Collin (à confirmer) seront également heureuses de rencontrer leurs lecteurs à cette occasion. Dès 16 heures également le samedi 20 juin. « Tableau d’honneur » de Guillemette Andreu, actuellement candidat à la sélection au Prix Marguerite Audoux et au Prix Marguerite Duras, sera disponible à la vente (et sous réserve de confirmation, représenté par les filles de l’auteure).

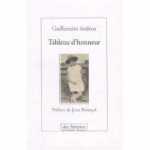



07/06/2009
 Un entretien avec Laurence Zordan (par Pierre Cormary, pour Les Carnets de la Philosophie)
Un entretien avec Laurence Zordan (par Pierre Cormary, pour Les Carnets de la Philosophie)
1. Comment êtes-vous venue à l’écriture ?
Parce que toujours, dès l’enfance, j’ai éprouvé la passion de comprendre, tout en montrant une réticence certaine à expliquer, à m’expliquer. Tenir ensemble (comprendre) pour embrasser m’est d’emblée apparu merveilleux, tenant du merveilleux, comme dans les contes pour enfant que me lisait ma mère. Je voulais « choisir tout », ne rien sacrifier, ce qui est bien sûr contradictoire avec l’idée de choix. Deux masques de carnaval m’avaient été offerts et je pleurais d’avoir à désigner celui que je porterais en premier. Préférer les chimères au choix. Accepter des sanglots sans raison (« cette enfant est trop gâtée, elle pleurniche alors qu’elle a tout »), plutôt que de rendre raison pour être raisonnable. Expliquer tient parfois de parfois l’univers étriqué ; expliquer, c’est déplier pour révéler ce qui était impliqué : véritable coup de force, violence dans cette prétention d’assigner une cause. « Ce qui est incompréhensible, c’est que le monde soit compréhensible », affirmait Einstein. Ecrire, c’est comprendre l’origine de cette incompréhension radicale, que ne peut faire reculer aucune explication. « La poésie n’est pas obscure parce qu’on ne la comprend pas, mais parce qu’on n’en finit pas de la comprendre ». Elan jouissif vers l’obscurité, lumineuses ténèbres, comme une nuit sur la Place Rouge que j’ai vue transparente, sensation onirique où je me dédouble en un rêve éveillé. Ecrire pour goûter à nouveau cet éblouissant mystère.
2. Quels sont vos auteurs phares et quelles influences ont-ils pu avoir sur vous ?
Des phares qui me permettent de faire naufrage, de me noyer, de m’éloigner de tous les rivages convenus : les poètes. Lenteur de délices cruelles (« tes yeux sont comme cette fleur-là, violâtre comme leurs cernes et comme cet automne et ma vie pour tes yeux lentement s’empoisonne » ) ; concision tel un coup de cravache (« immole avec courage au sang qu’il a perdu celui qui met sa gloire à l’avoir répandu ») ; scène plus saisissante qu’un film (« entrant à la lueur de nos palais brûlants, sur tous mes frères morts se faisant un passage, et de sang tout couvert échauffant le carnage ») ; exacerbation, paroxysme du néant (« jours où je veux tellement que je ne veux rien ») ; pied de nez au réalisme (« j’ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité »).
Des phares qui m’évitent de faire des phrases tout en me montrant ce qu’est le style.
Style et stylet : poignarder avec des mots, ne pas s’embourber dans le verbeux. Double influence de Gary et de Gracq, dissemblables, mais se rejoignant dans ce que l’on a judicieusement appelé « la singularité d’une voix sans visage » : Gracq refusant d’exhiber sa personne, Gary restituant à l’étymologie persona son sens de masque ; camouflet de l’un et l’autre par le pamphlet (« La littérature à l’estomac ») ou la supercherie (Ajar). Fuir devant sa propre effigie…
3. Y a-t-il pour vous une spécificité de l’écriture féminine et si oui, laquelle ?
Eurydice se moquant d’Orphée, comme dans le beau texte de Claudio Magris, Vous comprendrez donc : « si on l’a gâté avec tous ces lauriers et ces prix littéraires, c’est grâce à moi, qui ai nettoyé ses pages de la graisse et du sirop qui les encombraient (…) Un poète répète fidèlement ce que la Muse lui dicte, c’est ainsi qu’il gagne ses lauriers. Ensuite, il les rapporte à la maison et sa Muse les met dans le rôti qu’elle lui prépare avec amour, pour en relever le goût. Lui, confondant un peu le laurier qu’il portait sur la tête et celui qui était dans le plat, il répétait aussi à la maison, à table, ce que je disais, moi ». Il y a un penchant ornemental et fleuri auquel cède rarement l’écriture féminine, pas plus qu’elle ne prône l’économie de mots avec force manifestes. La recherche de l’effet ou les préoccupations théoriciennes discourant sur l’impossibilité de tout discours me paraissent étrangères à l’écriture féminine, expression à manier prudemment si l’on veut qu’elle ait valeur de découverte, d’exploration, pour faire écho à une femme : « en écrivant, tu déploies une ligne de mots. Cette ligne de mots est un pic de mineur, un ciseau de sculpteur, une sonde de chirurgien. Tu manies ton outil et il fraie le chemin que tu suis. Tu te trouves bientôt profondément engagé en territoire inconnu. S’agit-il d’une impasse, ou bien as-tu localisé le vrai sujet ? Tu le sauras demain ou dans un an ». Une école de la patience, un temps de l’exploration qui n’est pas sans harmonie avec celui de la gestation : le propos d’Annie Dillard montre que la création n’est pas « vibrionnante ».
4. Votre premier livre, Des yeux pour mourir, frappe par sa violence, sinon par son sadisme, ce que vous appelez « l’infinitésimal dans l’atroce ». Pourquoi ce mode esthétique ?
Je crois qu’il faut mettre l’accent sur « infinitésimal », plus que sur « atroce ». Ce n’est pas l’horreur brutale ni une quelconque coloration gore qui m’attire. Je suis plutôt abasourdie devant l’infiniment petit qui produit la souffrance la plus grande. Les Khmers Rouges avaient, entre autres supplices, imaginé de verser, dans les narines de leurs victimes, du ciment liquide. En séchant, il faisait éclater le cerveau, mais lentement, figure contradictoire d’un éclat lent, d’un coup de feu qui ne finirait jamais. Ce n’est pas une esthétique, mais un enjeu de réflexion géopolitique de constater que la torture fait partie des relations internationales. Q
ue mon livre ait pu mettre en relief ce défi majeur du XXIème siècle montre que le roman français n’est pas nécessairement nombriliste, enclin à cultiver l’autofiction. De récents ouvrages philosophiques (je songe à Du bon usage de la torture ou comment les démocraties justifient l’injustifiable, de Michel Terestchenko) soulignent ce que la veine romanesque m’avait permis de pressentir il y a plusieurs années. Si esthétique il y a, elle ne consiste pas à promener un miroir le long d’un chemin, ni à adopter le ton d’un écrivain engagé qui dénonce l’effroyable. Elle se rapprocherait plutôt d’une poésie de la cruauté, qui, loin d’être complaisante ou compatissante, se fait voix qui s’élève, s’éloignant du cri et du silence.
5. De situations de guerre et de torture, vous passez à des situations orgiaques, voire pornographiques. Quel sens a pour vous ce mélange de sexe et de guerre que l’on a pu dire, à propos d’autres œuvres, des films surtout, un peu douteux ?
Ce n’est pas un mélange mais un surgissement. Ce n’est pas une recette combinant des ingrédients, mais l’impossibilité de toute retenue. « Et la poésie, qui ramène l’ordre, ressuscite d’abord le désordre, le désordre aux aspects enflammés ; elle fait s’entrechoquer des aspects qu’elle ramène à un point unique : feu, geste, sang, cri », écrit Antonin Artaud. S’en prendre au corps d’autrui par la torture, traverser le corps d’autrui pour arpenter toute l’étendue de la dévastation est l’excès qui répond à l’ « infinitésimal de l’atroce », la démesure qui fait pendant à la férocité millimétrique. Ecrits à tombeau ouvert, à corps perdu, d’une seule coulée, mes textes reflètent peut-être la tension entre mouvement ascensionnel et course à l’abîme, chaos et harmonie. Je laisse les personnages à leur foisonnement intérieur, car ce sont plus des personnages, du moins je l’espère, que des situations. Même les paysages deviennent des personnages, mus par des sentiments, rebelles à toute description qui les réduirait à de purs décors. Je ne cherche guère à choquer en cultivant un genre douteux. Ensorceler, oui, sans doute. Donner aux mots une si forte emprise qu’ils témoignent d’une « écriture à vif ». Intrigue plus sombre qu’un roman noir ? Exubérance ténébreuse ? Peut-être, encore. Publier, c’est donner toute latitude au « peut-être », puisqu’entre le livre que l’on s’imagine avoir écrit et celui que le lecteur a la sensation (si l’on ose dire, car c’est charnel) d’avoir lu, la différence peut se révéler considérable, comme s’il s’agissait de deux textes distincts, comme si le message émis n’était pas autorisé à préjuger du message reçu. Alors, « peut-être », parce que je n’en sais rien.
6. Il y a dans vos livres, surtout dans les deux derniers, une propension à raconter plusieurs histoires qui s’emboitent les unes dans les autres. Chaque situation, chaque être semble être la matrice d’une ou d’un autre. Est-ce que cela correspond à une vision organique du monde ?
Cela correspond à une vision matricielle du monde. Les séparations artificielles pour les besoins de la narration me sembleraient regrettables. Mieux vaut prendre le risque d’une écriture labyrinthique. Même lorsqu’il s’agit d’argumentation, et non de fiction romanesque, je demeure persuadée que la véritable éloquence se moque de l’éloquence, des plans d’exposés trop léchés, des démonstrations trop bien charpentées. Je ne demande pas que l’on me suive pas à pas. Je laisse les personnages nous précéder, quitte à ce que l’intrigue se ramifie. Je voudrais épouser une puissance de germination et j’aime assez la formule : « le poète crée des habits de soie à partir des vers de terre ». L’emboitement n’est pas un jeu de poupées gigognes. Il est à l’image de la vie. Un surréaliste, je crois, expliquait qu’il convenait d’inverser les termes pour qu’ils aillent vers la vie. Ainsi, au lieu de « une libellule, arrachez lui les ailes, un piment », écrire « un piment, mettez lui des ailes, une libellule ». Une imbrication qui permet de multiplier les points de vue : non seulement différents récits d’un même événement, mais mensonges qui se croisent et s’entrecroisent, à mesure que chacun des personnages cherche à imposer sa vérité.
7-Est-ce que cela vous choque ou vous inquiète si l’on dit de vos livres qu’ils sont difficiles à lire ? Que l’on s’y perd en même temps que l’on s’y trouve parfois au bord de l’insoutenable ? Qu’il y a dans votre littérature un aspect traumatique qui peut faire peur ?
Je ne regarde pas le roman populaire avec condescendance et je prends plaisir au roman de gare, persuadée qu’il faut un indéniable talent pour captiver ainsi une masse de lecteurs – dont je suis, je le répète. Je ne vais pas prendre la pose en disant que, si mes livres sont difficiles à lire, sans doute est-ce parce qu’ils appartiennent au règne de la littérature et non à celui du divertissement. Je ne crois pas en la césure qualités littéraires/ attraction du chaland. Insoutenable ? Aspect traumatique ? Par modestie, pour ne pas verser dans la prétention de n’avoir rien à dire mais de le dire bien haut. Préférer la blessure au bavardage. Faire peur plutôt que pontifier. Ecriture de la vulnérabilité. Refus d’un texte balisé : il faut accepter d’être en pleine mer. L’un de mes maîtres recommandait de ne lire que les plus grands et ce qu’il y a de plus grand chez les plus grands. Conseil qui ne relevait pas du snobisme, mais d’une sorte de prédilection pour le danger : la lecture des grands auteurs n’est pas anodine. Je me souviens d’avoir été fébrile, organiquement fébrile, en découvrant Dostoïevski.
8. La maternité tient une place essentielle dans vos livres. L’écriture est-elle toujours une histoire de mère ?
Oui, en général, à cause de la langue maternelle et de l’accouchement auquel est semblable l’acte d’écrire ; oui, pour moi en particulier, parce que ma mère me lisait des histoires, fût-ce en des circonstances malheureuses : elle venait de perdre son père ; elle était en deuil, plus déchirée encore de n’avoir pu embrasser l’agonisant parce que l’avion avait eu quelques minutes de retard, quelques minutes à peine, quelques minutes qui la plongeaient dans une souffrance infinie. Pourtant, elle continua de me faire la lecture, s’efforçant de garder une voix qui ne soit pas altérée. Je sentais son chagrin, mais ma cruauté enfantine sav
ourait des mots arrachés à une voix qui se brise.
9. A la fin de Blottie, vous semblez reprendre confiance en l’espérance. « Il est impossible que la tendresse infinie soit impuissante. Il est inconcevable que la langue cachée des émotions soit étouffée par ceux qui se payent de mots, des mots à la parade, dans un défilé verbeux », écrivez-vous. Alors, le Verbe triomphe grâce à l’Amour.
Je voulais que la pulsion de vie triomphe de la pulsion de mort, sans être pour autant visée par la raillerie, à la manière de la boutade sartrienne : « on ne fait pas de littérature avec de bons sentiments. Dieu n’est pas un artiste. Monsieur Mauriac non plus ». Il y a une puissance de la tendresse infinie qui ne se confond pas avec les bons sentiments, puissance qui n’est pas la « bien-pensance », puissance pleine de sève et pleine de sens ; « la forêt tropicale n’aspire pas au bonheur, elle aspire à la puissance », commentait Nietzsche… et si elle aspirait également au bonheur ? Si le bonheur n’était pas une version édulcorée de la vie.
10. Vous êtes publiée aux Editions des Femmes d’Antoinette Fouque. Que représente pour vous le féminisme fouquien (dont on vient de fêter récemment le quarantième anniversaire) par rapport à celui de Simone de Beauvoir ou de Judith Butler ?
Rien de moins qu’une philosophie, une éthique, une esthétique, une politique. L’oeuvre d’Antoinette Fouque n’est pas seulement pluridisciplinaire : elle est visionnaire en montrant des articulations inédites entre les savoirs, parce qu’elle agit en femme de pensée et pense en femme d’action. Ce qui, chez d’autres, aurait pu tenir du chassé-croisé rhétorique devient alors mouvement d’une théorie sur le vif, exigence du féminisme du XXIème siècle, qui n’est, justement, pas réductible au féminisme, si l’on entend celui-ci comme une simple défense et illustration des droits accordés ou à accorder aux femmes. La pensée d’Antoinette Fouque est beaucoup plus ambitieuse et il n’est guère étonnant qu’elle ait, dès 1968, anticipé sur les conceptions d’une démocratie moderne, sur les notions actuellement mises à l’honneur dans les différents débats sur la parité, le développement durable, la globalisation. Un talent de précurseur permet de sortir des impasses désuètes, telles, en l’occurrence, les faux dilemmes et les faux distinguos. Pour les premiers, le tota mulier in utero (un « être femme » ne se réalisant que par l’enfantement au détriment de la carrière) et tota mulier sine utero (un « devenir femme » ne se réalisant qu’en faisant carrière sans enfanter). Pour les seconds, les faux distinguos, il n’est que de songer à la séparation du sexe et du genre promue par le queer de manière souvent énigmatique.
[Entretien paru dans Les carnets de la philosphie n°7 d’avril 09]
 LAURENCE ZORDAN, ICI :
LAURENCE ZORDAN, ICI :
Parole en souffrance (sur Blottie)
Pourquoi y a-t-il un baiser plutôt que rien ? (sur A l’horizon d’un amour infini)
Les règnes à part de Laurence Zordan (sur Des yeux pour mourir et Le traitement)
 Rien de telle qu’une femme cruelle. Je veux dire, rien de telle qu’une femme qui a le sens de la cruauté, c’est-à-dire, dans le cas de cette normalienne agrégée de philo, énarque et haut fonctionnaire, spécialiste des questions de sécurité et de géostratégie, le sens de l’écriture. Ecrire, c’est rendre la torture du réel. C’est écarquiller le regard jusqu’à l’indicible. C’est éviscérer l’âme comme c’est arracher un peu d’âme aux viscères. Tour à tour bourrelle, infirmière, amoureuse, justicière, mère sévère ou câline, Laurence Zordan a ouvert des horizons nouveaux dans la littérature française contemporaine. En quatre livres, elle s’est imposée comme une des figures de proue des Editions des Femmes d’Antoinette Fouque, en inventant un autre type d’écriture traumatique. L’ineffable, ça fait mal.
Rien de telle qu’une femme cruelle. Je veux dire, rien de telle qu’une femme qui a le sens de la cruauté, c’est-à-dire, dans le cas de cette normalienne agrégée de philo, énarque et haut fonctionnaire, spécialiste des questions de sécurité et de géostratégie, le sens de l’écriture. Ecrire, c’est rendre la torture du réel. C’est écarquiller le regard jusqu’à l’indicible. C’est éviscérer l’âme comme c’est arracher un peu d’âme aux viscères. Tour à tour bourrelle, infirmière, amoureuse, justicière, mère sévère ou câline, Laurence Zordan a ouvert des horizons nouveaux dans la littérature française contemporaine. En quatre livres, elle s’est imposée comme une des figures de proue des Editions des Femmes d’Antoinette Fouque, en inventant un autre type d’écriture traumatique. L’ineffable, ça fait mal.
Les yeux grands ouverts
On dit souvent de l’écriture féminine (au cas où celle-ci existerait, mais pour une fois jouons le jeu) que celle-ci échappe aux frontières de la raison et de la logique « masculines », qu’elle exprime une vision plus organique et plus infinitésimale des choses, qu’elle est plus sensible aux métamorphoses des êtres et des situations, qu’elle fonctionne selon un processus de rupture et de cassure qui remet en question l’espace-temps et qui donne au texte un aspect vague et flou où tout n’est plus que sensation, affection, prolifération de signes, au détriment des idées et des actions. Pour autant, le corps y est agressivement présent. L’obscénité apparaît comme la seule objectivité, la fameuse « hystérie féminine » se révélant comme le mal d’une écriture obligée de retrouver les mots et une syntaxe que le système phallocentrique lui interdit jusque là. Littérature du manque et de l’excès mais qui a la capacité de se détacher immédiatement des plaies qu’elle vient d’ouvrir – et qui saisit d’autant mieux. Prenez les scènes de torture de Des yeux pour mourir et avouez (avouez !) qu’un homme ne les aurait peut-être pas écrites comme cela.
« Ouvrez les yeux, parce que le torturé a les yeux parfaitement écarquillés. Les mouches le sentent. Un mets plus délicieux que le miel : des prunelles sans paupières, des prunelles sirupeuses dans lesquelles elles plongent leurs pattes, les crevant petit à petit, s’y enfonçant, s’y perdant goulûment. Un supplice pire qu’une énucléation.»
Un supplice surtout qui se décrit avec une précision qui ne s’excite jamais – et qui pourrait relever d’un barbarie blanche comme on parle d’une écriture blanche. Les hommes n’ont pas ces pudeurs devant un corps souffrant ou jouissant. Eux extériorisent, se mettent à rire, ou à baver. Eux donnent leur avis surtout. Dissertent comme les héros sadiens. Si Zordan est sadienne, alors elle l’est au sens de Clairwill, la « gouvernante » de Juliette. Il faut faire le mal, ou l’écrire, sans peine ni exubérance. Il faut mettre de la rigueur dans sa transe, tendre à l’apathie. C’est ce qui rend ses livres si effrayants. Zordan y traite de la guerre, de la torture, de la maladie, de la violence sociale, avec un sadisme dans la retenue qui fait froid dans l’âme. Dans ces scènes d’horreur, le texte tâtonne puis terrifie. L’on passe de l’obscurité la plus inquiétante et parfois, il faut le dire, la plus irritante à la limpidité la plus insoutenable. On est dans le clinique autant que dans le poétique. Dans l’onirique autant que dans le physiologique. Comme un nuage qui passerait devant la lune et un rasoir qui couperait un œil en deux.
Quoiqu’il s’agisse moins de couper que d’écarteler. Comme dans un film de Stanley Kubrick ou de Dario Argento, tout est œil écarquillé dans Des yeux pour mourir. Le narrateur qui est le bourreau ultime est celui qui vient arracher les paupières du patient avec une délicatesse abominable. Ne plus pouvoir fermer les yeux, c’est aussi cela l’enfer, disait un personnage de Huis-clos de Sartre. En même temps qu’il officie, le bourreau nous regarde droit dans les yeux. Comme dans Les Bienveillantes de Jonathan Littell (un livre écrit après Des yeux pour mourir), il y a dès la première page injonction au lecteur, regard-caméra comme on dit au cinéma :
« Je vais vous raconter l’histoire de mon regard, de mes paupières et de mon cristallin, et nous passerons un marché, en nous regardant face-à-face. »
Impossible pour le lecteur d’échapper à ce face-à-face.
 Histoire de l’oeil
Histoire de l’oeil
Afghanistan. Dans ce paysage de montagnes et de désert, sur lequel souffle un « vent de cent-vingt jours… », vent sadien s’il en est, un enfant va être initié aux cruautés de la vie afin qu’il devienne lui-même un jour un bourreau sans égal, c’est-à-dire un héros de guerre. Et la première cruauté, c’est l’arrachement à la mère avec laquelle il était retranché dans un « règne à part ». Ah les règnes à part d
e Laurence Zordan ! Les thébaïdes douloureuses ou joyeuses dans lesquelles mère et fille se retrouvent (Le traitement), à moins qu’ils ne s’agisse d’une mère sans fils et d’un fils sans mère, d’une sœur souveraine et d’un frère débile (A l’horizon d’un amour infini), ou d’une mère muette et d’une fille délinquante malgré elle (Blottie).
Enucléer le fils de la mère comme énucléer le sein de celle-ci devant celui-ci, c’est pour les hommes de guerre l’apprentissage de la « virilité ». Pour le petit garçon, l’instinct de mort se confondra désormais avec le lait maternel. C’est dans ces métaphores qui mélangent le doux à l’abominable, et dans ce cas-ci, le lactescent au sanguinolent, le nourricier au meurtrier, que réside l’art de Zordan.
« C’est pour cela que vous n’arrivez pas à concevoir la cruauté absolue qui ressemble à une montée laiteuse, à une communion nourricière », écrit le narrateur en se moquant du lecteur et de sa sensibilité « candide ».
Alors les paysages deviennent des blessures et les couchers de soleil des giclées de sang. C’est le temps des « classes ». Ne jamais fermer l’œil devant l’horreur (la chauve-souris brûlée vive). Distinguer l’indistinct (le chat blanc dans la neige). S’entraîner à ne pas fermer les yeux devant une bougie, afin de « maîtriser le jeu de [ses] paupières » et de « fortifier [ses] prunelles comme des muscles » – la suprême épreuve étant l’épreuve de l’eau bouillante que l’on renverse sur les yeux ouverts et qui gèle dans la seconde. Après ça, la mort règne au fond des yeux, et l’enfant est devenu un « tuant », un « résistant », et un moudjahidin qui pourra dire un jour :
« J’ai ôté des vies comme on enlève des échardes »,
et
« J’étais l’homme au poignard qui ne fait aucun bruit. »
Mais blessé, il est envoyé à l’hôpital où il tombe amoureux de la « chirurchienne » – une doctoresse singulière qui aime caresser les moignons des blessés. Le roman de guerre se fait roman d’amour. Le langage de la torture devient celui de la tendresse. Dans les deux cas, ça reste une question de corps.
« Mes gestes de guerrier étaient des gestes d’amant. Si mes cheveux gardaient la trace de l’ébouriffement de sa main, peut-être respirerais-je un jour l’odeur de sa chevelure sous le burqa. Une tiédeur de femme mûre, tandis qu’à ses yeux je demeurais désespérément cru, comme un fruit vert. Ma langue était un ensemble de papilles qui n’avaient pas su la goûter ; peut-être à mon insu, avais-je préféré la voir se perdre dans ses voiles plutôt que de me perdre dans son corps. Lorsque autrefois elle avait tenté d’entrouvrir mes paupières d’enfant, il y avait là une sorte de dépucelage par les yeux, comme si elle avait voulu décalotter mon sexe. Mais au lieu de m’abreuver de sa liqueur, elle m’avait mis du collyre. J’aurais tant voulu la boire ! (…) Elle m’avait dilaté la pupille, mais je m’étais promis qu’un jour mon regard dilaterait son vagin, que je crèverais cet œil maléfique qu’elle gardait entre ses cuisses ».
D’autres personnages surgissent : Sheitan, le disciple, Candy, la donzelle, et surtout l’espion Z… (Z comme Zordan) dont on apprendra que c’est lui qui est l’origine de la vocation du narrateur. Tout ce petit monde finit par coucher ensemble. L’on partouze dans la salle d’hôpital. L’on se torture aussi, pour rire, puis pour de bon, quand on apprend qu’un tel a trahi. Il y a des enculages et des paupières arrachées. Des aveux qui ne viennent pas et des caméras muettes qui filment les scènes. L’on pense à l’Histoire de l’œil de Georges Bataille autant qu’aux films d’horreur genre Saw. Vous vous êtes souvent demandés que pouvait être la sexualité en état de guerre ? Lisez Des yeux pour mourir, le premier roman de Laurence Zordan, et vous le saurez – en même temps que vous testerez votre tolérance à la littérature.
 L’essence mère-fille
L’essence mère-fille
« Toujours, j’ai aimé me promener avec ma mère – Voilà un début bien sage pour une histoire atroce. A moins que ce ne soit un début subversif pour une histoire banale. »
A moins encore que ce ne soit le banal qui soit atroce ou l’atroce qui soit subversif. Chez Laurence Zordan, les gestes les plus anodins sont des événements métaphysiques, les incidents les plus dérisoires sont des cataclysmes intérieurs. Faire une promenade avec sa mère malade est pour la fille un geste révolutionnaire que ne comprennent ni le médecin ni son entourage. Car cette petite marche à deux est pour la fille l’occasion de vivre avec sa mère dans
« ce tempo qui n’appartenait qu’à nous seules (…) parce que ce n’est pas un simple hasard génétique qui nous lie, mais la certitude que l’enfantement n’a fait que consacrer une connivence intemporelle, comme si de toute éternité j’avais pour raison d’être celle d’être la fille de cette femme, comme si cette femme ne tirait la justification de son existence que de m’avoir permis de voir le jour. »
Que raconte Le traitement ? Une fille qui s’occupe de sa mère malade. Et qui par là-même va retrouver « l’essence mère-fille ». Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? se demande Zordan de livre en livre. Eh bien parce qu’il y a des baisers ontologiques (A l’horizon d’un amour infini), des enfants à protéger (Blottie), des mères dont on devient la mère, l’infirmière et donc aussi le bourreau. Comme le petit garçon de Des yeux pour mourir, la fille devient cet « enfant soldat » qui ne va rien laisser passer des caprices et des faiblesses de sa mère et va lui infliger son « traitement » jusqu’à en être impitoyable – inhumaine par amour. Car les soins passent par les consignes, les menaces, les soupçons, la traque permanente. Soigner quelqu’un, c’est se battre contre lui nuit et jo
ur. Dans Des yeux pour mourir, on passait de la torture à l’amour, dans Le traitement, on passe de l’amour à la torture.
« De même que la guerre est une chose trop sérieuse pour être confiée à des militaires, la maladie est une chose trop complexe pour être confiée au malade. »
Pour la fille, le souci premier est que sa mère comprenne ce qui lui arrive et garde sinon sa sagesse, sa lucidité. C’est que l’esprit boiteux nous irrite plus que le corps boiteux, comme aurait dit Pascal, et que l’esprit boiteux, dans le cas d’une grande malade, peut conduire à la folie ou au désespoir. Bien penser sa maladie est encore un signe de santé.
« Je voudrais qu’elle raisonne. Même pas qu’elle soit raisonnable : tout simplement qu’elle raisonne. Qu’elle pratique enfin le principe du tiers exclu empêchant d’affirmer une chose et son contraire ; je voudrais qu’elle respecte non pas la vérité, mais l’évidence, lui imposant d’avouer qu’elle s’apprêtait à prendre le médicament que mon intrusion dans la chambre lui a fait tomber de la bouche ; je voudrais qu’elle veuille, non pas s’en sortir, comme y exhorte la sagesse populaire, mais qu’elle veuille vouloir pour exprimer enfin clairement un souhait. Or, son propos est toujours retors sans ruse, tordu plusieurs fois comme la soie retorse, pour ne déboucher que sur l’incompréhensible. Demander un verre d’eau ou une cuillère lui inspire des discours de contournement. Elle cultive la circonvolution des arguments tout en étant géostationnaire dans ses obsessions. »
C’est que la maladie rend rusé, et de la ruse du diable. Pour la fille qui s’occupe de sa mère, il s’agit de se prévenir sans relâche de la dialectique infernale de la douleur ou de la mort. Car il n’est pas sûr, comme elle finit par le dire, que « la douleur soit » seulement « le diable ». Il se pourrait hélas fort bien que la douleur soit aussi le signe diabolique de la vie. La douleur, c’est le diable, mais la douleur, c’est aussi la vie. Dans le cas des grands malades, rester en vie pour leur bien devient un contresens Alors, il faut faire fi de l’âme et ne se concentrer que sur le corps :
« Tout entière préoccupée par cette physiologie pathologique, je néglige volontairement l’âme, qui me semble un piège pour s’épargner la responsabilité de soigner. Les ressorts du psychisme et autres recoins secrets de l’inconscient me paraissent indûment invoqués pour masquer l’échec d’un protocole médical. Je refuse donc que ma mère ait une âme pour lui éviter d’être privée d’un organisme qui fonctionne, d’un corps réparé par la science. Je troque le spirituel contre le corporel. »
 La maladie mère-fille
La maladie mère-fille
Sacralisation du traitement.
« Je ne veux pas que ma mère introduise la moindre variante dans son traitement, sous peine d’écorner le sacré. »
Le rituel, c’est ce qui rassure, c’est ce qui fait de la vie, ici de la survie, une éternité. Comme l’enfant qui veut qu’on lui raconte tous les soirs la même histoire, la fille ne veut pas que sa mère change de soins. C’est la répétition des gestes qui protège. Et c’est la « normalité », qu’on méprise d’habitude, qui console – lorsque par exemple il faut, afin que la mère puisse manger, lui arracher les dents et lui mettre une prothèse, et ce faisant, avoir l’impression de revenir dans le monde normal, car « tout le monde, un jour ou l’autre, doit porter une prothèse dentaire ».
C’est la vie de tous les jours qui sauve de cette « mort » de tous les jours. C’est le dérisoire qui fait supporter l’essentiel. Pour la mère de A l’horizon d’un amour infini, l’important sera de toujours sentir bon au nom de son fils mort ou perdu depuis longtemps. Dans Le traitement, la fille va dans une quincaillerie acheter des casseroles émaillées pour une cuisine qu’elle et sa mère ne feront sans doute jamais mais « qui sonnent comme des cymbales de guérison ». Du corps de la mère au « corps » de la maison, il n’y a d’ailleurs qu’un pas que la pensée magique franchit allégrement.
« Il fait bon aller à la quincaillerie comme il ferait bon vivre dans la maison qui bénéficierait des objets qu’elle recèle. Je me prends à rêver d’un transfert de traitement : ce n’est plus l’organisme maternel qui obéirait aux médicaments, c’est la maison que l’on soignerait, en la stimulant par des pitons, crochets, rallonges de prises de courant, luminaires, rideaux plastifiés, serpillières jetées comme des compresses, thermomètres de réfrigérateur plutôt que courbe de température de la malade, glacière à pique-nique plutôt que mallette pour flacons de prise sang, couteaux à découper la volaille plutôt que seringue à ponction lombaire. »
Mais il faut revenir au chevet de la malade. Se refaire flic, douanier, ministre de l’intérieur de sa mère.
« Tels ces Africains repoussés dans le désert alors qu’ils avaient enduré mille souffrances pour atteindre l’Europe, ma mère est rejetée sans ménagement vers sa douleur. Le droit, les procédures sont de mon côté. Je ne la vois plus comme Maman, mais comme une clandestine qui tente d’exploiter la moindre brèche dans ma vigilance. »
La cruauté qu’il faut pour soigner quelqu’un. Le rapport de pouvoir qui s’instaure entre la fille et sa mère. « Je suis la sentinelle, elle est la Solitude », dit-elle un moment. L’Œdipe féminin qui se met en branle. Car la fille qui devient la mère de sa mère, donc sa grand-mère, rappelle aussi à sa mère qu’elle détestait la sienne.
« A m’imaginer sous les traits despotiques de sa génitrice – que, soit dit en passant, j’adore – elle a fini par me rendre semblable à elle. Modelant son comportement sur la stratégie de pouvoir qu’elle m’impute, ma mère m’a assigné le rôle qu’elle redoute. J’en deviens ce masqu
e antipathique qu’elle me fait revêtir et mon visage autoritaire riposte à ses attaques contre l’autorité. Sa manière d’attiser les flammes du caractère qu’elle me prête suscite ma propre réaction, nécessairement très ferme. Et parfois, j’envie ma grand-mère qui ne se privait pas de gifler ma mère. Je m’arrête dans cette violence fantasmatique en ressentant la tristesse de Maman d’avoir été si peu aimée. Je voudrais soudain tout effacer : l’attitude passée de ma grand-mère, ma conduite de garde-chiourme du traitement, je voudrais éradiquer cette férocité qui a sauté une génération pour s’acharner contre ma mère, prise en tenaille. »
L’hospitalisation est vécue comme un coup d’état. Et le retour, pour la fille, à la solitude. A la maison. Au fantasme d’un bal qu’elle donnera pour le retour de sa mère. Au conte de fée qu’est l’espérance. A l’écriture, enfin, la seule chose qui peut faire aimer sa douleur.
[Article paru dans Les carnets de la philosophie n°7 en avril 07]