
Jean-Nicolas Gaitte et Sylvia Roux dans une pièce qui manque un peu de souffle. Photo © SP/GUILAINE DEPIS/STUDIO HÉBERTOT
La Marraine amoureuse, la dernière pièce de Benoît Marbot


Guilaine Depis, attachée de presse (Balustrade)
Rampe de lancement ! Appuyez-vous sur la balustrade !

Jean-Nicolas Gaitte et Sylvia Roux dans une pièce qui manque un peu de souffle. Photo © SP/GUILAINE DEPIS/STUDIO HÉBERTOT
La Marraine amoureuse, la dernière pièce de Benoît Marbot


Dans La Marraine amoureuse, Benoît Marbot met en scène le soldat Anatole, un volontaire de 1914 en permission, et Clémence, une bourgeoise des beaux quartiers parisiens.
 La Marraine amoureuse : du comique de tranchée à l’émotion vraie
La Marraine amoureuse : du comique de tranchée à l’émotion vraiePar Rodolphe Ragu
Dans La Marraine amoureuse, Benoît Marbot met en scène le soldat Anatole, un volontaire de 1914 en permission, et Clémence, une bourgeoise des beaux quartiers parisiens. Opposition des sexes, de styles et des classes sociales : l’auteur exploite tout le potentiel d’humour dont regorge ce genre de situations, sans négliger la fibre sentimentale.
 Clémence et Anatole : la guerre, le désir et les bons mots
Clémence et Anatole : la guerre, le désir et les bons motsAssis dans mon café préféré, à côté du théâtre du Châtelet, je commence à lire La Marraine amoureuse, de Benoît Marbot. Rapidement, je souris, puis je mets à rire franchement, entre deux tables occupées par d’autres clients. « Votre livre a l’air plein d’humour ? » me dit-on. C’est le cas en effet. La Marraine amoureuse est en effet une pièce très efficace pour remuer les zygomatiques du lecteur. Benoît Marbot, auteur d’une vingtaine d’œuvres, maîtrise très bien tous les ressorts du comique et les techniques, qui pour être séculaires, n’ont rien perdu de leur efficacité.
Deux personnages sont en scène : Anatole Langeron et Clémence Boliveau. Nous sommes en 1915 et Anatole, un jeune poilu, qui bénéfice d’une permission, rencontre sa marraine de guerre (une « marraine de guerre » est la correspondante épistolière d’un soldat sur le front, qui essaie par ses lettres de le soutenir dans son sacrifice pour la patrie). Seulement voilà, Anatole, qui n’a encore jamais connu les plaisirs de la chair, n’a pas traversé à rebours les champs dévastés de la Marne pour se contenter de câlins et de petits mignotages sur un banc, au jardin du Luxembourg. Et s’il consent à l’idée de mourir pour son pays, il n’est tout de même pas prêt à accepter l’idée de mourir puceau. Anatole le sans-grade est donc assez direct dans son approche tactique : – Clémence : Où vouliez-vous passer la nuit ? – Anatole : chez vous ! – Chez moi ? – Avec vous. – L’idée ne vous est pas venue que je pourrais vous refuser mon lit ? – Je peux dormir n’importe où. Clémence est nettement plus âgée que son jeune soupirant. Issue de la bourgeoisie parisienne, elle tient beaucoup au respect des convenances – elle est veuve de guerre – et à un langage approprié. Ce qui n’est pas le cas d’Anatole, qui a dérobé sans barguigner la montre d’un camarade, mort dans les tranchées, et qui s’exprime naturellement en argot pour justifier son acte : « Je n’allais pas me dégraisser pour une tocante. » Clémence, sans être insensible au charme de son correspondant, ne se laisse pas faire et repart à la drague un peu lourde et maladroite d’Anatole en lui conseillant d’aller « essayer son talent sur les professionnelles ». Mais elle n’est en fait pas aussi prude qu’elle le laisse croire. Elle accepte sans le dire de passer la nuit avec lui. – Anatole : Nous pouvons coucher ensemble sans nous accoupler. – Clémence : Et sans nous toucher. – Nous ne sommes pas des bêtes. – La guerre n’autorise pas tout… Le lecteur comprend que leur insistance à nous persuader qu’il ne va rien se passer entre eux fonctionne en fait comme la dénégation d’un malade sur le divan d’un psychanalyste. C’est efficace. On le voit : l’opposition fonctionne à plein entre deux personnages que tout oppose par la mécanique du comique de contraste. Et le comique de répétition, soutenu par des jeux de mots, donne aussi sa pleine mesure.
Anatole Langeron et Clémence Boliveau vont se retrouver tous les ans jusqu’à la fin de la guerre : leur relation évolue et ils doivent affronter les problèmes que rencontrent tous les couples. La question sociale affleure au moment où Anatole prend littéralement du galon, car Clémence demeure une bourgeoise et Anatole, un prolétaire. Il continue à s’exprimer dans un immeuble haussmannien comme dans la boue des tranchées et surtout parle d’égal à égal avec les domestiques, ce qui est shocking pour Clémence, qui aime à se moquer de son maladroit amoureux et de son manque d’éducation.
L’atmosphère, drôle, légère au début, devient plus grave au fil des actes de cette courte pièce. Une tension, émouvante et empreinte d’onirisme s’installe même dans les derniers moments du dialogue pour une fin qui joue clairement sur la corde sensible. Il y aura des choix à faire pour la mise en scène, qui insistera sur le comique ou sur l’émotion et le sentiment, ou bien conciliera les deux tendances.
Benoît Marbot a publié sa pièce aux éditions L’Harmattan (c’est aussi le cas de quelques-unes de ses pièces précédentes). Chacun sait comment fonctionne le processus de publication dans la maison fondée par Denis Pryen et Robert Ageneau : c’est le système du compte d’auteur. En gros, l’auteur achète les cinq cents premiers ouvrages à son éditeur, qui rentre ainsi dans ses frais. De même, chacun sait que L’Harmattan est souvent l’unique solution pour les auteurs qui ont essuyé les refus des autres maisons d’édition. Et il faut reconnaître que ces refus sont souvent justifiés. Mais des statistiques, il ne faut pas toujours en dériver une règle absolue. La Marraine amoureuse est une bonne pièce de théâtre (elle a été retenue dans la sélection du concours « Vivons les mots »), qui aurait mérité l’attention des maisons d’édition qui ont pignon sur rue, à savoir un plan de communication et un service après-vente pour mettre en valeur le talent de Benoît Marbot. Sa prochaine pièce recevra d’ailleurs l’honneur d’être créée au Français. Que puis-je ajouter de plus ?
 La Marraine amoureuse, un bijou théâtral dans l’écrin du Parc Monceau
La Marraine amoureuse, un bijou théâtral dans l’écrin du Parc Monceau
“La Marraine amoureuse” : un bijou théâtral dans l’écrin du parc Monceau
Une histoire d’amour suspendue dans le fracas de l’Histoire
Il est des spectacles dont la délicatesse vous saisit dès les premiers instants — La Marraine amoureuse, pièce originale de Benoît Marbot, en fait partie. Dans le décor somptueux du parc Monceau reconstitué avec grâce par Philippe Varache, la pièce nous transporte en 1915, au cœur d’un Paris silencieux, loin du tumulte des tranchées mais tout aussi habité par l’ombre de la guerre. Ce jardin, avec ses colonnades et son bassin, devient le théâtre d’une rencontre poignante entre une femme endeuillée et un jeune homme sur le départ. Le temps y semble suspendu, comme le souffle des spectateurs, captifs d’une émotion rare.
Les costumes, eux aussi signés Philippe Varache, participent de cette immersion : silhouettes élégantes, tissus choisis avec précision, nuances sobres d’un deuil qui n’éteint jamais totalement le désir de vivre. Un travail d’orfèvre, à la hauteur du texte.
Un duo incandescent
Dans ce huis clos à ciel ouvert, Sylvia Roux incarne Clémence avec une intensité retenue, bouleversante. Formée à l’École Périmony, passée par le Studio Hébertot qu’elle a dirigé avec passion, la comédienne porte ce rôle comme un vêtement cousu sur mesure : celui d’une femme libre d’esprit, prisonnière de son époque. On pense à Anouilh, bien sûr (Antigone, L’Invitation au château), mais aussi à Giraudoux ou même à Marguerite Duras : cette parole fragmentée, pleine d’interstices et de silences, dit tout ce que les corps ne peuvent plus dire.
Face à elle, Jean-Nicolas Gaitte (remarqué dans Roméo et Juliette, Les Contes du Grand Guignol) campe un Anatole à la fois bravache et vulnérable, adolescent attardé dans un monde d’hommes qu’il ne comprend pas encore. Leur duo irradie de tension, de désir contenu, d’amour impossible et pourtant incandescent.
Un regard féministe sans slogan
La pièce dit beaucoup, aussi, de la place des femmes en 1915 — et par effet de miroir, aujourd’hui encore. Clémence, veuve avant d’avoir été aimée, correspond avec les soldats, prend la parole, pense. Mais le monde continue à lui imposer le silence. La pièce esquisse ainsi un féminisme élégant, tout en nuances, loin des discours simplistes : une femme forte n’est pas forcément une femme qui crie, mais une femme qui pense, qui choisit, même dans l’impossibilité. Le regard de Sylvia Roux suffit parfois à tout dire. Dans une époque qui redécouvre l’importance de ces combats, La Marraine amoureuse vient nous rappeler que l’Histoire est lente, et que les émotions sont souvent les plus puissantes des armes.
Un échos troublant avec notre monde
Ce qui rend la pièce si précieuse, c’est aussi ce qu’elle raconte de notre présent. Alors qu’Anatole s’apprête à partir pour un front dont il ignore tout, on pense à ces jeunes hommes d’aujourd’hui, en Ukraine ou ailleurs, projetés dans des conflits qui les dépassent. L’insouciance brisée, l’amour comme dernier refuge, la parole comme ultime résistance : tout cela fait écho à nos inquiétudes contemporaines. On croit assister à une simple comédie sentimentale ; on découvre un drame universel.
Un texte ciselé, une mise en scène qui respire
Benoît Marbot, à la fois auteur et metteur en scène, fait preuve d’une maîtrise remarquable. Son écriture, ciselée, joue de la légèreté et du tragique, à la manière d’un Giraudoux (La guerre de Troie n’aura pas lieu, Ondine), d’un Musset, ou d’un Marivaux en clair-obscur. Il laisse respirer ses personnages, évite tout pathos, et fait du silence une matière dramatique à part entière.
Le dispositif scénique est minimal, mais jamais pauvre. Tout se joue dans la tension des corps, l’économie du geste, la retenue des émotions. C’est un théâtre de la suggestion, profondément littéraire et infiniment humain.
Un rendez-vous à ne pas manquer
Il y a dans La Marraine amoureuse ce frisson rare que seuls les spectacles sincères peuvent offrir. Une pièce qui parle d’hier pour mieux éclairer aujourd’hui, qui touche sans asséner, qui fait rire parfois — et pleurer souvent. C’est du théâtre d’exception , mais il serait impardonnable de le laisser passer inaperçu.
Erwan d’Harmental
Du 20 mars au 27 avril 2025
Du jeudi au samedi à 19h, dimanche à 17h
Studio Hébertot – 78 bis boulevard des Batignolles, 75017 Paris
Avec Sylvia Roux et Jean-Nicolas Gaitte
Texte et mise en scène : Benoît Marbot
Décors et costumes : Philippe Varache

Nous sommes en 1915. Clémence est une jeune bourgeoise, récemment veuve sans enfant d’un mari officier, tué dans les premiers mois de la guerre de 14. Comme cela se faisait beaucoup à cette époque patriotique où l’arrière cherchait à soutenir le front, sur les conseils d’une amie, Clémence a pris un filleul de guerre. Elle échange des lettres régulières avec ce soldat du front. Il a demandé à la rencontrer, et les voilà au parc Monceau à Paris, à se chercher devant « les colonnes ».
Anatole est un sergent de 18 ans, engagé volontaire à 17 ans après que ses deux frères aînés aient été tués. Il est vif, intelligent, plein de vie. Son supérieur a voulu en faire un officier, car on montait vite en grade ces années-là, à cause des vides qui se creusaient. Il a d’abord refusé, puis Clémence l’a convaincu sans le vouloir d’essayer. Car lui n’est pas un bourgeois, mais issu du peuple du Nord de la France. Il parle cru, se fagote mal, et n’apprécie pas les bibis portés par la jeune femme à leur juste valeur. Devenir officier va le polir, l’élever.
De fil en aiguille, année après année, 1915, 1916, 1917, 1918, ils se revoient en coup de vent. Lui est toujours vivant, et peut-être est-ce elle qui le fait tenir. La première fois il la défonce, en même temps que le sommier dans la chambre de la bonne. La seconde fois il lui fait un enfant. La troisième fois il rencontre le ventre où dort encore le bébé. La quatrième fois, le petit est né et reconnaît sa voix ; Anatole est désormais lieutenant, il avait « disparu », il était prisonnier.
« Clémence (au gardien) – j’ai retrouvé mon mari !
Anatole – Et nous allons vivre ! »Happy end.
Écart de classe, écart de genre, écart d’existences : comment Clémence et Anatole peuvent-ils se rencontrer, s’unir et envisager de faire leur vie ensemble, avec la guerre omniprésente, qui fauche son lot d’hommes à tout moment ? Parce qu’il est très jeune et qu’il touche en elle la fibre maternelle ? Parce que le désir vital est plus fort que la mort et qu’elle est emportée par cette virilité ? Parce que l’avenir n’est écrit nulle part et que le moment présent suffit au bonheur ?
Une pièce jouée au Studio Hébertot jusqu’au 27 avril 2025
les jeudis, vendredis, samedi à 19 h, les dimanches à 17 h – 1h20 de spectacle
78bis Boulevard des Batignolles, 75017, 01 42 93 13 04 contact@studiohebertot.com
10 à 30 € en fonction des réductions
L’auteur a un parcours original, passionné de théâtre et auteur de nombreuses œuvres.
Benoît Marbot, La marraine amoureuse (théâtre), 2024, L’Harmattan, 95 pages, €13,00, e-book Kindle €9,99
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)
Attachée de presse BALUSTRADE : Guilaine Depis, 06 84 36 31 85 guilaine_depis@yahoo.com

Un écrin de mélancolie au cœur du parc Monceau
Dès les premiers instants, la magie opère. Le décor signé Philippe Varache nous plonge dans le Paris de la Grande Guerre, loin des tranchées. Ici, le parc Monceau sert d’écrin à la rencontre entre Clémence et Anatole. Un lieu presque onirique, où la beauté classique contraste avec la douleur des temps. Varache recrée un univers d’une troublante authenticité, fidèle à l’atmosphère feutrée du début du XXe siècle.
Ses costumes, réalisés sur mesure, confirment cette quête de réalisme. La silhouette de Clémence, en manteau long et chapeau sobre, évoque ces femmes de la Belle Époque dont le deuil s’habillait de dignité silencieuse. Face à elle, Anatole, trop jeune pour l’uniforme qu’il porte, incarne cette jeunesse sacrifiée, égarée entre le romantisme et la brutalité du front.
Un duo d’acteurs habité
Porter une pièce reposant sur la force du dialogue est un défi. Sylvia Roux, dans le rôle de Clémence, y parvient avec une intensité remarquable. Son interprétation rappelle les héroïnes de Jean Anouilh, tiraillées entre devoir et désir. Formée à l’École Périmony, elle a dirigé le Studio Hébertot et défendu des textes à forte résonance intime. Ce rôle semble une évidence tant elle habite chaque réplique avec justesse.
Clémence incarne une femme prise entre les carcans de son époque et ses aspirations profondes. En 1915, alors que les hommes partent au front, les femmes gagnent une autonomie nouvelle, mais restent prisonnières d’une société qui les cantonne aux marges du pouvoir. Engagée épistolairement auprès des soldats, Clémence est libre en pensée, mais contrainte par les conventions.
Le jeu de Sylvia Roux traduit avec finesse ce tiraillement. Son personnage évoque autant Marguerite Gautier dans La Dame aux camélias que Madame Arnoux de L’Éducation sentimentale. Mais il résonne aussi avec les questions féministes contemporaines. À l’heure où l’égalité salariale et le poids des injonctions sociales sont débattus, Clémence rappelle que ces combats sont anciens et que la liberté des femmes s’est toujours heurtée à des murs invisibles.
Face à Sylvia Roux, Jean-Nicolas Gaitte incarne un Anatole vibrant et fougueux, dont l’audace masque mal la fragilité. Habitué aux rôles exigeants (Roméo et Juliette, Les Contes du Grand Guignol), il trouve ici un équilibre subtil entre naïveté et détermination. Son Anatole rappelle Perdican de On ne badine pas avec l’amour, croyant pouvoir bousculer le cœur d’une femme plus mûre, avant de comprendre que l’amour n’est jamais un simple jeu.
Si La Marraine Amoureuse parle d’un amour en temps de guerre, elle interroge aussi notre époque. En 1915, la guerre semblait devoir s’éterniser, et l’on croyait encore à un monde sans conflit. Un siècle plus tard, la guerre est toujours là : en Ukraine, au Proche-Orient, en Afrique.
Dans ce contexte, la pièce éclaire notre actualité de manière troublante. Le personnage d’Anatole rappelle ces jeunes hommes qui, hier comme aujourd’hui, partent au combat sans toujours comprendre leur engagement. Son insouciance brisée fait écho à ceux qui, aujourd’hui encore, doivent suspendre leur jeunesse pour défendre une cause qui les dépasse.
 Une écriture précise et une mise en scène toute en nuances
Une écriture précise et une mise en scène toute en nuances
Benoît Marbot, auteur et metteur en scène, prouve une fois de plus la singularité de son écriture, saluée pour son mélange de tendresse et de cruauté, d’humour et de mélancolie. Ses dialogues oscillent entre séduction légère et gravité d’un monde qui s’effondre. La construction rappelle Giraudoux (Intermezzo, La guerre de Troie n’aura pas lieu), où les échanges faussement anodins portent en filigrane le poids d’un destin collectif.
Marbot met en scène son texte avec une économie de moyens qui laisse toute la place au jeu des acteurs. Pas d’effets inutiles ni de pathos excessif : tout repose sur les regards, les silences, cette tension entre deux êtres qui savent que le temps leur est compté. Une sobriété d’une efficacité redoutable, qui sublime l’émotion sans jamais tomber dans le mélo.
Un spectacle à ne pas manquer
La Marraine Amoureuse est de ces pièces qui touchent au cœur par leur simplicité apparente et leur richesse profonde. À travers l’histoire de Clémence et Anatole, Benoît Marbot nous offre une réflexion universelle sur l’amour, la perte et l’espoir.
Servi par deux comédiens exceptionnels, un décor évocateur et des costumes d’une précision historique remarquable, ce spectacle est un moment de grâce suspendu, où l’émotion affleure à chaque instant, jusqu’à la chute réjouissante d’un amour intact que la guerre n’aura point altéré.
Yves-Alexandre Julien
21/03/2025
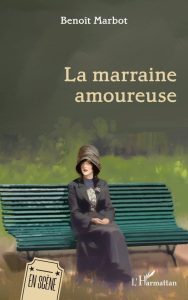 On entame la lecture d’une pièce de théâtre pour la raison la plus naturelle et la plus modeste qui soit : se distraire. Les pages se tournent à intervalles réguliers alors que, fort égoïstement, nous décidons de n’y être pour personne, ni même au téléphone, tout au moins pas avant la fin de l’acte en cours. Et. Voyez-vous ! C’est précisément ce qu’il advient à la lecture de La marraine amoureuse, où l’on ne voit pas s’écourter le jour ni s’allonger la tête du chien qui se demande quand nous allons enfin lâcher ce livre pour satisfaire sa promenade habituelle.
On entame la lecture d’une pièce de théâtre pour la raison la plus naturelle et la plus modeste qui soit : se distraire. Les pages se tournent à intervalles réguliers alors que, fort égoïstement, nous décidons de n’y être pour personne, ni même au téléphone, tout au moins pas avant la fin de l’acte en cours. Et. Voyez-vous ! C’est précisément ce qu’il advient à la lecture de La marraine amoureuse, où l’on ne voit pas s’écourter le jour ni s’allonger la tête du chien qui se demande quand nous allons enfin lâcher ce livre pour satisfaire sa promenade habituelle.
Après les trois coups
Au théâtre, tout commence par la scène 1 de l’acte I. Il s’agit d’un dialogue, toujours, en l’occurrence ici celui entre Clémence et Anatole. Nous sommes à Paris, parc Monceau, début de l’hiver 1915, l’un et l’autre se cherchent dans les allées jusqu’à leur rencontre avant de s’asseoir sur un banc ; plus précisément, Clémence s’assied-elle alors qu’Anatole reste debout en proposant d’aller ailleurs, puis il finit par consentir à se poser près d’elle. Au fil d’une conversation truculente, ponctuée du vocabulaire argotique d’Anatole face à celui choisi de la jeune femme, le lecteur commence à comprendre le lien qui les (dés)unis : Clémence est une marraine de guerre.
(Entre 1914 et 1918, des milliers de femmes entretinrent une correspondances avec un soldat au front afin de le soutenir moralement et psychologiquement. Il s’agissait d’un échange épistolaire avec les conscrits dans l’espoir de maintenir leur moral au beau fixe ; souvent des hommes livrés à eux-mêmes et sans famille. Les motivations de ces mères , parfois célibataires, veuves, ouvrières ou grandes bourgeoises, étaient divers. Certaines espéraient ainsi trouver un mari et plusieurs épousèrent effectivement leur filleul.)
Voici donc nos (futurs) tourtereaux seuls dans un jardin anglais à l’heure des coups de sifflets annonçant la fermeture. Le gardien s’éloigne. Il ferme les grilles à double tours. Anatole a su convaincre – non sans mal et malgré elle – Clémence d’accepter de jouer ensemble les oubliés. A l’ouest le soleil s’écroule derrière les colonnes grecques de l’entrée principale. Venez ! venez ! Il la prend par la main et l’entraîne. Les scènes s’enchainent. Tendres… Drôles… Parfois hilarantes, tel ce cours d’anglais improvisé qui laisse Anatole sur son séant ! Le jeune homme et sa marraine quitteront bien entendu le parc monceau pour s’y retrouver l’année suivante. En juin 1916.
Deuxième acte
Une pièce de théâtre réussie doit sembler tenir du hasard. C’est ainsi qu’interfèrent comédiens et spectateurs dans la spontanéité du jeu. La justesse d’une mise en scène de bon aloi participe évidemment au succès. Au fil des scènes et à force de découvrir les personnages, l’on finit par éprouver ce qu’ils ressentent, fut-ce à travers l’artifice d’une interprétation où (s’il s’agit d’une simple lecture) de l’imagination que l’on s’en fait. La marraine amoureuse est la preuve qu’une excellente pièce se joue autant qu’elle se lit avec le même plaisir conjugué. Disons simplement que ce deuxième acte embellit le premier.
Quelques saisons plus tard, Anatole et Clémence sont (peut-être) devenus amants ; l’idée apparait lorsque l’élève-aspirant trousse la jeune femme derrière les buissons. « Vous croyez qu’il suffit d’embrasser une femme pour la connaître ? » Un peu plus loin. Lui : « Quand remettons-nous le couvert ? » – Elle : « Je n’ai plus vingt ans, monsieur Langeron. » Encore plus loin après la confession d’avoir réservé une chambre au Lutécia, Clémence ajoute avec une tendresse nostalgique : « Je croiserai peut-être dans cette hôtel des amis de mon mari, ils y retrouvent leur maîtresse, nous serons en terrain de connaissances. Ça ne sera pas vous qu’ils jugeront, ça ne sera pas vous qu’ils mépriseront, ce sera moi ! La veuve indigne qui bafoue la mémoire de son glorieux mari, mort pour la France ! »
Troisième acte
Dans une pièce en quatre partie, le troisième acte pose d’ordinaire la réussite ou l’échec des protagonistes face à l’intrigue des deux précédents ; il annonce le dernier levé de rideau qui bientôt mettra en lumière la résolution des combines et grenouillages face aux spectateurs curieux. Nous sommes désormais en septembre 1917. L’uniforme d’Anatole est celui d’un sous-lieutenant, et Clémence apparaît le ventre arrondi. La guerre fait rage. Personne n’imagine l’armistice de si tôt. Benoît Marbot signe ici parmi les plus beaux dialogues de la pièce. Il ne conviendrait pas de les dévoiler dans cette chronique ; le lecteur doit en conserver la surprise essentielle à son éblouissement. Juste dire qu’Anatole commence à comprendre (malgré lui) qu’une femme peut changer un homme pour peu d’un véritable amour entre les deux.
Avant le rideau final
La marraine amoureuse laisse imaginer les charmes d’un théâtre aujourd’hui oublié. On pense à certaines comédies romantiques qui ont fait le succès du boulevard des années 1960/70. Benoît Marbot nous fait ressentir cet étonnement et cette reconnaissance à découvrir des personnages – plus ou moins drôles et plus ou moins profonds – induisant une histoire dont on imagine volontiers la suite après le rideau final. Il y a du romanesque dans cette œuvre exposée au fil d’une action qui arrive à un dénouement tout aussi inévitable qu’il était prévu dès les premières répliques. Alors ! Faut-il lire La marraine amoureuse ? Oui. Ce texte ne souffre d’aucune réplique banale, tout en satisfaisant la copie des phrases de la vie. C’est grâce à ce parfait équilibre entre le juste et le vrai que Benoît Marbot accroche le spectateur, posant ainsi les répliques dans une action qui contribue à ce qu’il est convenu d’appeler un véritable « spectacle ».
Jérôme ENEZ-VRIAD
© Mars 2025 –Esperluette Publishing & Bretagne Actuelle
LA MARRAINE AMOUREUSE, une pièce de théâtre de Benoît Marbot (texte) aux éditions L’Harmattan – 95 pages – 13,00 €