ÉLÉMENTS : Vous écrivez que nos régimes ne sont plus vraiment des démocraties. À vous lire, l’ont-ils jamais été ? Ou ne sont-ils depuis l’origine qu’un simulacre de légitimité entretenu par le langage et les procédures ? Vous évoquez à ce propos un « logos devenu pouvoir ». Faut-il comprendre que le discours a pris le pas sur le réel et que la démocratie s’est muée en régime du verbe où la parole officielle tient lieu de vérité ?
FRANCK MARTINI. Nous vivons sous ce que l’on appelait jusqu’à la fin du XVIIIe siècle des gouvernements représentatifs, que personne n’avait jusque-là songé à appeler des démocraties. Leur rapport à la démocratie n’est qu’indirect, ce qui ne les a pas empêchés de préempter le terme. Ces régimes valorisent des abstractions à visée universelle (liberté, égalité…), dont la réalité sous-jacente n’est que le déploiement d’un individualisme radical, associé à la permanence d’un ordre du pouvoir bourgeois, légitimé par l’argent et la technique. C’est un attelage par nature ambigu, voire contradictoire. Il ne peut se maintenir sans être révélé dans son incohérence que par la production continue d’un « logos », qu’il soit de type mythologique ou, dans ses formes les plus dégradées, un simple narratif. Plus les contradictions inhérentes à ce type de régime s’exacerbent, plus la production du logos est déterminante. C’est exactement ce à quoi nous assistons. Il devient proliférant et vient obturer le rapport au réel. Dans les périodes de prospérité et de sécurité, ce phénomène se voit moins. Dans des périodes plus difficiles, il se voit plus ; et on assiste alors à une forme de dévoilement. La démocratie libérale est le destin politique de la modernité occidentale depuis que nos sociétés ne sont plus instituées sur un ordre transcendant, mais sur un ordre purement humain. Un matérialisme se combinant avec le primat de l’économique, la centration sur un rapport technique au monde, la survalorisation de l’individu, le développement conjoint de l’État et du marché, lui donnent son assise. Il se trouve que, dans les faits, cela se traduit par une fuite en avant perpétuelle inhérente à la modernité occidentale. Or, dans sa dynamique, elle vient faire voler en éclat les promesses officielles des régimes occidentaux. Le logos sous toutes ses formes (produit par les médias ou par les penseurs appointés) est le dernier refuge de l’oligarchie représentative. Elle préserve ses rapports de pouvoir d’une main par l’établissement d’une réalité parallèle, une réalité du discours ; et de l’autre main distribue récompenses et subsides. Demain, quand l’État sera suffisamment appauvri, ce sera par la police et les mots.
ÉLÉMENTS : Vous écrivez que la démocratie libérale est devenue le tombeau du peuple et du citoyen, sinon même de toute grandeur. Faut-il comprendre que le peuple a disparu ou qu’il est prêt à ressurgir ? Est-ce le peuple qui s’est effacé ou les institutions qui ont cessé de lui donner corps ?
FRANCK MARTINI. Pour ce qui est du citoyen, on emploie le terme, mais on l’a vidé de toute substance. À ce jour, le titre de citoyen est une stricte imposture. Il faut être fermement décidé à être aveugle pour ne pas le voir. Cet état de fait illustre d’ailleurs le pouvoir du logos. Quand on ne distingue plus le citoyen de l’étranger, quand il est privé de toute possibilité d’action concrète sur les affaires publiques, on ne saisit pas bien ce qui en reste. Il en va de même pour le peuple. Le premier acte a été de le faire disparaître du champ des représentations et d’en troubler la compréhension. C’est le rôle des intellectuels. Le second acte sera de le faire disparaître pour de bon. Mais on n’en est pas tout à fait là. L’annihilation de la mémoire et la destruction démographique ne sont pas encore mûres. Le système institutionnel aujourd’hui est un acteur parmi d’autre visant à empêcher la manifestation du peuple, non pas comme classe sociale mais comme réalité intrinsèque. Cela ne signifie absolument pas qu’il a disparu. Il ne faut pas céder à l’envoutement des récits et des théories. Ce serait accorder une victoire trop facile à ses ennemis. Lorsque la crise atteindra un certain niveau, il se manifestera. À la condition toutefois que l’on soit capable d’exprimer un projet politique alternatif dans lequel le peuple pourra reprendre sa forme. Sinon on en restera à des révoltes populaires sans avenir.
ÉLÉMENTS : Vous insistez sur la tension entre horizontalité et verticalité : comment concilier l’égalité citoyenne, fondement démocratique, et la hiérarchie, principe aristocratique ? Vous parlez d’une hiérarchie orientée vers la hauteur. Que désignez-vous par là ? S’agit-il d’une métaphysique du politique ou d’une simple exigence morale appliquée à la cité ?
FRANCK MARTINI. C’est un point essentiel. La démocratie réclame l’égalité. Mais l’égalité sans frein, menant à l’indifférenciation, profondément toxique, n’est que l’expression d’un monde livré à l’individualisme et au nihilisme. La hiérarchie refusant l’égalité n’a plus de fondement depuis la modernité. Il faut donc trouver l’harmonie dans un cadre nouveau, et non pas un compromis. La réhabilitation du peuple et du citoyen est le seul moyen de retrouver une communauté tournée vers le bien commun. L’exercice de la fonction de citoyen, entendue au sens plein, est en même temps une décentration de son propre horizon personnel, une tension intérieure vers le plus haut. À ce titre, le rang de citoyen ne peut être distribué, il se mérite par son exercice. Le peuple, quant à lui, est à la fois le fondement et l’expression de la culture qui seule est capable de nous dire ce qu’est le bien commun. Cela, et en toute logique, exige d’abord la défense du commun et de la culture partagée qui est la condition du lien entre tous, d’un retour de l’attachement contre l’atomisation. Dans ce commun, l’horizontalité et la verticalité ne se combattent pas. Elles participent d’un ensemble qui est à la fois susceptible de faire vivre la société et de faire grandir les hommes. Le commun est la seule source possible de la communauté des hommes libres. Il ne s’appuie pas en premier lieu sur une morale, une décence commune, comme on pourrait le croire. Mais, à un niveau plus profond, sur les principes intangibles qui fondent notre singularité culturelle (dont on n’a pas à attendre une portée universelle). Ses soubassements relèvent de notre être culturel, dont on ne peut appréhender les confins que dans une perspective métaphysique.
ÉLÉMENTS : Vous voyez dans le libéralisme une anthropologie appauvrie. Quelle est-elle ? Et en quoi l’homme libéral est-il un homme diminué ?
FRANCK MARTINI. L’homme libéral, entendu comme l’homme produit par le libéralisme réel (par analogie avec le défunt socialisme réel), est présenté comme l’homme émancipé. En réalité, il se donne à voir comme l’homme délié de ses appartenances, de ses lignées, de sa propre histoire. Il est celui qui vit pour lui-même et dont la seule expérience existentielle, au fond, est de se saisir comme le centre du monde. Mais il est en même temps sommé de se considérer le frère de tous, selon la déontologie pratique des Lumières, exprimant une forme de christianisme sans Christ. De ce point de vue, il est profondément divisé et passe beaucoup de temps à se mentir à lui-même pour garder un semblant d’équilibre. Sur cette base fragile, il ne conçoit la vie et les autres qu’à travers une forme de matérialisme en action faisant de l’intérêt le barycentre de sa vie psychologique. Ainsi il n’a quasiment plus à proprement parler de liens ; à la place, il a des relations. L’engagement est rétractable en fonction de la balance des profits (symboliques, matériels, affectifs). La seule mesure de toute chose, à ses propres yeux, c’est lui, envisagé dans un rapport technique aux autres, au monde, à lui-même. Mais, humble ou vaniteux, réduit à ce qu’il est, coupé de ses racines, il n’a guère de consistance. Il est condamné, dans cette configuration, à chercher sans cesse dans les yeux d’autrui la reconnaissance comme palliatif à son déficit ontologique. Les comportements sociaux l’illustrent tous les jours. La solitude est son destin inévitable, l’impossibilité du sens son état permanent. Enfin, il se mettra à croire à n’importe quoi susceptible de masquer sa réalité. L’homme libéral est diminué en ce qu’il est mutilé d’une part majeure de ce qui constitue l’humanité dans sa compréhension la plus puissante.
ÉLÉMENTS : Comment les classes dirigeantes ont-elles pu rompre le pacte organique qui liait jadis les élites à la nation ? Pourquoi parlez-vous de « préférence élitaire » ? Cette sécession des élites est-elle réversible ? Une réconciliation organique entre peuple et élites est-elle encore concevable ?
FRANCK MARTINI. Soyons justes, les démocraties libérales ont su témoigner d’un souci du peuple. Non pas pour le peuple en lui-même. Elles ont conçu d’intelligents arrangements visant à leur propre développement, d’autant plus aisés en périodes de croissance forte. À ce moment, la redistribution a battu son plein, les services publics se sont développés, l’État n’exerçait pas un contrôle constant. C’était la plus raisonnable des formules, du moins tant que le cadre national était prégnant au niveau politique, mais surtout au niveau économique. La menace communiste a pu jouer également sur ce plan. Or, tout cela s’est considérablement modifié dès la fin des années soixante. La dissolution du cadre national, la mondialisation, la financiarisation ont eu des effets massifs. Ceci aussi bien du point de vue factuel que du point de vue culturel. Quand les intérêts de la classe dominante ne sont plus attachés au territoire dans lequel elle vit, on peut s’attendre à ce que sa solidarité avec le territoire s’amenuise. C’est ce qui s’est produit. Aujourd’hui, on en est venu à ce que ses membres ne vivent presque plus dans ce territoire. Il ne devient alors qu’un genre de centre de profit et, en même temps, un reliquat. Cette classe, telle la haute aristocratie du Moyen Âge, entretient des relations naturelles avec ses homologues, en particulier anglo-saxons, auxquels elle s’identifie. D’où la préférence élitaire. Mais aucune relation avec ses classes populaires. Qu’espérer de cela ? Du point de vue culturel, défendre la nation est devenu pour elle une forme d’arriération mentale, une position régressive. Ajoutons qu’une peur viscérale du peuple (et le mépris qui va avec), qui n’est pas nouvelle, mène les élites au pouvoir à le combattre ; et pour ce qu’il en reste à le surveiller par tous les moyens. Elles neutralisent dans le même temps ce qui reste de peuple en elle : on n’accède à ces classes qu’en prouvant une loyauté sans faille et en abjurant le peuple. En conséquence de quoi il n’y aura pas de réconciliation. Le processus semble irréversible. On assiste même à une forme de radicalisation élitaire que l’on peut très facilement identifier. La réassignation des élites à la nation, leur retour à leur rôle traditionnel et à leurs réelles responsabilités ne se feront que par une immense réaction populaire.
ÉLÉMENTS : Qu’entendez-vous par « République populaire » – sous-titre manifeste de votre essai ? Le terme n’est pas sans évoquer les « démocraties populaires » communistes d’hier…
FRANCK MARTINI. Oublions les références marxistes et contentons-nous du sens premier des mots. Une République populaire est une République civique, dans laquelle les citoyens ont un pouvoir effectif et qui trouve sa légitimité dans la souveraineté du peuple. Cela n’a rien d’extraordinaire en soi, mais il est frappant de constater à quel point nous en sommes éloignés. Reconnaître que le peuple est souverain a quelques implications très simples qu’il s’agit d’accepter : nulle puissance extérieure ne peut s’imposer au peuple qui, sinon, n’est pas libre ; nulle puissance intérieure ne peut se substituer au peuple : on ne lui retire pas sa capacité souveraine à décider sur quelque sujet que ce soit. Enfin, si le peuple est souverain le droit individuel ne peut s’imposer à lui en toute chose. Le citoyen ne se contente pas d’élire des représentants que l’on a choisi pour lui. Certes il vote, et même beaucoup, pour des représentants, aussi pour décider lui-même. Mais il agit également, c’est-à-dire qu’il est impliqué dans les affaires publiques, et déjà au niveau le plus local. Il n’existe qu’à travers l’exercice de sa responsabilité civique. Ainsi, la démocratie a un devoir essentiel : fabriquer du citoyen. Pour résumer, la République populaire implique la souveraineté intégrale du peuple, le citoyen réalisé et la démocratie véritable. À ce stade, nous devons constater que nous sommes devant quelque chose d’étrange : aucun républicain ne peut contester les fondements de ce type de République, aucun de nos républicains n’est prêt à les accepter. Dans cette discordance, nous voyons se jouer le miracle de la démocratie libérale : elle s’habille de la défroque républicaine pour des visées qui ne sont pas dicibles publiquement.
Les pistes tracées dans Dépasser la démocratie libérale sont d’ailleurs développées et systématisées dans un ouvrage à paraître très prochainement qu’Alain de Benoist me fait l’honneur de préfacer.
ÉLÉMENTS : Comment dépasser le libéralisme sans tomber dans l’autoritarisme ? Autrement dit, comment redonner au politique sa souveraineté sans abolir les libertés ?
FRANCK MARTINI. La rhétorique habituelle de tous les politiciens libéraux est de dire « C’est nous ou le despotisme ». C’est une astuce bien pratique et, reconnaissons-le, très efficace. Elle permet de fermer la porte à toute alternative démocratique, et même à toute réflexion sérieuse sur le sujet. Or, il n’existe pas d’antinomie entre le maintien des libertés individuelles (qui aujourd’hui ne sont plus assurées par les démocraties libérales, l’introduction de l’identité numérique et la montée de l’insécurité l’illustrent assez bien) et le retour du politique à travers une souveraineté populaire réaffirmée. Mais il y a au moins trois conditions à cela : la restauration du citoyen à travers le principe de responsabilité civique, l’affirmation d’un droit du peuple (qui ne peut être à la fois souverain et dénué de droits) et la construction d’un appareil institutionnel mêlant démocratie représentative, directe et civique. L’ensemble étant protégé par une Constitution ad hoc garantissant et la nation et le citoyen contre l’ensemble des pouvoirs et des puissances (financiers, étatiques, factions oligarchiques diverses…) susceptibles de subvertir la liberté collective et la liberté individuelle. Au final, c’est l’activité démocratique qui protège les libertés individuelles tout en assurant la permanence de la nation et de sa culture. Alors, oui, la démocratie véritable permet de dépasser le libéralisme sans tomber dans l’autoritarisme. Il est difficile ne pas voir que nos régimes, qui prétendent séparer les pouvoirs, sont animés par une seule et même caste partageant les mêmes intérêts et les mêmes vues. Que ses diverses composantes s’affrontent parfois autour de telle ou telle pièce de viande ne change rien à l’affaire. Est-on capable de soutenir que la démocratie libérale, en France, est apte à protéger le peuple, à assurer sa souveraineté et à garantir la liberté effective des citoyens ? Évidemment non. Préférer s’inquiéter des risques potentiels d’un changement de régime sans vouloir considérer l’échec massif du régime actuel est, en réalité, une position baroque. On nous fait prendre l’empilement des droits individuels, qui finissent par disloquer la société, pour la liberté. Mais peut-on se demander de quelle liberté, au juste, il s’agit ? Il est à craindre que les démocraties libérales ne finissent en dystopies et que l’on accepte cela par incapacité à oser penser un sursaut.
ÉLÉMENTS : Quel rôle voyez-vous pour l’Europe dans ce dépassement du libéralisme ? L’« Occident », notion aujourd’hui fatiguée, doit-il être abandonné comme catégorie politique, voire comme horizon de civilisation ?
FRANCK MARTINI. Au moment où nous parlons, il semblerait que l’Occident a eu raison de l’Europe. Si l’on devait définir rapidement deux de ses traits caractéristiques, on pourrait dire qu’il est à la fois le représentant parfait de l’impérialisme de la modernité (prégnance de l’économique, ubris technique, utilitarisme forcené, individualisme radical…) cherchant à s’imposer à tous et partout, et le faux-nez de la domination anglo-saxonne. Aujourd’hui, il nous écrase comme jamais. Il est donc nécessaire et urgent de cesser de nous identifier à lui et d’embrasser ce qui nous tue. De son côté, l’Europe, comme pôle civilisationnel, est en train d’expirer sous nos yeux. Son déclin en tant que puissance n’est que la manifestation de la dissipation de son âme. La faillite de ses élites, et de leur idéologie, est inédite. Leur incapacité ne serait-ce qu’à imaginer un destin a quelque chose de stupéfiant. L’Union européenne organise le meurtre de l’Europe, au-delà du meurtre des nations. Le tableau est sombre. Il ne faudrait pas, néanmoins, s’abandonner à trop de pessimisme. Paradoxalement, la France, pourtant matrice de l’universalisme, de l’égalitarisme, et plus globalement de la machine de guerre du libéralisme réel, a, plus que toute autre pays, un rôle à jouer dans une possible renaissance. À cela, deux raisons solides. Elle dispose d’une forte tradition républicaine entendue au sens strict (antérieure à la Révolution, et comprise comme res publica), elle a préservé un immense trésor culturel dont chacun, peu ou prou, reste porteur. Enfin, n’oublions pas que toute notre histoire est faite de bascules, de tragédies et de relèvements. Les moments où tout semblait perdu ne sont pas une spécialité contemporaine. L’anesthésie n’est pas la mort. Celui qui désespère a trop écouté les paroles vénéneuses de l’ennemi. Il pêche contre l’être en quelque sorte. L’histoire proche donnera des occasions de réveil (nous en voyons déjà les prémices). Pour les saisir encore faut-il s’extraire, au plan personnel et au plan collectif, du dôme mental du libéralisme et s’atteler à construire une voie positive pour l’avenir, correspondant à la précieuse singularité de l’homme européen. Tout reste ouvert.
Franck Martini, Dépasser la démocratie libérale. Pour une République populaire, Godefroy de Bouillon, 256 p., 27 €.



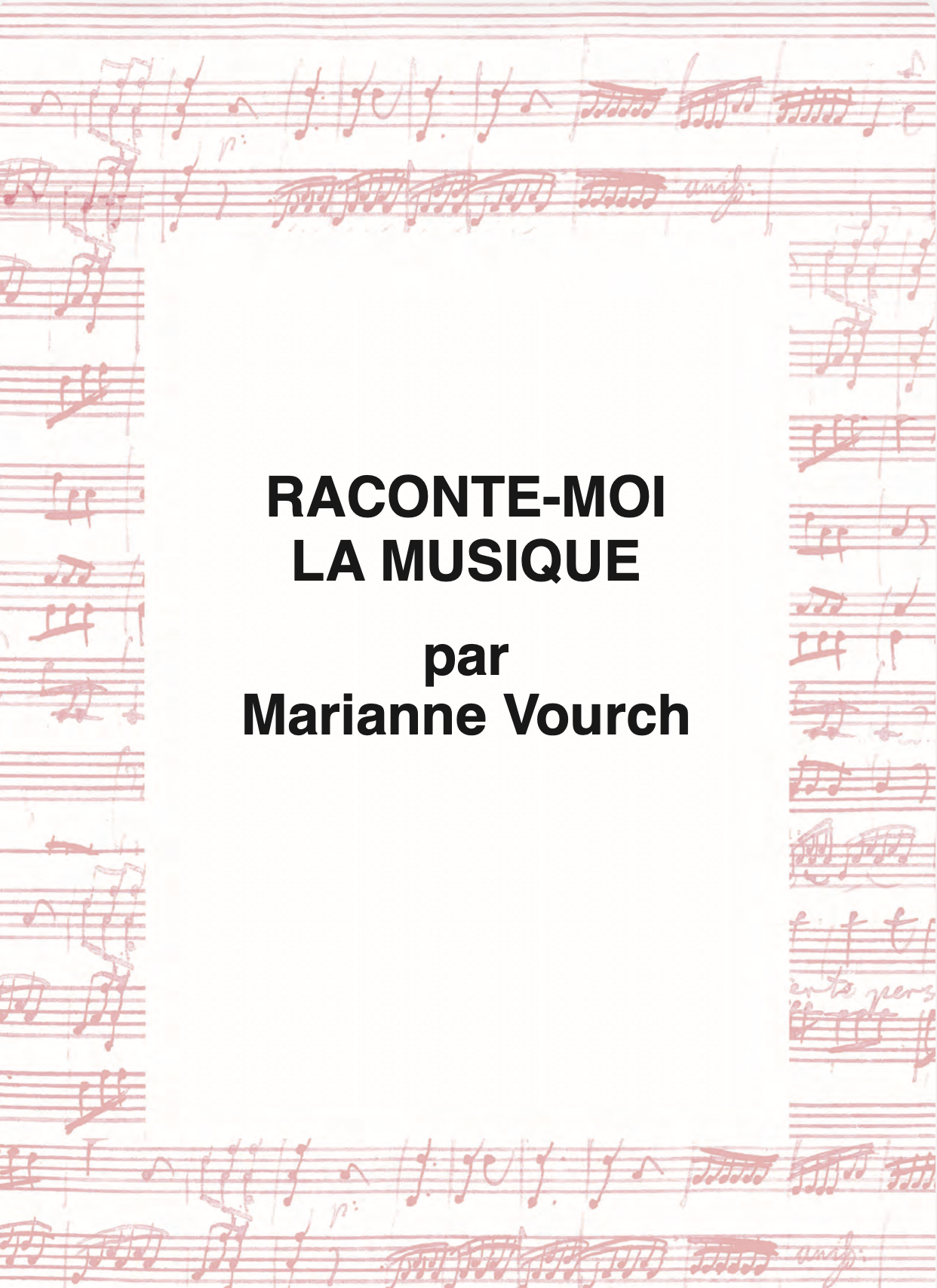
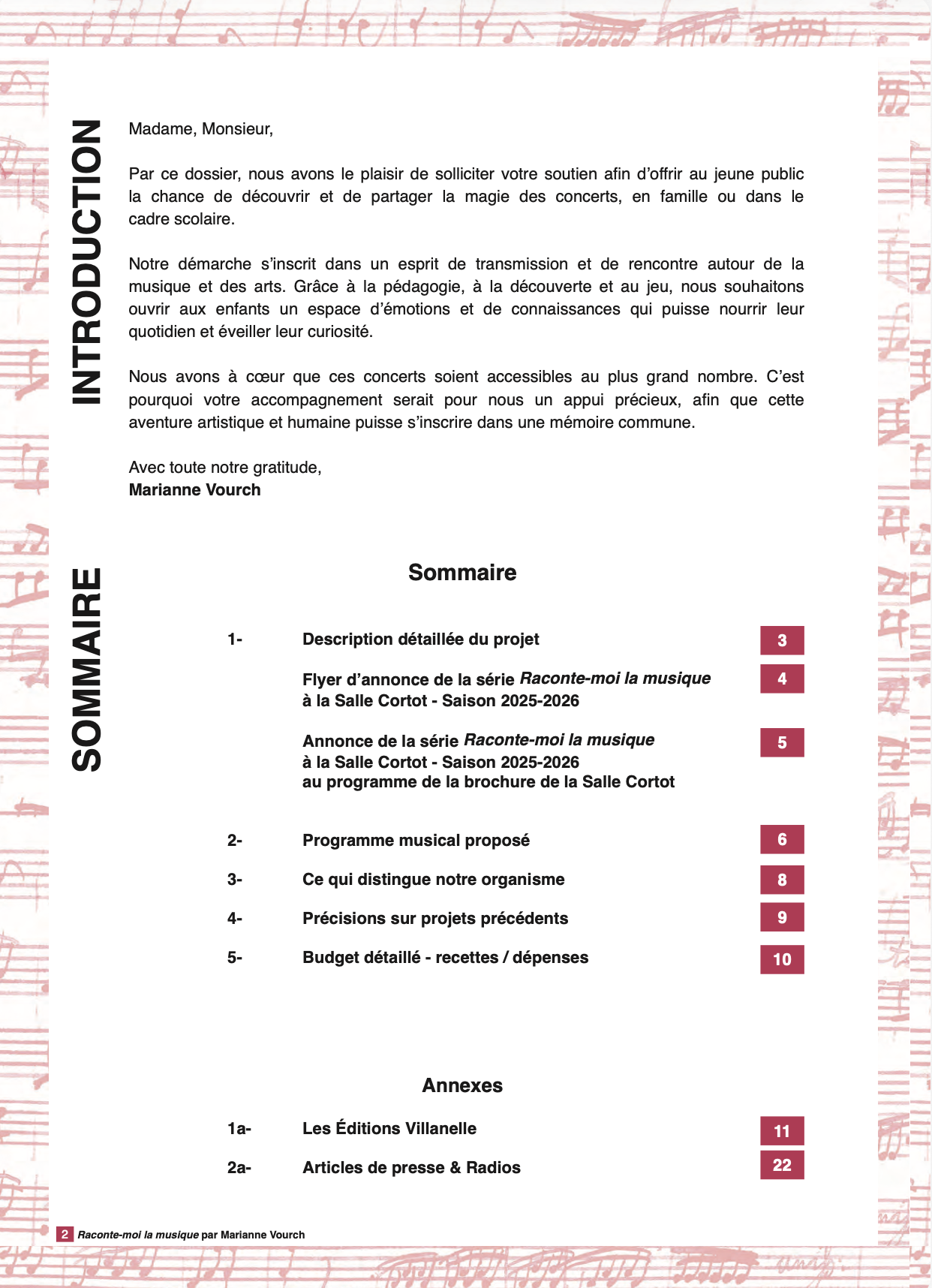
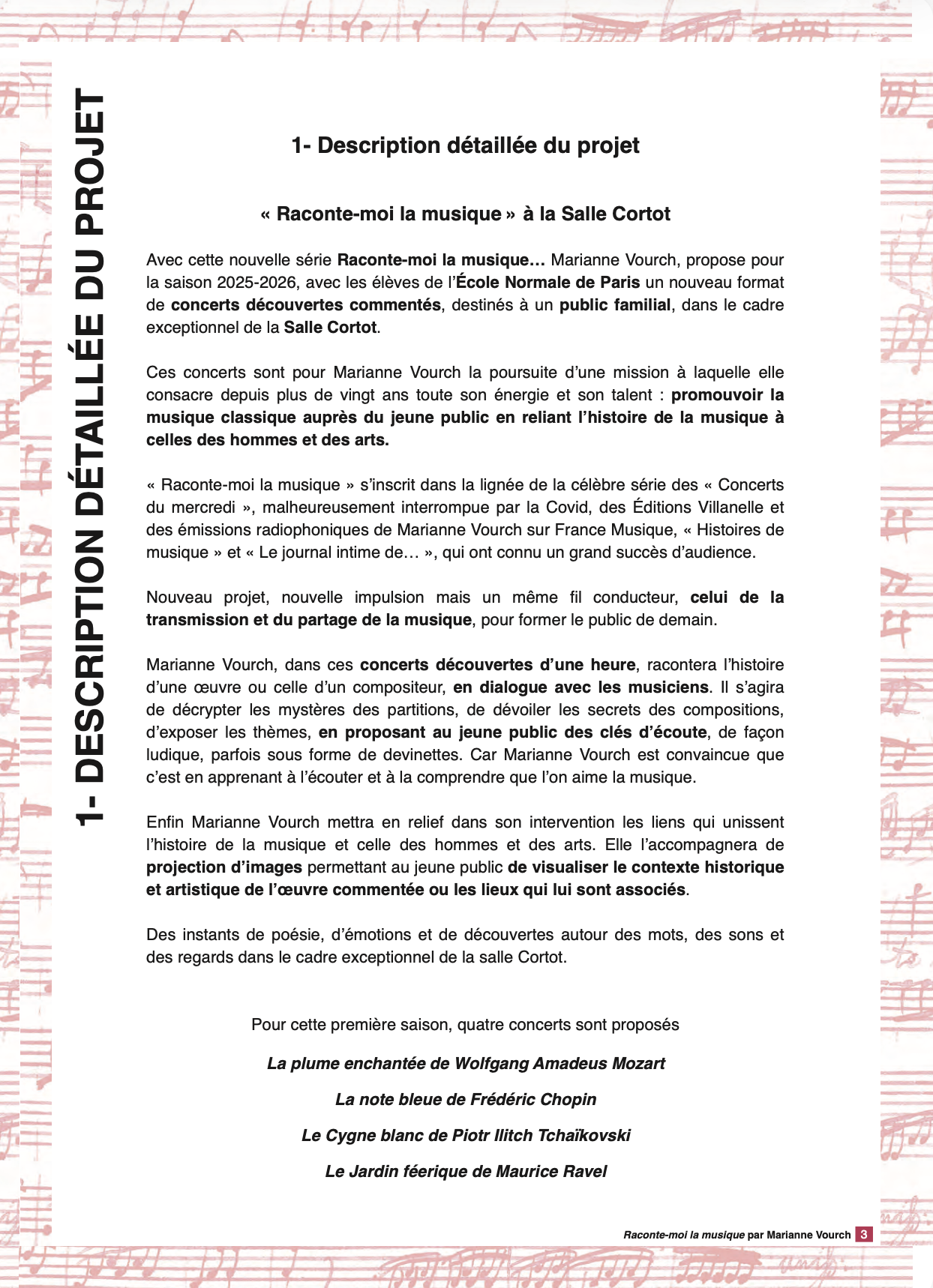

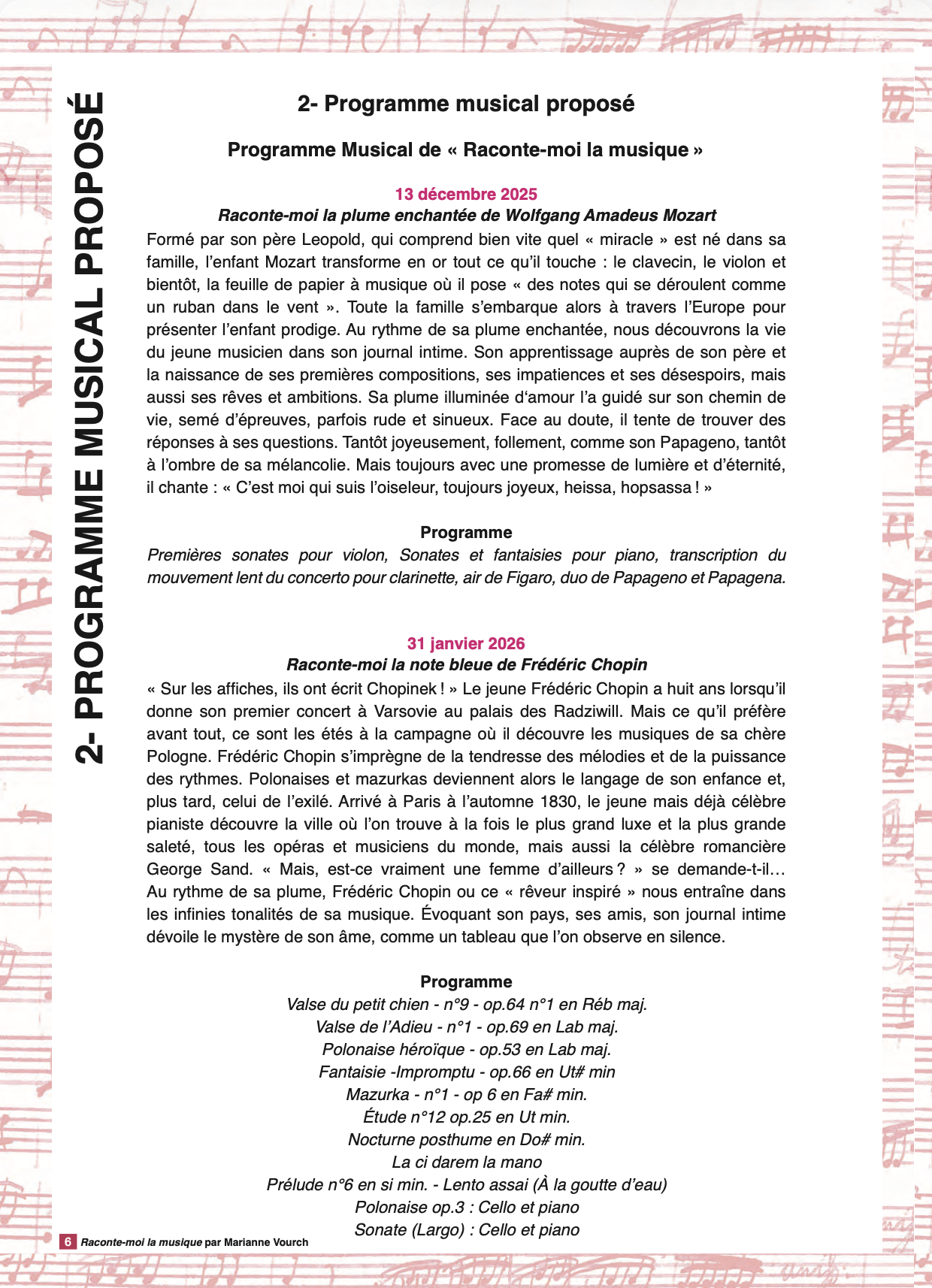
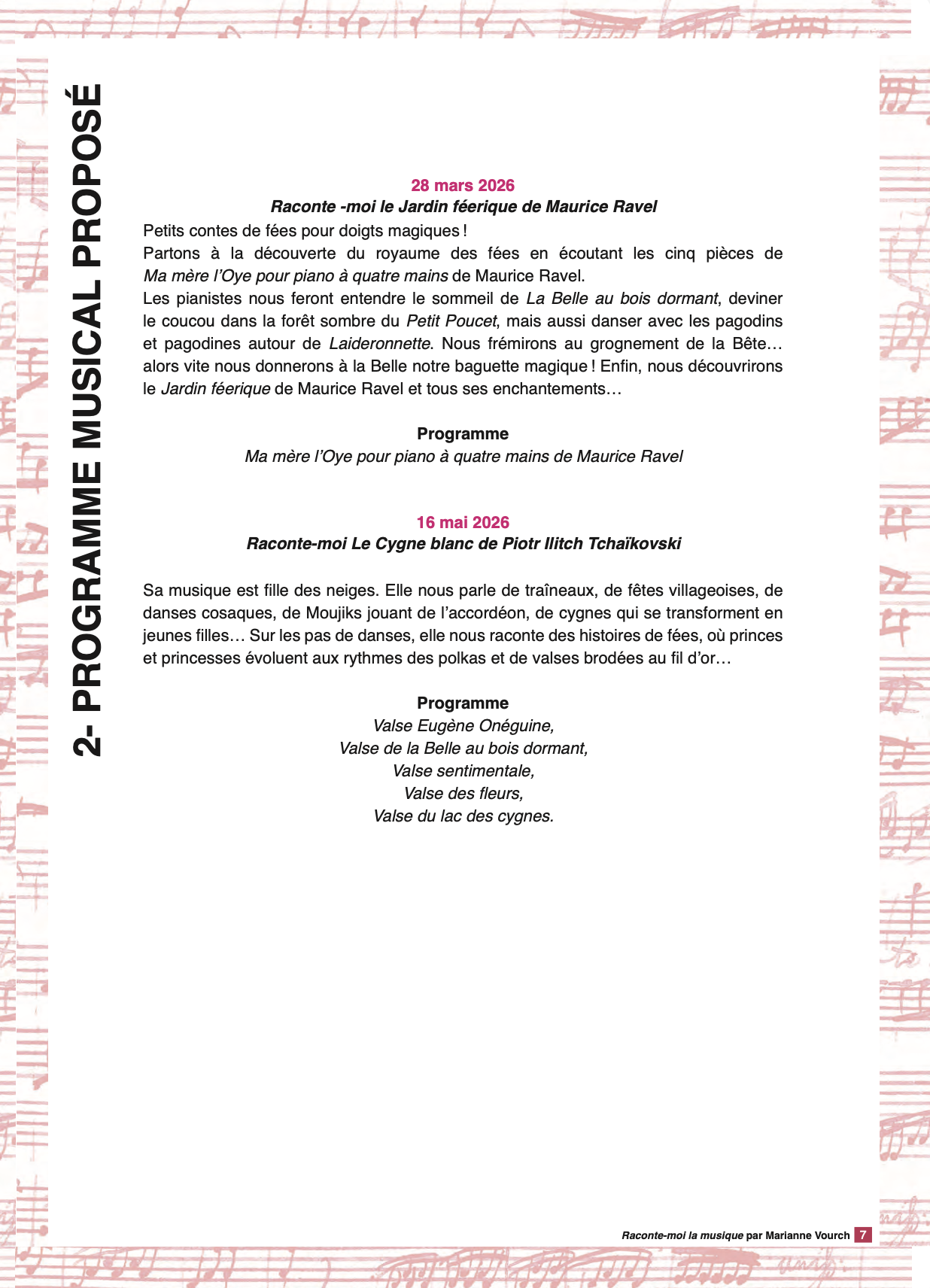
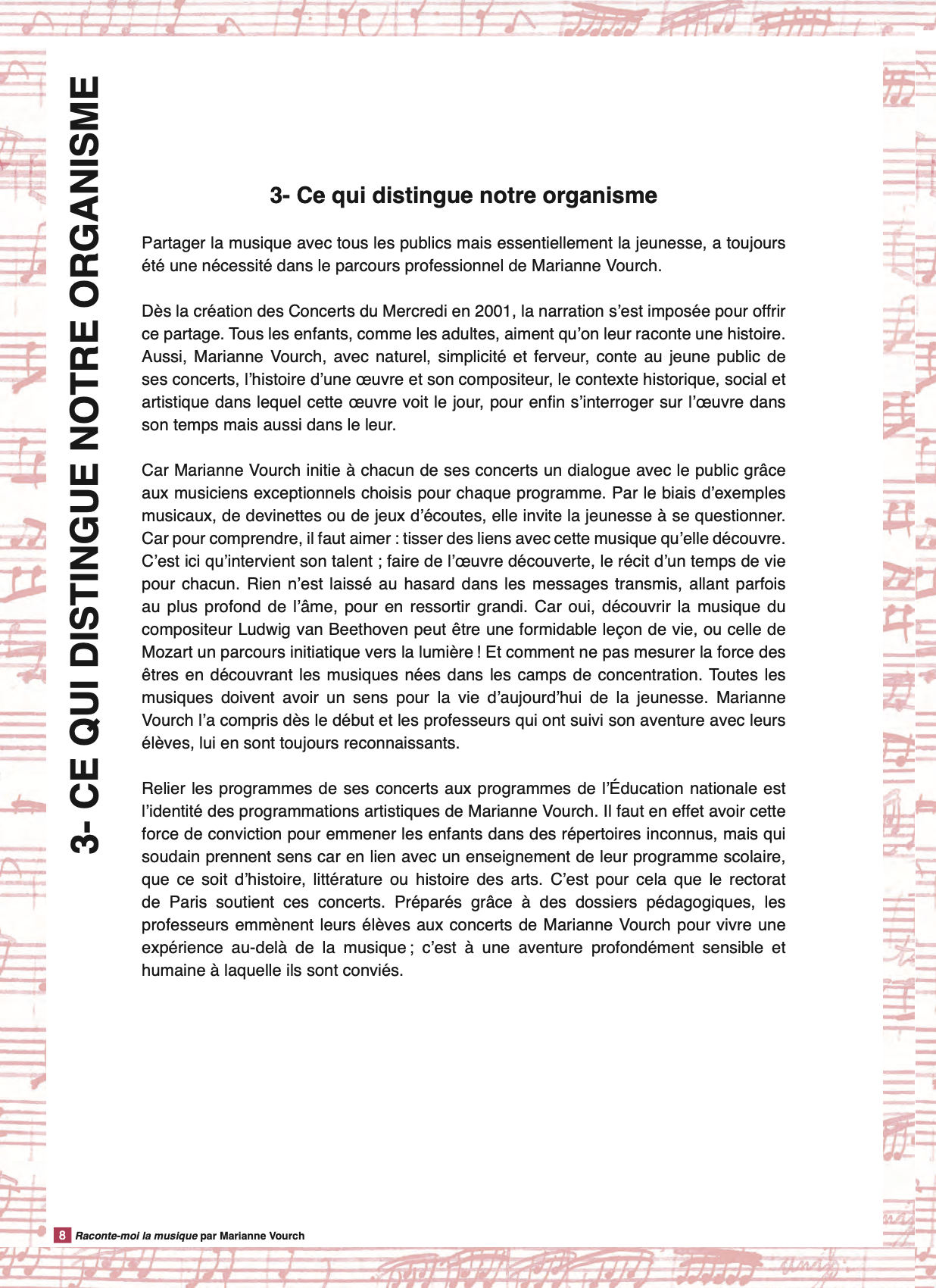
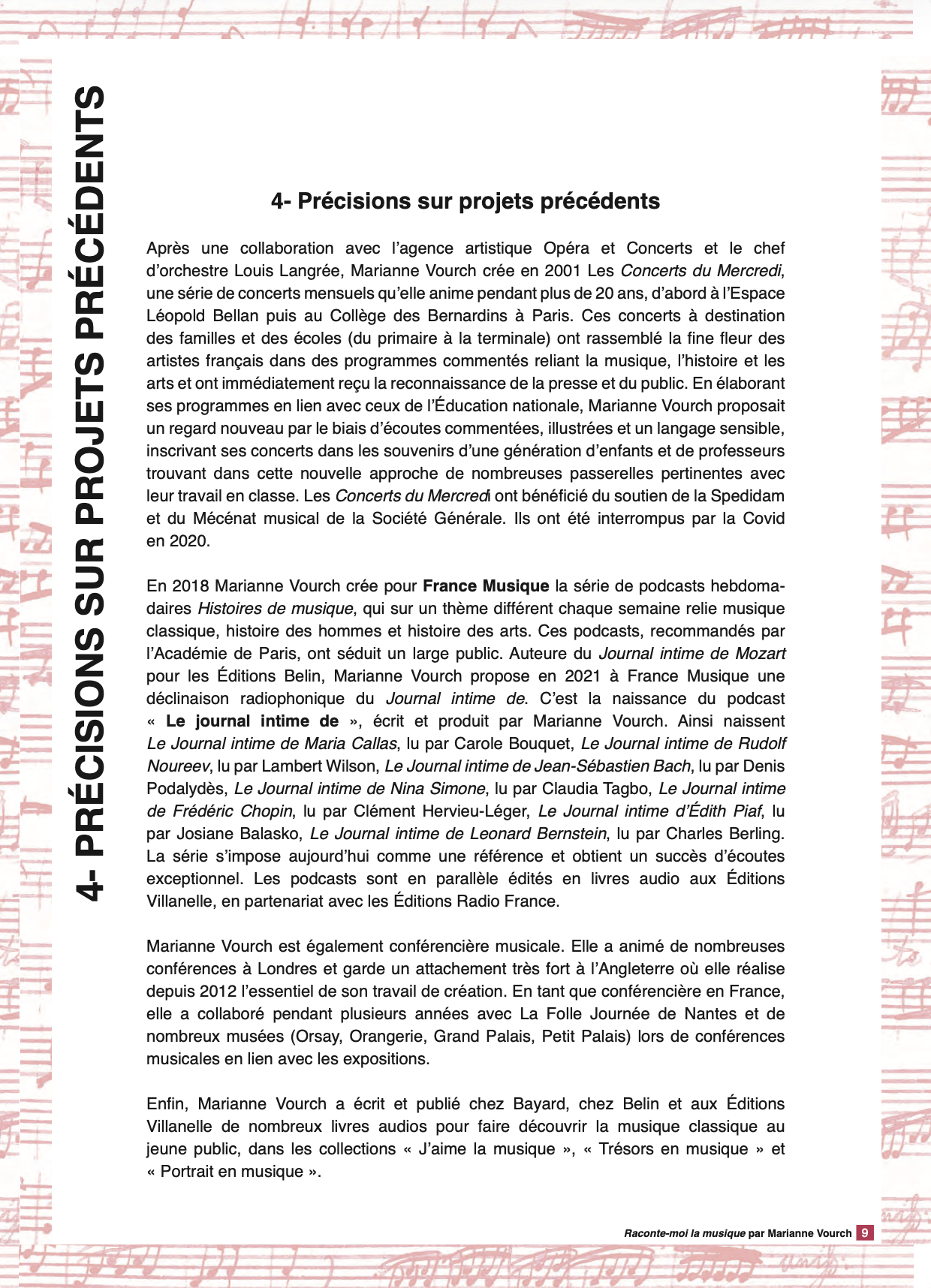
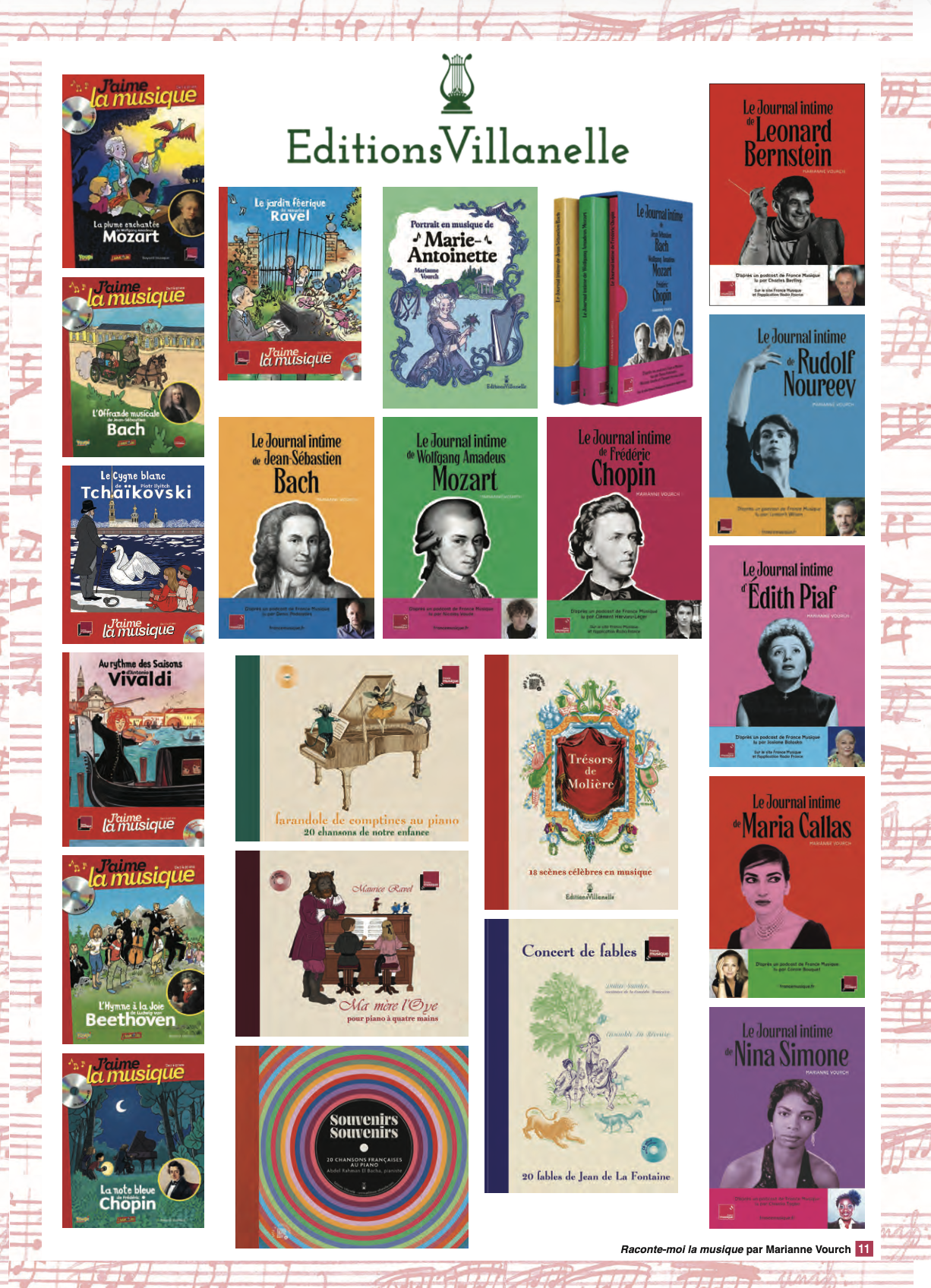
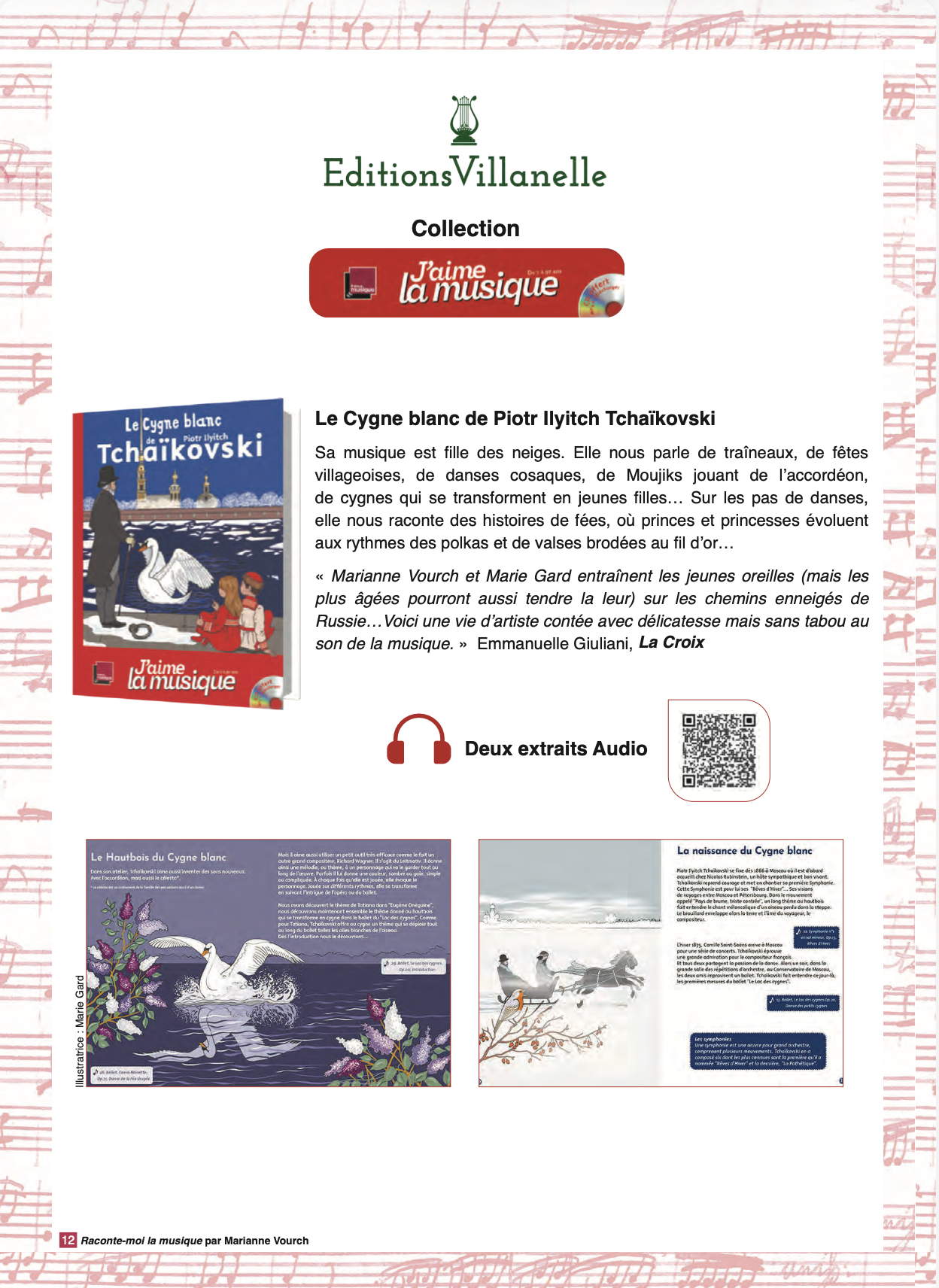
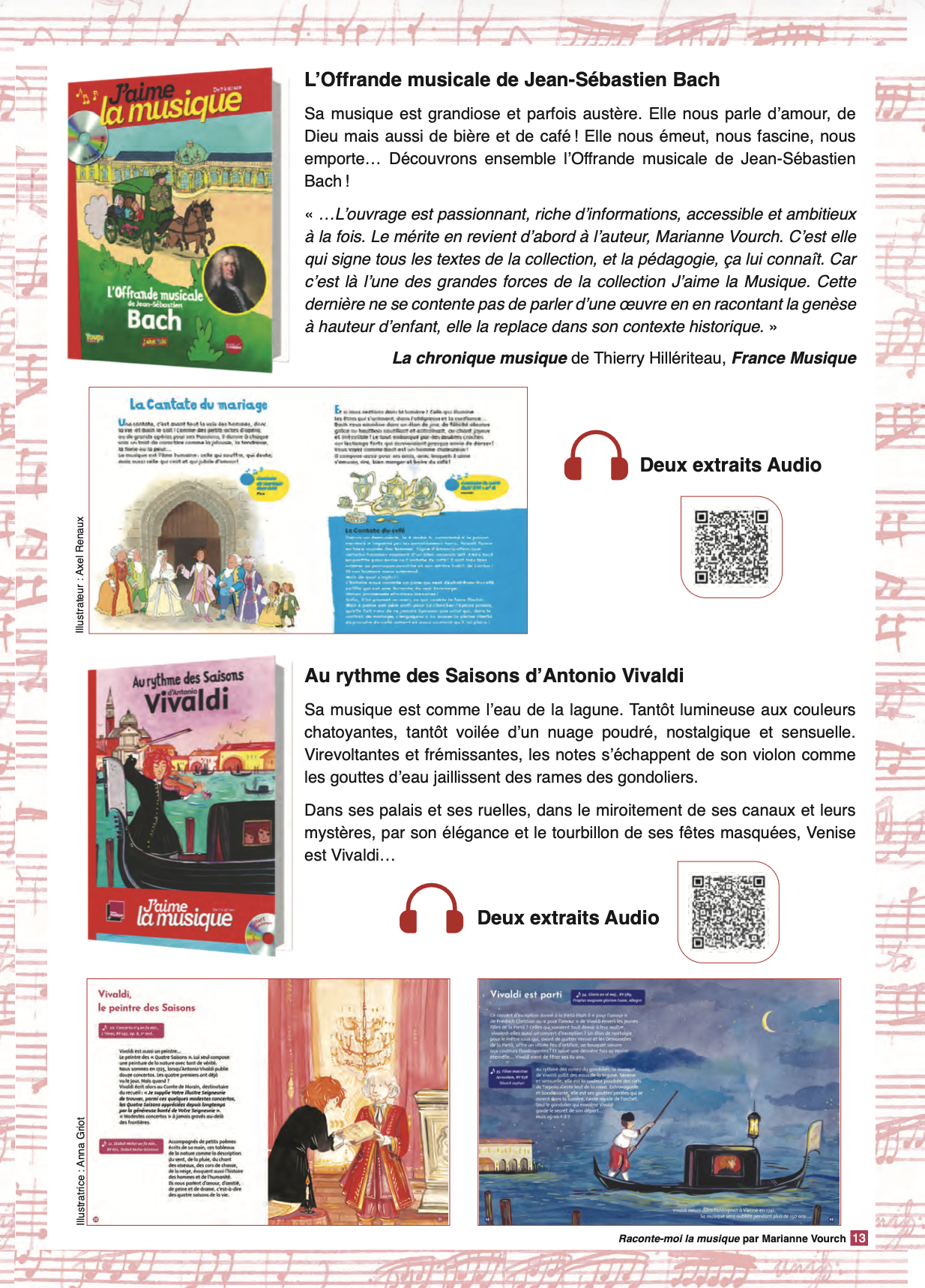
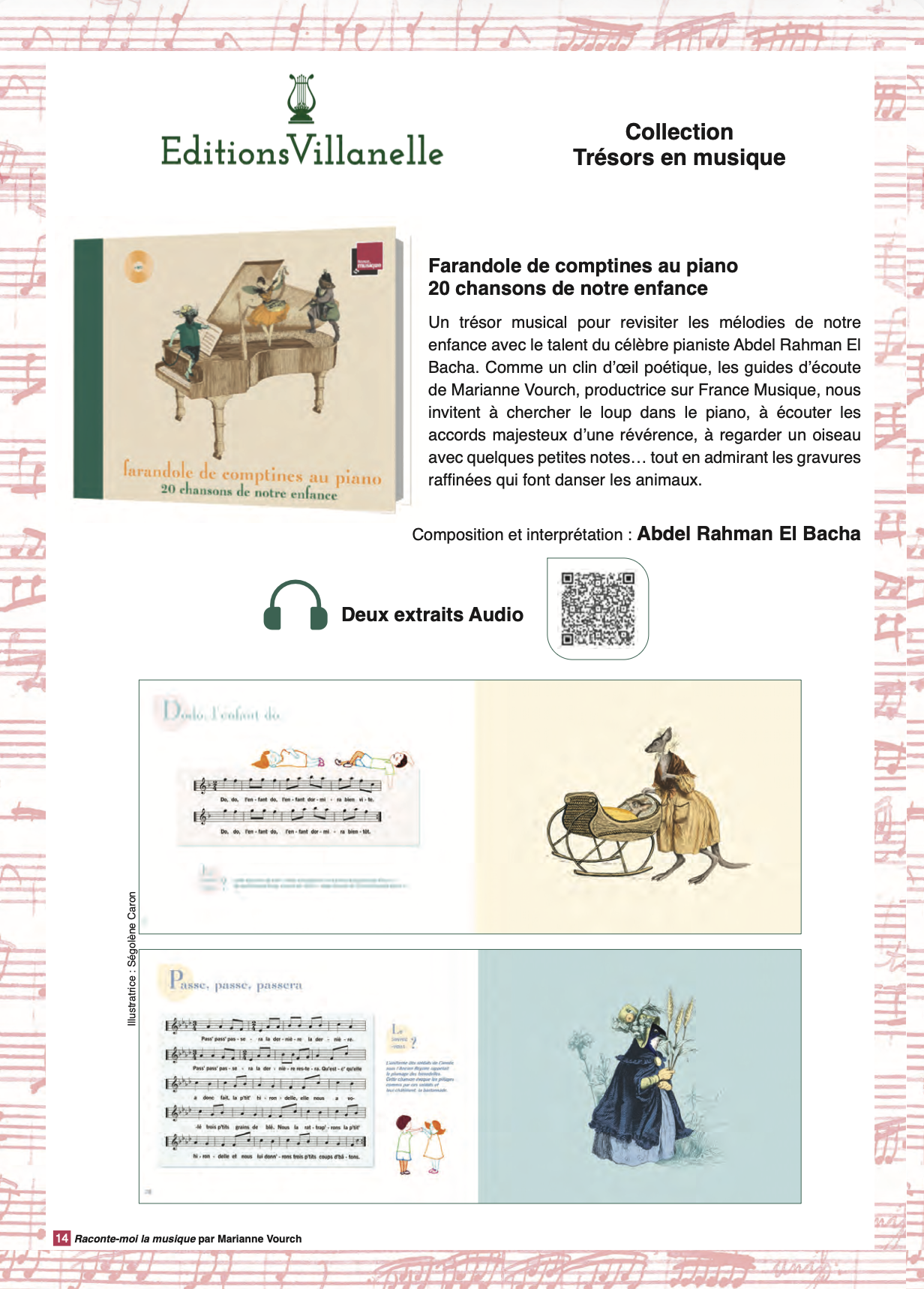
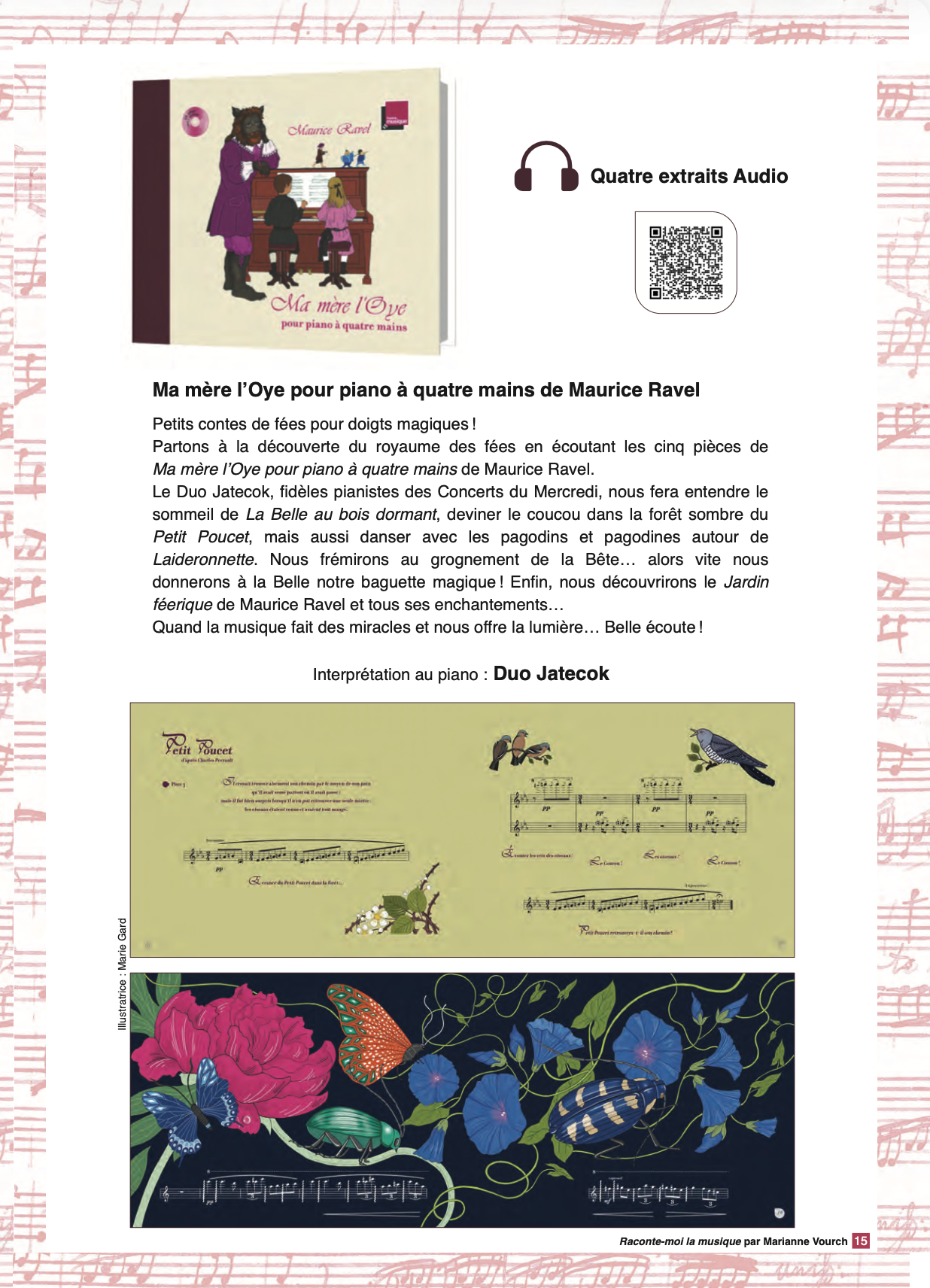
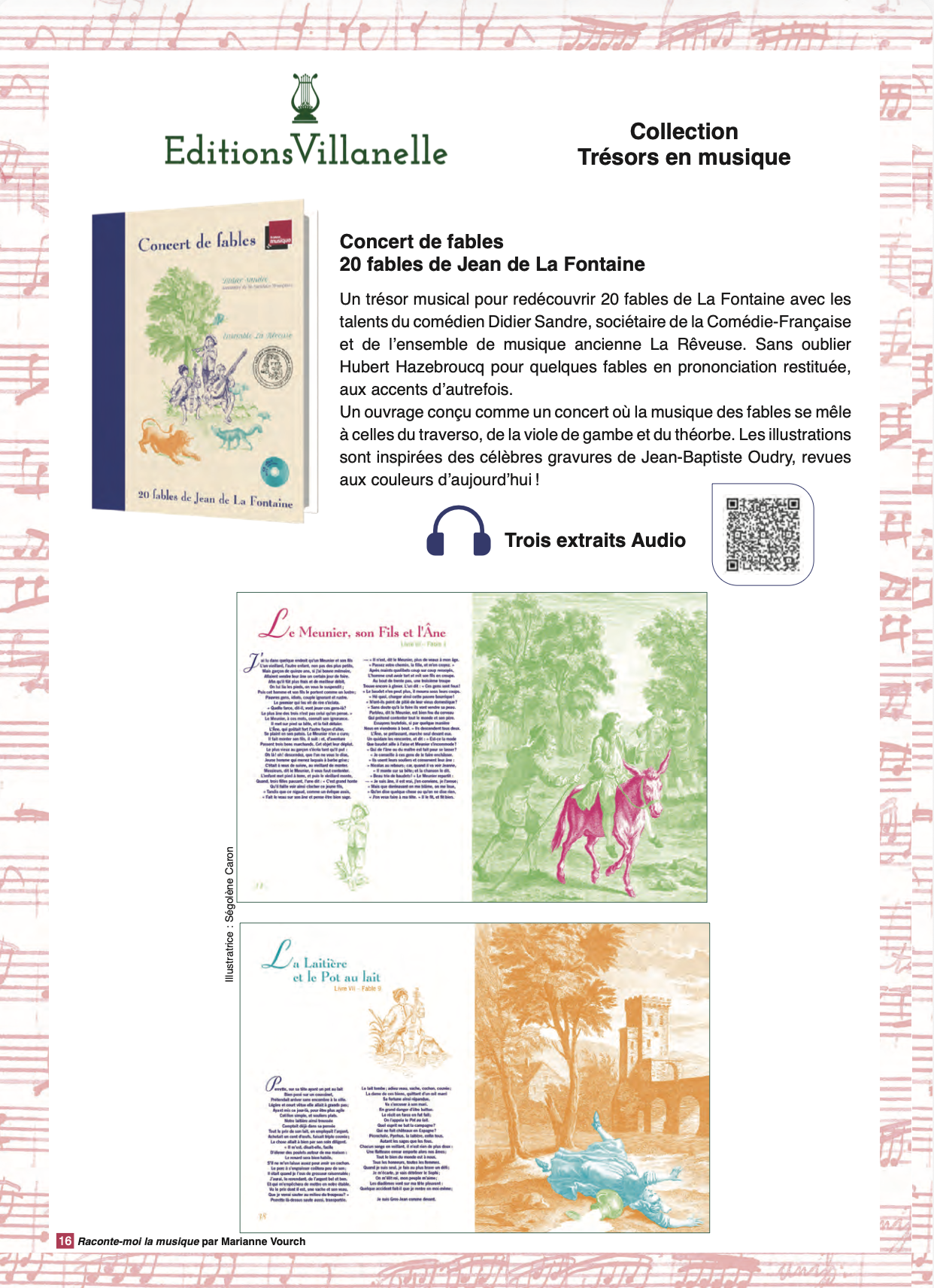
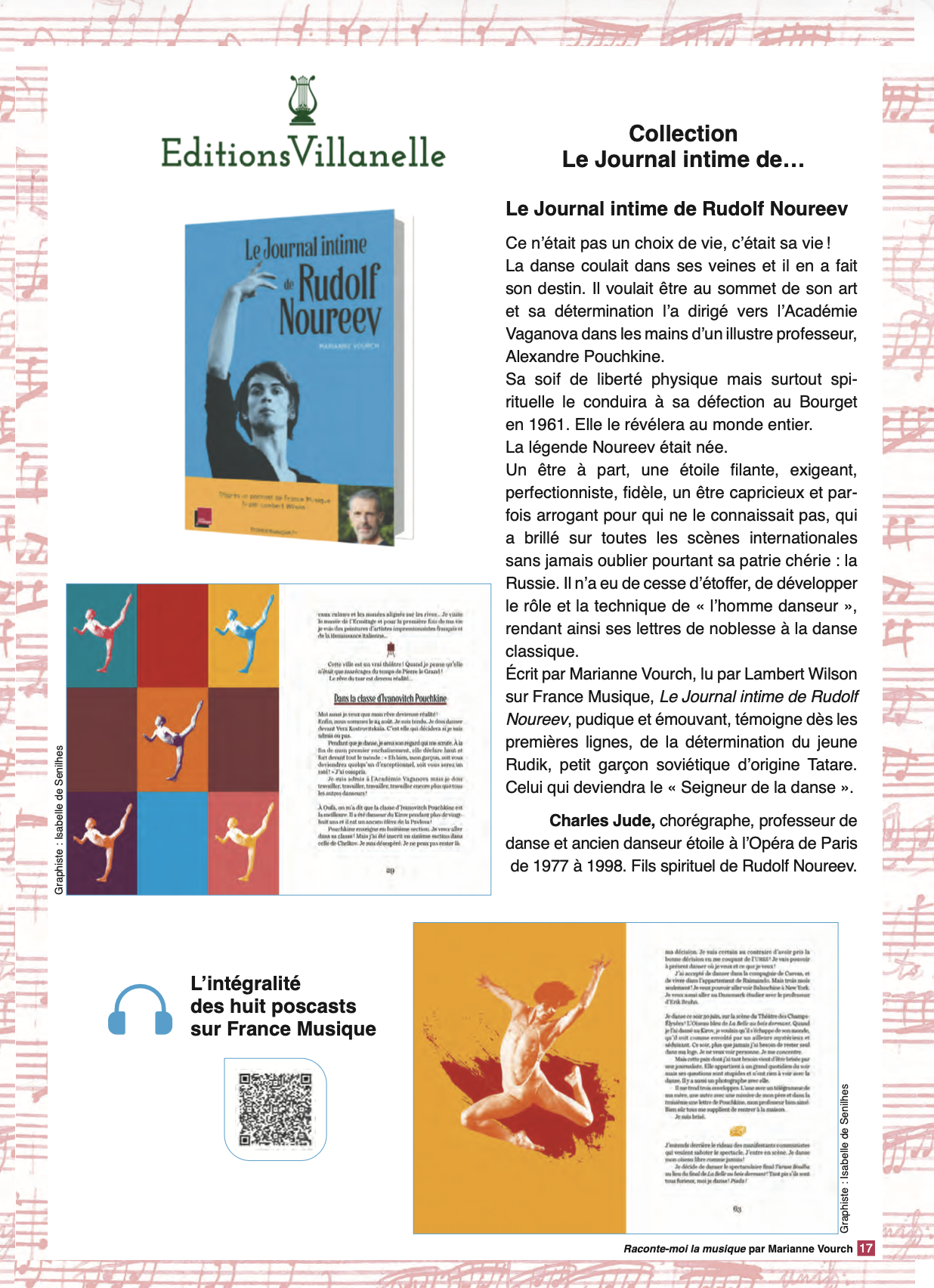
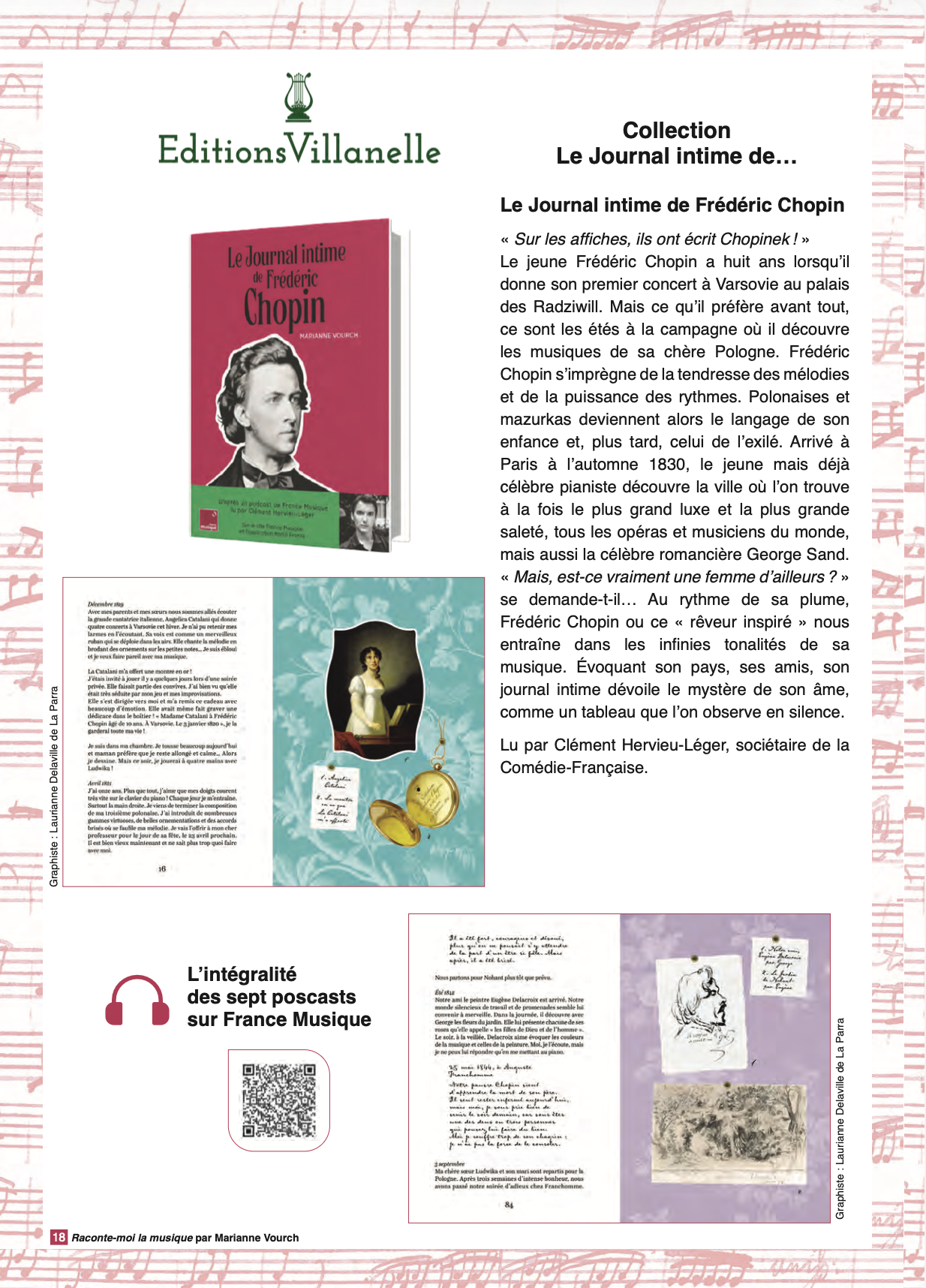

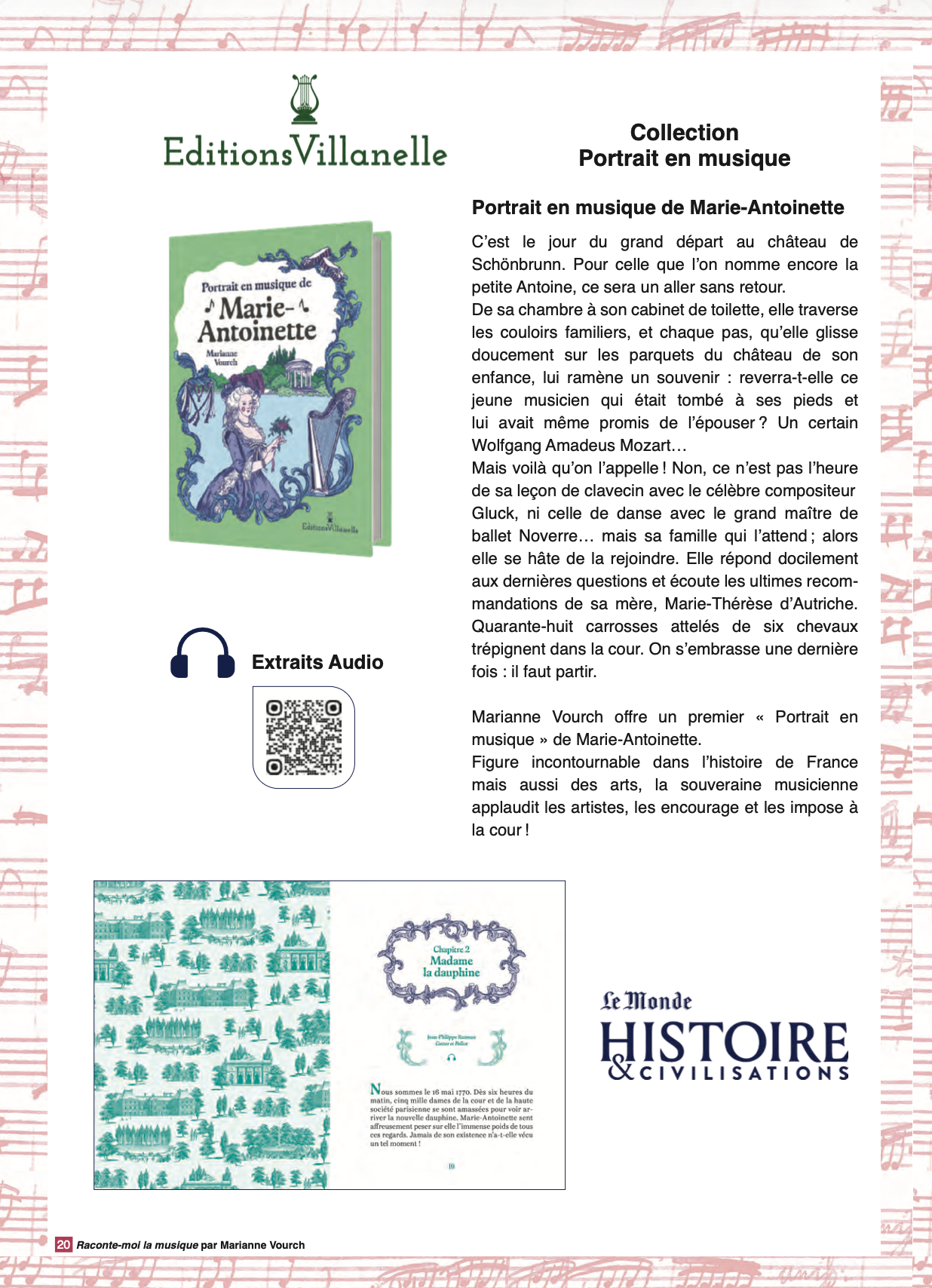

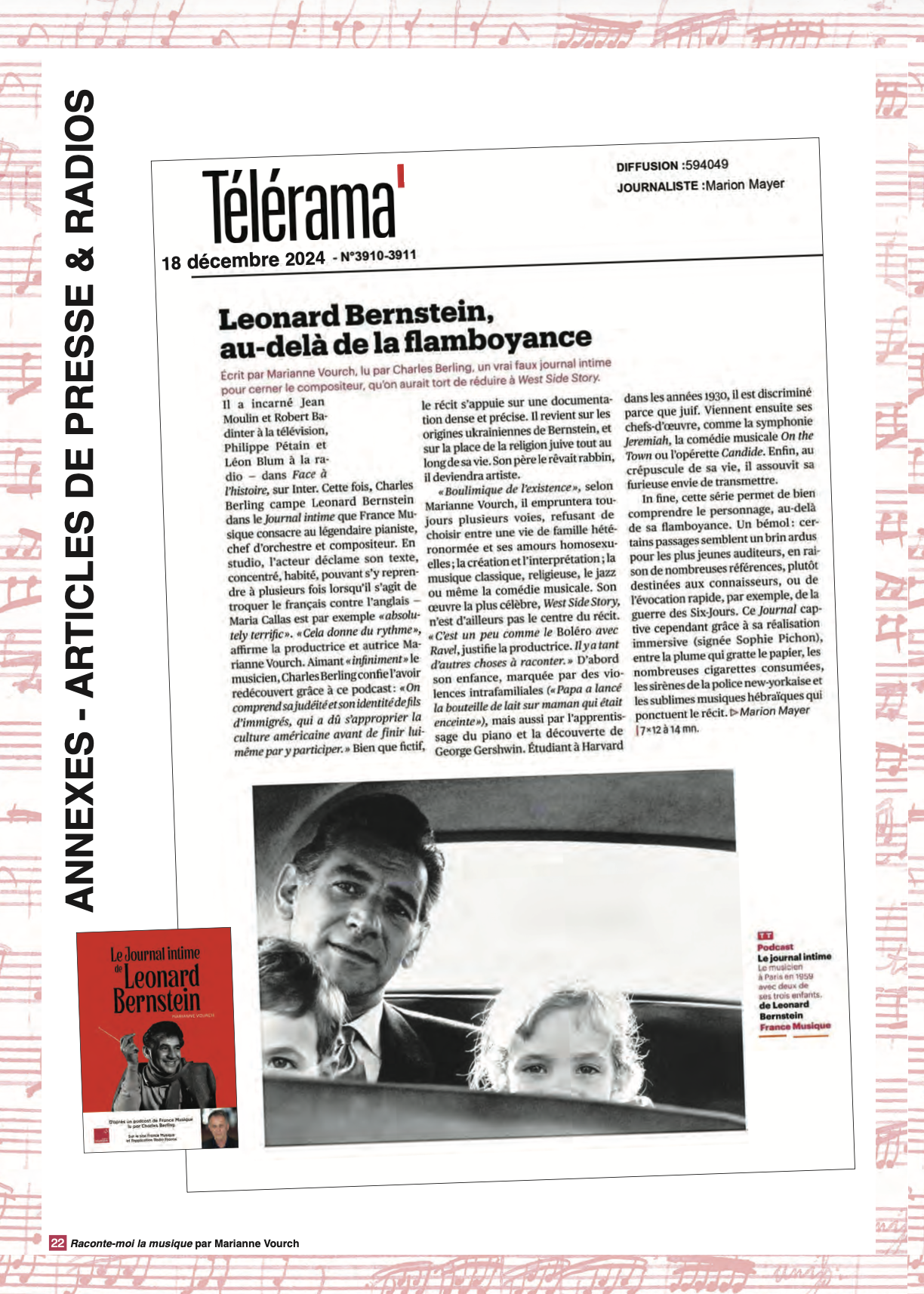
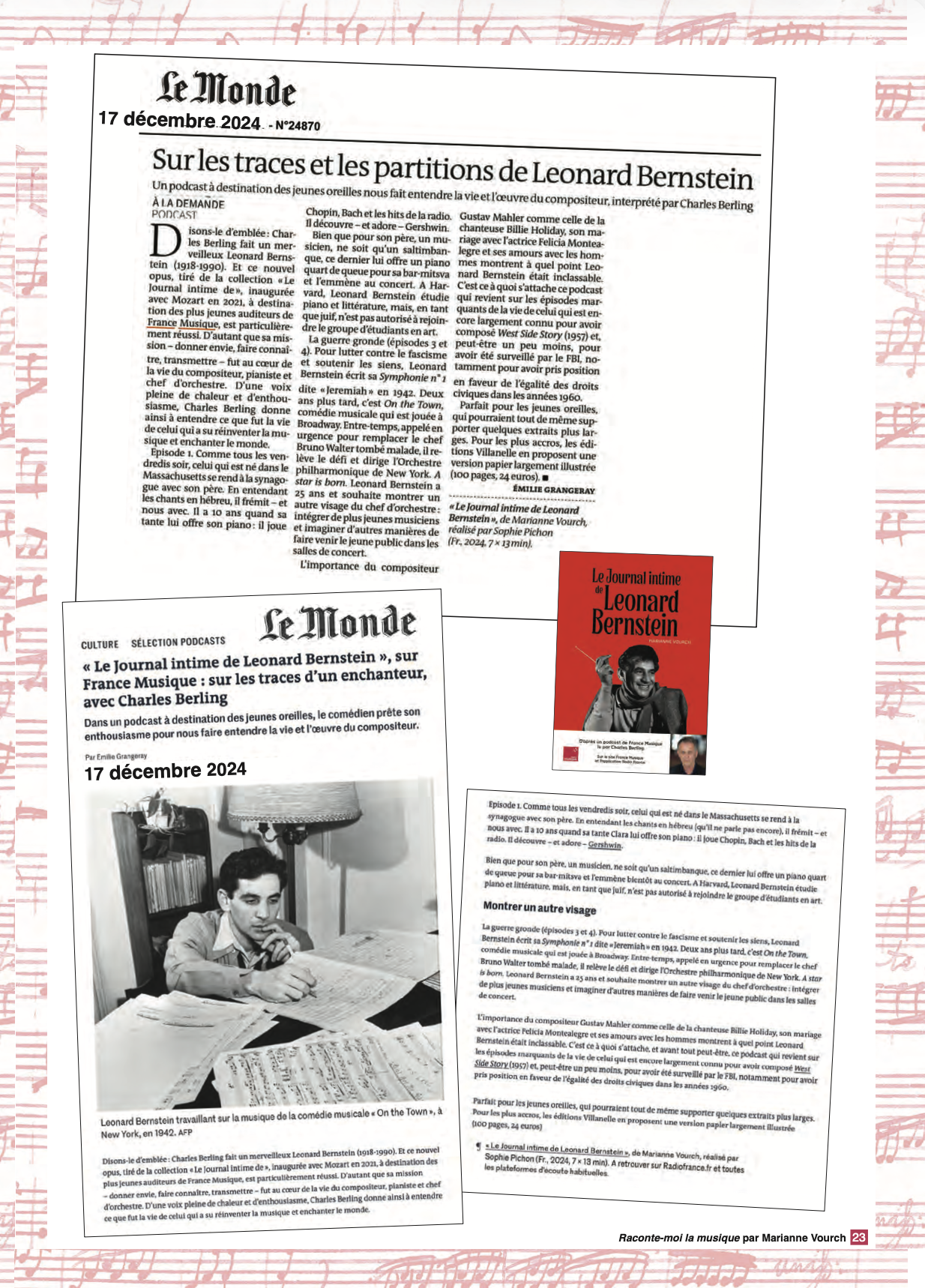

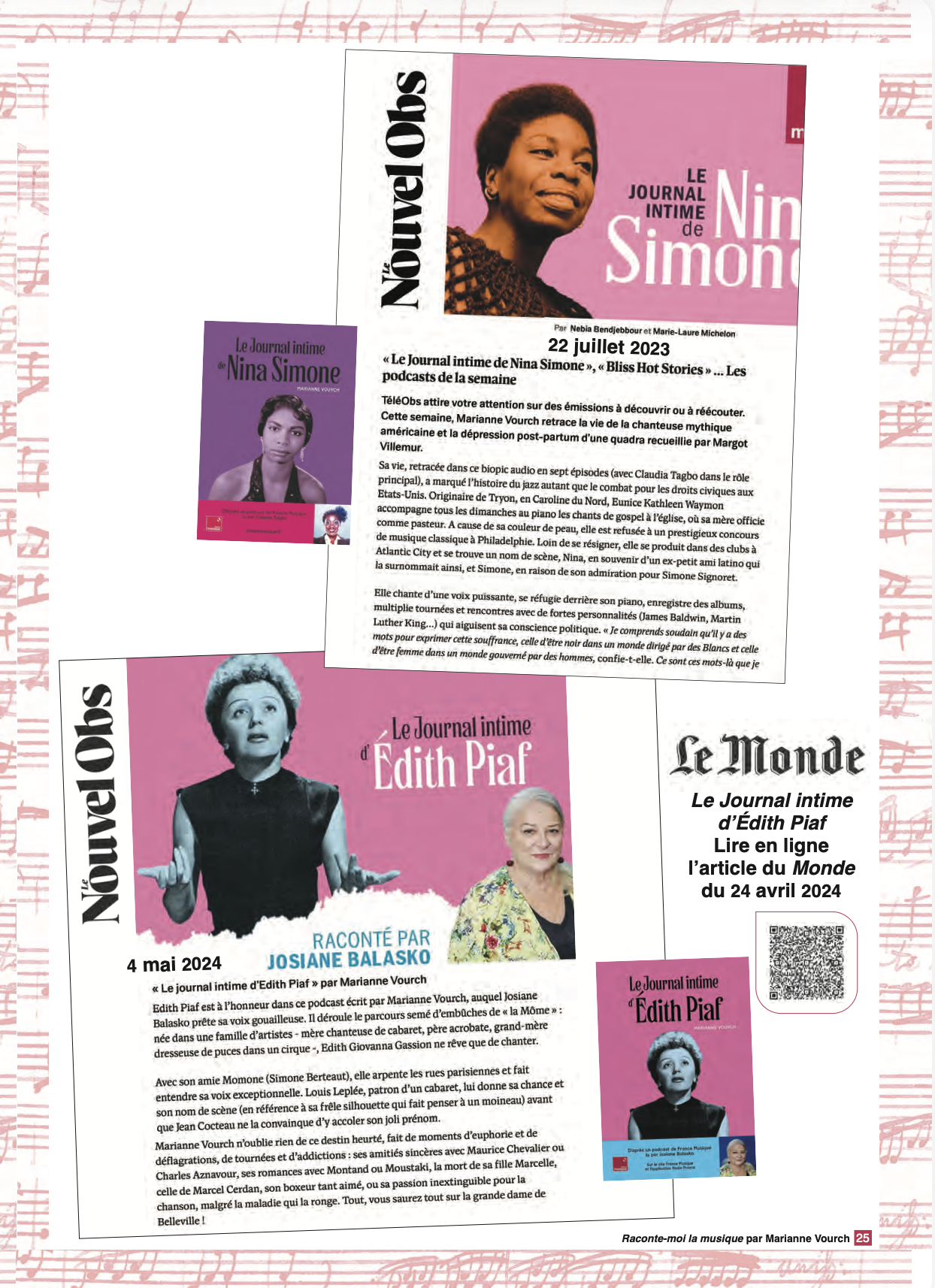
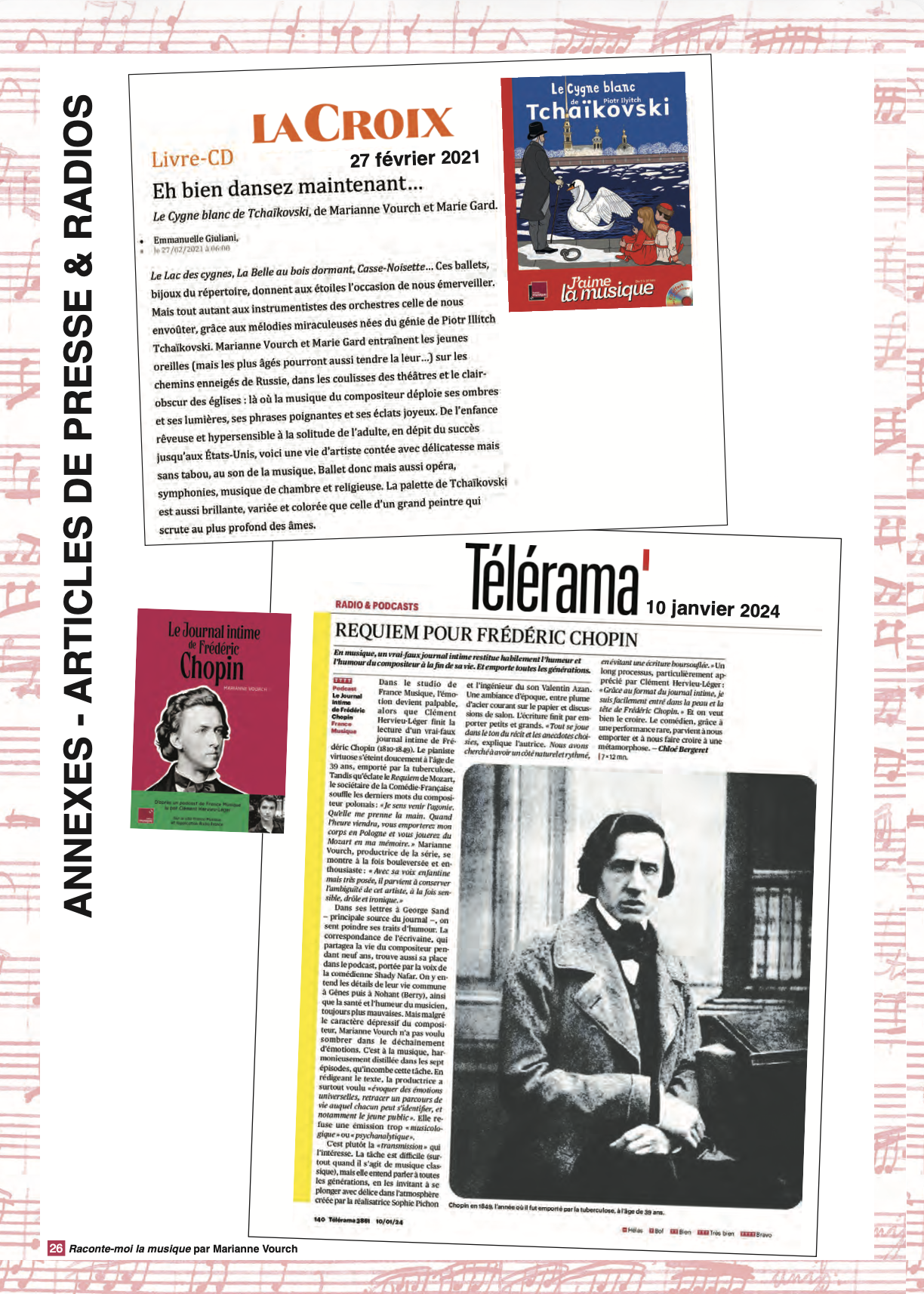
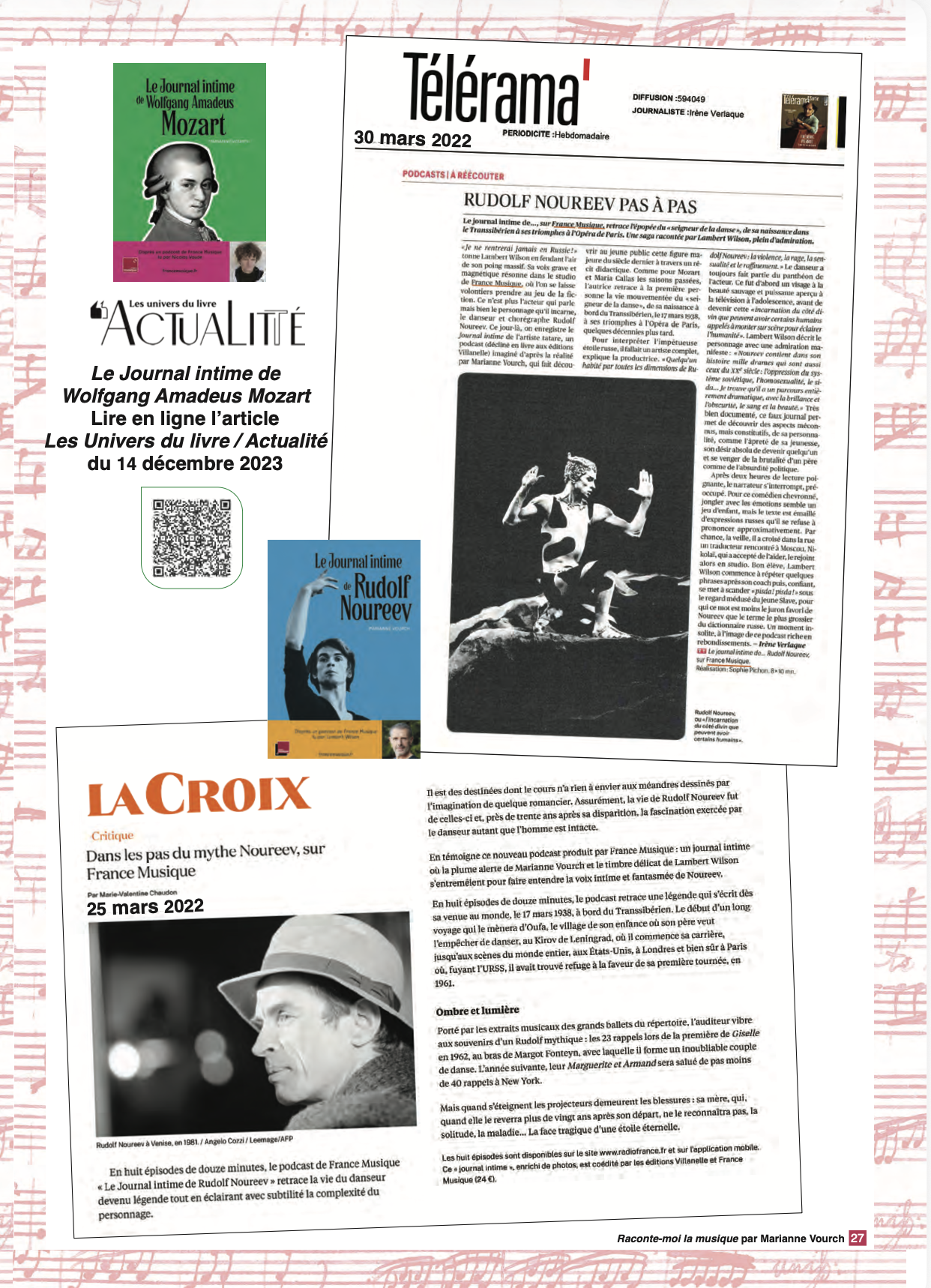


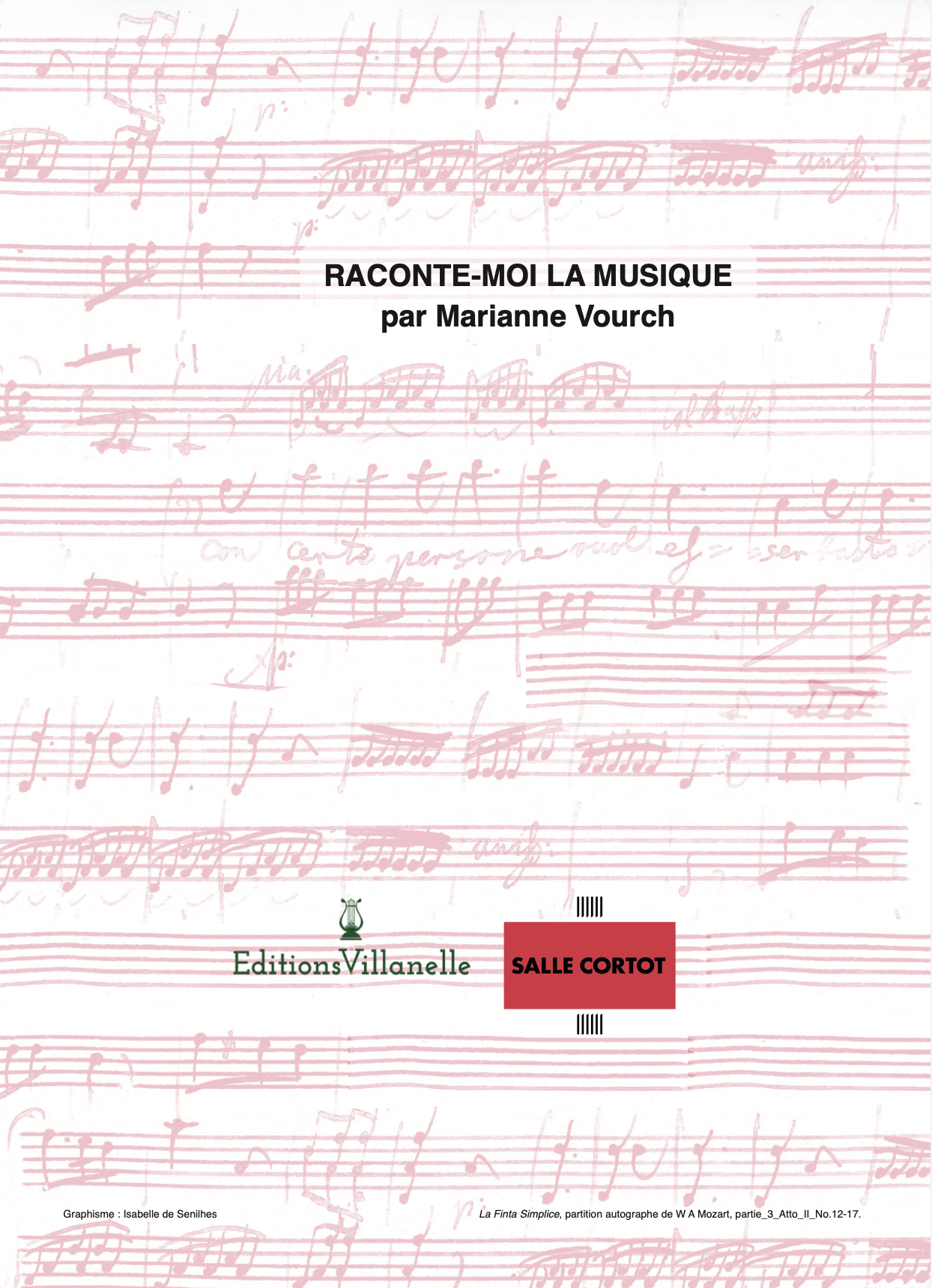

 Nathalie de Baudry d’Asson, une femme d’histoires
Nathalie de Baudry d’Asson, une femme d’histoires













