Prix du Palais littéraire 2009
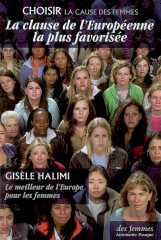
Guilaine Depis, attachée de presse (Balustrade)
Rampe de lancement ! Appuyez-vous sur la balustrade !
Prix du Palais littéraire 2009
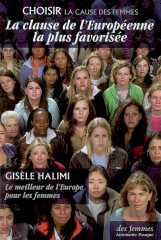
 Rien de telle qu’une femme cruelle. Je veux dire, rien de telle qu’une femme qui a le sens de la cruauté, c’est-à-dire, dans le cas de cette normalienne agrégée de philo, énarque et haut fonctionnaire, spécialiste des questions de sécurité et de géostratégie, le sens de l’écriture. Ecrire, c’est rendre la torture du réel. C’est écarquiller le regard jusqu’à l’indicible. C’est éviscérer l’âme comme c’est arracher un peu d’âme aux viscères. Tour à tour bourrelle, infirmière, amoureuse, justicière, mère sévère ou câline, Laurence Zordan a ouvert des horizons nouveaux dans la littérature française contemporaine. En quatre livres, elle s’est imposée comme une des figures de proue des Editions des Femmes d’Antoinette Fouque, en inventant un autre type d’écriture traumatique. L’ineffable, ça fait mal.
Rien de telle qu’une femme cruelle. Je veux dire, rien de telle qu’une femme qui a le sens de la cruauté, c’est-à-dire, dans le cas de cette normalienne agrégée de philo, énarque et haut fonctionnaire, spécialiste des questions de sécurité et de géostratégie, le sens de l’écriture. Ecrire, c’est rendre la torture du réel. C’est écarquiller le regard jusqu’à l’indicible. C’est éviscérer l’âme comme c’est arracher un peu d’âme aux viscères. Tour à tour bourrelle, infirmière, amoureuse, justicière, mère sévère ou câline, Laurence Zordan a ouvert des horizons nouveaux dans la littérature française contemporaine. En quatre livres, elle s’est imposée comme une des figures de proue des Editions des Femmes d’Antoinette Fouque, en inventant un autre type d’écriture traumatique. L’ineffable, ça fait mal.
Les yeux grands ouverts
On dit souvent de l’écriture féminine (au cas où celle-ci existerait, mais pour une fois jouons le jeu) que celle-ci échappe aux frontières de la raison et de la logique « masculines », qu’elle exprime une vision plus organique et plus infinitésimale des choses, qu’elle est plus sensible aux métamorphoses des êtres et des situations, qu’elle fonctionne selon un processus de rupture et de cassure qui remet en question l’espace-temps et qui donne au texte un aspect vague et flou où tout n’est plus que sensation, affection, prolifération de signes, au détriment des idées et des actions. Pour autant, le corps y est agressivement présent. L’obscénité apparaît comme la seule objectivité, la fameuse « hystérie féminine » se révélant comme le mal d’une écriture obligée de retrouver les mots et une syntaxe que le système phallocentrique lui interdit jusque là. Littérature du manque et de l’excès mais qui a la capacité de se détacher immédiatement des plaies qu’elle vient d’ouvrir – et qui saisit d’autant mieux. Prenez les scènes de torture de Des yeux pour mourir et avouez (avouez !) qu’un homme ne les aurait peut-être pas écrites comme cela.
« Ouvrez les yeux, parce que le torturé a les yeux parfaitement écarquillés. Les mouches le sentent. Un mets plus délicieux que le miel : des prunelles sans paupières, des prunelles sirupeuses dans lesquelles elles plongent leurs pattes, les crevant petit à petit, s’y enfonçant, s’y perdant goulûment. Un supplice pire qu’une énucléation.»
Un supplice surtout qui se décrit avec une précision qui ne s’excite jamais – et qui pourrait relever d’un barbarie blanche comme on parle d’une écriture blanche. Les hommes n’ont pas ces pudeurs devant un corps souffrant ou jouissant. Eux extériorisent, se mettent à rire, ou à baver. Eux donnent leur avis surtout. Dissertent comme les héros sadiens. Si Zordan est sadienne, alors elle l’est au sens de Clairwill, la « gouvernante » de Juliette. Il faut faire le mal, ou l’écrire, sans peine ni exubérance. Il faut mettre de la rigueur dans sa transe, tendre à l’apathie. C’est ce qui rend ses livres si effrayants. Zordan y traite de la guerre, de la torture, de la maladie, de la violence sociale, avec un sadisme dans la retenue qui fait froid dans l’âme. Dans ces scènes d’horreur, le texte tâtonne puis terrifie. L’on passe de l’obscurité la plus inquiétante et parfois, il faut le dire, la plus irritante à la limpidité la plus insoutenable. On est dans le clinique autant que dans le poétique. Dans l’onirique autant que dans le physiologique. Comme un nuage qui passerait devant la lune et un rasoir qui couperait un œil en deux.
Quoiqu’il s’agisse moins de couper que d’écarteler. Comme dans un film de Stanley Kubrick ou de Dario Argento, tout est œil écarquillé dans Des yeux pour mourir. Le narrateur qui est le bourreau ultime est celui qui vient arracher les paupières du patient avec une délicatesse abominable. Ne plus pouvoir fermer les yeux, c’est aussi cela l’enfer, disait un personnage de Huis-clos de Sartre. En même temps qu’il officie, le bourreau nous regarde droit dans les yeux. Comme dans Les Bienveillantes de Jonathan Littell (un livre écrit après Des yeux pour mourir), il y a dès la première page injonction au lecteur, regard-caméra comme on dit au cinéma :
« Je vais vous raconter l’histoire de mon regard, de mes paupières et de mon cristallin, et nous passerons un marché, en nous regardant face-à-face. »
Impossible pour le lecteur d’échapper à ce face-à-face.
 Histoire de l’oeil
Histoire de l’oeil
Afghanistan. Dans ce paysage de montagnes et de désert, sur lequel souffle un « vent de cent-vingt jours… », vent sadien s’il en est, un enfant va être initié aux cruautés de la vie afin qu’il devienne lui-même un jour un bourreau sans égal, c’est-à-dire un héros de guerre. Et la première cruauté, c’est l’arrachement à la mère avec laquelle il était retranché dans un « règne à part ». Ah les règnes à part d
e Laurence Zordan ! Les thébaïdes douloureuses ou joyeuses dans lesquelles mère et fille se retrouvent (Le traitement), à moins qu’ils ne s’agisse d’une mère sans fils et d’un fils sans mère, d’une sœur souveraine et d’un frère débile (A l’horizon d’un amour infini), ou d’une mère muette et d’une fille délinquante malgré elle (Blottie).
Enucléer le fils de la mère comme énucléer le sein de celle-ci devant celui-ci, c’est pour les hommes de guerre l’apprentissage de la « virilité ». Pour le petit garçon, l’instinct de mort se confondra désormais avec le lait maternel. C’est dans ces métaphores qui mélangent le doux à l’abominable, et dans ce cas-ci, le lactescent au sanguinolent, le nourricier au meurtrier, que réside l’art de Zordan.
« C’est pour cela que vous n’arrivez pas à concevoir la cruauté absolue qui ressemble à une montée laiteuse, à une communion nourricière », écrit le narrateur en se moquant du lecteur et de sa sensibilité « candide ».
Alors les paysages deviennent des blessures et les couchers de soleil des giclées de sang. C’est le temps des « classes ». Ne jamais fermer l’œil devant l’horreur (la chauve-souris brûlée vive). Distinguer l’indistinct (le chat blanc dans la neige). S’entraîner à ne pas fermer les yeux devant une bougie, afin de « maîtriser le jeu de [ses] paupières » et de « fortifier [ses] prunelles comme des muscles » – la suprême épreuve étant l’épreuve de l’eau bouillante que l’on renverse sur les yeux ouverts et qui gèle dans la seconde. Après ça, la mort règne au fond des yeux, et l’enfant est devenu un « tuant », un « résistant », et un moudjahidin qui pourra dire un jour :
« J’ai ôté des vies comme on enlève des échardes »,
et
« J’étais l’homme au poignard qui ne fait aucun bruit. »
Mais blessé, il est envoyé à l’hôpital où il tombe amoureux de la « chirurchienne » – une doctoresse singulière qui aime caresser les moignons des blessés. Le roman de guerre se fait roman d’amour. Le langage de la torture devient celui de la tendresse. Dans les deux cas, ça reste une question de corps.
« Mes gestes de guerrier étaient des gestes d’amant. Si mes cheveux gardaient la trace de l’ébouriffement de sa main, peut-être respirerais-je un jour l’odeur de sa chevelure sous le burqa. Une tiédeur de femme mûre, tandis qu’à ses yeux je demeurais désespérément cru, comme un fruit vert. Ma langue était un ensemble de papilles qui n’avaient pas su la goûter ; peut-être à mon insu, avais-je préféré la voir se perdre dans ses voiles plutôt que de me perdre dans son corps. Lorsque autrefois elle avait tenté d’entrouvrir mes paupières d’enfant, il y avait là une sorte de dépucelage par les yeux, comme si elle avait voulu décalotter mon sexe. Mais au lieu de m’abreuver de sa liqueur, elle m’avait mis du collyre. J’aurais tant voulu la boire ! (…) Elle m’avait dilaté la pupille, mais je m’étais promis qu’un jour mon regard dilaterait son vagin, que je crèverais cet œil maléfique qu’elle gardait entre ses cuisses ».
D’autres personnages surgissent : Sheitan, le disciple, Candy, la donzelle, et surtout l’espion Z… (Z comme Zordan) dont on apprendra que c’est lui qui est l’origine de la vocation du narrateur. Tout ce petit monde finit par coucher ensemble. L’on partouze dans la salle d’hôpital. L’on se torture aussi, pour rire, puis pour de bon, quand on apprend qu’un tel a trahi. Il y a des enculages et des paupières arrachées. Des aveux qui ne viennent pas et des caméras muettes qui filment les scènes. L’on pense à l’Histoire de l’œil de Georges Bataille autant qu’aux films d’horreur genre Saw. Vous vous êtes souvent demandés que pouvait être la sexualité en état de guerre ? Lisez Des yeux pour mourir, le premier roman de Laurence Zordan, et vous le saurez – en même temps que vous testerez votre tolérance à la littérature.
 L’essence mère-fille
L’essence mère-fille
« Toujours, j’ai aimé me promener avec ma mère – Voilà un début bien sage pour une histoire atroce. A moins que ce ne soit un début subversif pour une histoire banale. »
A moins encore que ce ne soit le banal qui soit atroce ou l’atroce qui soit subversif. Chez Laurence Zordan, les gestes les plus anodins sont des événements métaphysiques, les incidents les plus dérisoires sont des cataclysmes intérieurs. Faire une promenade avec sa mère malade est pour la fille un geste révolutionnaire que ne comprennent ni le médecin ni son entourage. Car cette petite marche à deux est pour la fille l’occasion de vivre avec sa mère dans
« ce tempo qui n’appartenait qu’à nous seules (…) parce que ce n’est pas un simple hasard génétique qui nous lie, mais la certitude que l’enfantement n’a fait que consacrer une connivence intemporelle, comme si de toute éternité j’avais pour raison d’être celle d’être la fille de cette femme, comme si cette femme ne tirait la justification de son existence que de m’avoir permis de voir le jour. »
Que raconte Le traitement ? Une fille qui s’occupe de sa mère malade. Et qui par là-même va retrouver « l’essence mère-fille ». Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? se demande Zordan de livre en livre. Eh bien parce qu’il y a des baisers ontologiques (A l’horizon d’un amour infini), des enfants à protéger (Blottie), des mères dont on devient la mère, l’infirmière et donc aussi le bourreau. Comme le petit garçon de Des yeux pour mourir, la fille devient cet « enfant soldat » qui ne va rien laisser passer des caprices et des faiblesses de sa mère et va lui infliger son « traitement » jusqu’à en être impitoyable – inhumaine par amour. Car les soins passent par les consignes, les menaces, les soupçons, la traque permanente. Soigner quelqu’un, c’est se battre contre lui nuit et jo
ur. Dans Des yeux pour mourir, on passait de la torture à l’amour, dans Le traitement, on passe de l’amour à la torture.
« De même que la guerre est une chose trop sérieuse pour être confiée à des militaires, la maladie est une chose trop complexe pour être confiée au malade. »
Pour la fille, le souci premier est que sa mère comprenne ce qui lui arrive et garde sinon sa sagesse, sa lucidité. C’est que l’esprit boiteux nous irrite plus que le corps boiteux, comme aurait dit Pascal, et que l’esprit boiteux, dans le cas d’une grande malade, peut conduire à la folie ou au désespoir. Bien penser sa maladie est encore un signe de santé.
« Je voudrais qu’elle raisonne. Même pas qu’elle soit raisonnable : tout simplement qu’elle raisonne. Qu’elle pratique enfin le principe du tiers exclu empêchant d’affirmer une chose et son contraire ; je voudrais qu’elle respecte non pas la vérité, mais l’évidence, lui imposant d’avouer qu’elle s’apprêtait à prendre le médicament que mon intrusion dans la chambre lui a fait tomber de la bouche ; je voudrais qu’elle veuille, non pas s’en sortir, comme y exhorte la sagesse populaire, mais qu’elle veuille vouloir pour exprimer enfin clairement un souhait. Or, son propos est toujours retors sans ruse, tordu plusieurs fois comme la soie retorse, pour ne déboucher que sur l’incompréhensible. Demander un verre d’eau ou une cuillère lui inspire des discours de contournement. Elle cultive la circonvolution des arguments tout en étant géostationnaire dans ses obsessions. »
C’est que la maladie rend rusé, et de la ruse du diable. Pour la fille qui s’occupe de sa mère, il s’agit de se prévenir sans relâche de la dialectique infernale de la douleur ou de la mort. Car il n’est pas sûr, comme elle finit par le dire, que « la douleur soit » seulement « le diable ». Il se pourrait hélas fort bien que la douleur soit aussi le signe diabolique de la vie. La douleur, c’est le diable, mais la douleur, c’est aussi la vie. Dans le cas des grands malades, rester en vie pour leur bien devient un contresens Alors, il faut faire fi de l’âme et ne se concentrer que sur le corps :
« Tout entière préoccupée par cette physiologie pathologique, je néglige volontairement l’âme, qui me semble un piège pour s’épargner la responsabilité de soigner. Les ressorts du psychisme et autres recoins secrets de l’inconscient me paraissent indûment invoqués pour masquer l’échec d’un protocole médical. Je refuse donc que ma mère ait une âme pour lui éviter d’être privée d’un organisme qui fonctionne, d’un corps réparé par la science. Je troque le spirituel contre le corporel. »
 La maladie mère-fille
La maladie mère-fille
Sacralisation du traitement.
« Je ne veux pas que ma mère introduise la moindre variante dans son traitement, sous peine d’écorner le sacré. »
Le rituel, c’est ce qui rassure, c’est ce qui fait de la vie, ici de la survie, une éternité. Comme l’enfant qui veut qu’on lui raconte tous les soirs la même histoire, la fille ne veut pas que sa mère change de soins. C’est la répétition des gestes qui protège. Et c’est la « normalité », qu’on méprise d’habitude, qui console – lorsque par exemple il faut, afin que la mère puisse manger, lui arracher les dents et lui mettre une prothèse, et ce faisant, avoir l’impression de revenir dans le monde normal, car « tout le monde, un jour ou l’autre, doit porter une prothèse dentaire ».
C’est la vie de tous les jours qui sauve de cette « mort » de tous les jours. C’est le dérisoire qui fait supporter l’essentiel. Pour la mère de A l’horizon d’un amour infini, l’important sera de toujours sentir bon au nom de son fils mort ou perdu depuis longtemps. Dans Le traitement, la fille va dans une quincaillerie acheter des casseroles émaillées pour une cuisine qu’elle et sa mère ne feront sans doute jamais mais « qui sonnent comme des cymbales de guérison ». Du corps de la mère au « corps » de la maison, il n’y a d’ailleurs qu’un pas que la pensée magique franchit allégrement.
« Il fait bon aller à la quincaillerie comme il ferait bon vivre dans la maison qui bénéficierait des objets qu’elle recèle. Je me prends à rêver d’un transfert de traitement : ce n’est plus l’organisme maternel qui obéirait aux médicaments, c’est la maison que l’on soignerait, en la stimulant par des pitons, crochets, rallonges de prises de courant, luminaires, rideaux plastifiés, serpillières jetées comme des compresses, thermomètres de réfrigérateur plutôt que courbe de température de la malade, glacière à pique-nique plutôt que mallette pour flacons de prise sang, couteaux à découper la volaille plutôt que seringue à ponction lombaire. »
Mais il faut revenir au chevet de la malade. Se refaire flic, douanier, ministre de l’intérieur de sa mère.
« Tels ces Africains repoussés dans le désert alors qu’ils avaient enduré mille souffrances pour atteindre l’Europe, ma mère est rejetée sans ménagement vers sa douleur. Le droit, les procédures sont de mon côté. Je ne la vois plus comme Maman, mais comme une clandestine qui tente d’exploiter la moindre brèche dans ma vigilance. »
La cruauté qu’il faut pour soigner quelqu’un. Le rapport de pouvoir qui s’instaure entre la fille et sa mère. « Je suis la sentinelle, elle est la Solitude », dit-elle un moment. L’Œdipe féminin qui se met en branle. Car la fille qui devient la mère de sa mère, donc sa grand-mère, rappelle aussi à sa mère qu’elle détestait la sienne.
« A m’imaginer sous les traits despotiques de sa génitrice – que, soit dit en passant, j’adore – elle a fini par me rendre semblable à elle. Modelant son comportement sur la stratégie de pouvoir qu’elle m’impute, ma mère m’a assigné le rôle qu’elle redoute. J’en deviens ce masqu
e antipathique qu’elle me fait revêtir et mon visage autoritaire riposte à ses attaques contre l’autorité. Sa manière d’attiser les flammes du caractère qu’elle me prête suscite ma propre réaction, nécessairement très ferme. Et parfois, j’envie ma grand-mère qui ne se privait pas de gifler ma mère. Je m’arrête dans cette violence fantasmatique en ressentant la tristesse de Maman d’avoir été si peu aimée. Je voudrais soudain tout effacer : l’attitude passée de ma grand-mère, ma conduite de garde-chiourme du traitement, je voudrais éradiquer cette férocité qui a sauté une génération pour s’acharner contre ma mère, prise en tenaille. »
L’hospitalisation est vécue comme un coup d’état. Et le retour, pour la fille, à la solitude. A la maison. Au fantasme d’un bal qu’elle donnera pour le retour de sa mère. Au conte de fée qu’est l’espérance. A l’écriture, enfin, la seule chose qui peut faire aimer sa douleur.
[Article paru dans Les carnets de la philosophie n°7 en avril 07]
Jeudi 18 juin à 19 h, Lectures de textes et inédits – (tout le monde est le bienvenu)
Rencontre Catherine Cusset et Camille Laurens à l’Espace des femmes-Antoinette Fouque (35 rue Jacob 75006 Paris)

Née à Paris en 1963, Catherine Cusset vit aux États-Unis depuis vingt ans. Ancienne élève de l’ENS et agrégée de lettres classiques, elle a écrit une thèse sur Sade et enseigné à Yale pendant douze ans. Elle habite aujourd’hui à New York avec son mari et sa fille et se consacre à l’écriture. Elle est l’auteur de neuf romans parus chez Gallimard entre 1990 et 2008, dont En toute innocence, Jouir, Le problème avec Jane (grand prix des lectrices de Elle 2000), La haine de la famille, Confessions d’une radine et Un brillant avenir (Prix Goncourt des lycéens 2008), et d’un récit au Mercure de France dans la collection Traits et portraits : New York. Journal d’un cycle (2009)

Agrégée de lettres modernes, Camille Laurens a longtemps enseigné au Maroc, où elle a délaissé sa thèse sur René Char pour se consacrer à l’écriture. Elle est l’auteur de sept romans, dont Dans ces bras-là (prix Fémina 2000), L’amour, roman (2004), Ni toi ni moi (2006), d’un récit autobiographique, Philippe (1995), et de plusieurs recueils consacrés à la langue française, notamment Le grain des mots (2004) et Tissé par mille (2008) . Elle termine un roman, à paraître en janvier 2010 chez Gallimard. Elle est traduite dans une trentaine de langues. Elle vit à Paris. Elle fait partie du jury du prix Femina.
Catherine Cusset et Camille Laurens liront des extraits de leurs oeuvres, et des passages de leurs romans en cours.

Sophie Marinopoulos 
Cette analyste, psychologue auprès de mères qui refusent leur maternité, est citée aujourd’hui par la défense au procès Courjault.
« Je ne savais pas qu’on pouvait attendre un enfant sans le savoir. »
Elle en a vu beaucoup échouer aux services des urgences pour «des douleurs au ventre»,ou«un kyste à l’ovaire», des femmes qui étaient sur le point d’accoucher, alors qu’elles ne se savaient pas enceintes. Dans ces cas-là, elle ne leur balance pas : «Vous allez avoir un bébé.». «Sinon elles explosent.» Elle choisit ses mots, les accompagne: «Il y a une grossesse.» Sophie Marinopoulos est psychanalyste, elle a travaillé comme psychologue pendant plus de vingt ans à la maternité du CHU de Nantes, auprès des mères «vulnérables », ou «défaillantes». Elle sera aujourd’hui à la barre, au procès d’assises de Véronique Courjault, accusée d’assassinat sur trois de ses bébés, entendue comme spécialiste à la demande de la défense. On la rencontre dans un café parisien, un après-midi. On aurait tout aussi bien pu la voir dans son hangar industriel réaménagé en nid familial, à Nantes, son port d’amarrage. Elle boit tranquillement un jus de citron. «On nous fait croire qu’avoir un enfant, c’est être parent», pose-t-elle. Toute sa pratique lui prouve que cela ne suffit pas. «Ces femmes m’ont troublée, je ne m’attendais pas à ça. Je ne savais pas qu’on pouvait attendre un enfant sans le savoir. J’ai vu des femmes aller jusqu’à maltraiter leur enfant, l’abandonner oule tuer et, en même temps, me renvoyer des images sociales proches de moi.» Ces femmes incertaines, chaotiques, mères en gestation, ne sont pas «des pauvres, des mineures, des alcooliques. Ça fait peur, confie-t-elle. Elles nous ressemblent».
Sophie Marinopoulos a «aimé les rencontrer dans leur intimité».Et leur ambivalence: «L’une me disait: “Je suis contre l’IVG, mais pour moi c’est pas pareil.”» Une autre abandonne son bébé à la naissance avant de devenir une mère adoptive, une troisième lui dit: «“Je ne peux pas être enceinte” tout en tendant ses échographies»… Elle les écoute sans les juger. «On a tous en nous une forme de non-sens», glisse-t-elle. Elle a une tendresse, peut-être inhabituelle chez un psy,pour ces femmes fragiles, «en souffrance», elle qui, le verbe solide et le regard rieur, ne semble pas vaciller. Dans les moments les plus durs, elle peut devenir «maternante». «On peut s’identifier à elles dans ces moments où elles sont comme des étrangères à elles-mêmes.» Elle en a fait plusieurs livres, dont un récit imaginaire, monologue haletant d’une mère meurtrière, entre les murs de sa prison. Elle l’a écrit à la première personne. Avec l’affaire Courjault, elle a pourtant l’impression que ces femmes sont «lynchées», à la merci de la «colère collective». «La société ne veut pas voir ça», affirme-t-elle. De même que les femmes font parfois un déni de grossesse (environ 2000 par an en France), la société fait «un déni du déni». Ces histoires viennent rappeler qu’on ne peut pas tout maîtriser, que la souffrance fait partie de la vie. D’autant plus difficile à admettre qu’elles ne collent pas à l’époque de la maternité bénie et triomphante. «Onest envahi d’images idéales de la maternité. Dès qu’on vous met un bébé dans les bras, il faut avoir le sourire accroché aux lèvres, le bonheur est obligatoire. Et on fait des cocoricos du matin au soir avec les chiffres de la natalité. Aujourd’hui “la femme”, c’est celle qui fait de beaux enfants.»
Sophie Marinopoulos en a quatre. Cocorico ? Elle a eu son premier enfant à 21 ans, avec son amoureux du lycée, devenu son mari «après la terminale». «J’étais fière d’avoir un enfant jeune, et très épanouie.» Elle s’agace d’entendre les couples trentenaires dire: «On ne peut pas sortir à cause des enfants.» Elle réplique : «J’adore sortir. Jamais les enfants ne m’en ont empêchée. C’est un équilibre de vie.» Dans un de ses livres, elle décrit une scène de la vie quotidienne, un couple au restaurant, un bébé victorieux de 18mois, installé entre eux sur une chaise haute qui grignote un quignon de pain et ses parents heureux de «se sentir repus en le voyant». Pourtant, elle-même ne raconte rien d’autre de sa vie que la mélodie du bonheur. «Ce n’est pas cui-cui les petits oiseaux, se défend-elle, ni bêtifiant, mais je ne peux pas témoigner d’autre chose.». On l’imagine ballottée : le jour, auprès de ces femmes chancelantes, mères cassées, le soir, avec ses enfants désirés et adorés. «Je réalise que j’ai de la chance de ne pas être traversée par les mêmes séismes. De ne pas avoir basculé. On peut tous basculer.» En 1992, toute la famille est partie pour un tour du monde des cinq continents. L’aîné avait 12 ans, la cadette, 8, et les deux derniers, des jumeaux issus d’une nouvelle union, 20 mois. «J’avais envie de faire la connaissance de mes enfants. De ne pas passer ma vie à les déposer à la crèche et à l’école.» Ils ont vécu en Nouvelle-Zélande, à Bali, au Costa Rica, en Nouvelle-Calédonie et ont fini par vivre «comme des pauvres aux Etats-Unis». En Polynésie, une femme lui a demandé si elle pouvait lui donner un de ses enfants. «Le don d’enfant est une pratique courante là-bas.On y est géniteur par nature, et parent par volonté. Ici, on est profondément attaché au lien biologique.» Quand elle est auditionnée, à l’Assemblée nationale ou à l’Académie de médecine dans le cadre de la révision des lois de bioéthique, elle pense à la Polynésie… Et aux autres façons d’être parent.
Cela ne la rend pas forcément très tolérante. Elle est sévère avec les mères sur le tard, «à 40 -45 ans, c’est difficile d’avoir un bébé, surtout par rapport à des rythmes d’adulte». Elle s’interroge sur «ces familles recomposées qui veulent à tout prix refaire famille en faisant un enfant, comme s’ils étaient incapables de penser un enfant hors des liens biologiques». Elle a du mal avec les «militants du désir». Respecte les demandes des couples homosexuels seulement si elle n’y décèle pas de «fantasme de l’auto-engendrement». Elle défend avec passion Freud et Dolto, qu’elle estime injustement attaqués. Mais elle se garde de trop théoriser et de dire le Bien ou le Mal du haut de son divan. Pour elle, un psy, c’est «un praticien, quelqu’un qui récolte des histoires de vie». Elle a monté un lieu d’accueil anonyme et sans rendez-vous, «Les pâtes au beurre»,où elle voit défiler des divorcés, des pères en pointillé, des mères seules, des parents qui ne comprennent pas leur enfant, qui sont malmenés, sans repères, mais jamais démissionnaires. Elle-même n’a pas connu de désordres familiaux. Son père, d’origine grecque, a vécu en Tunisie et a débarqué en France, tout jeune, comme appelé, pendant la guerre. Il n’avait jamais vu la France, s’est installé comme psychiatre et s’y est marié, avec une femme protestante très cultivée. Il n’a pas parlé grec avec ses enfants, Sophie et son frère, devenu pilote de ligne. Mais il a transmis à sa fille un nom et un physique de Méditerranéenne. Elle se dit «féministe» dans la lignée d’Antoinette Fouque, respectueuse voire accoucheuse de la différence des sexes. Elle sait appartenir à une «génération bénie», qui a eu une vie affective et sexuelle avec la pilule, et avant les ravages du sida. Quand elle aime un livre, elle le fait circuler. Elle a passé à ses enfants (aujourd’hui acteur, étudiants ou danseuse) la Nouvelle Petite Philosophie d’Albert Jacquard oule Liseur de Bernard Schlink. Et aimé le Premier jour du reste de ta vie, un film de Zabou Breitman. L’histoire ordinaire d’une famille.
•CHARLOTTE ROTMAN
Photo BRUNO CHAROY
***
Sophie Marinopoulos en 8 dates
4 février 1958 : Naissance à Paris.
1980 : Naissance de son premier enfant. Trois autres suivront.
1985 : Premier poste en maternité.
1992 : Tour du monde.
1996 : Premier livre : le Corps bavard (Fayard).
1999 : Ouverture du service de prévention «Les pâtes au beurre», à Nantes.
2008 : Auditionnée au procès Courjault, aux assises à Tours.

 » – Tout commence par l’assassinat de la marchande de glaces du Luxembourg…
» – Tout commence par l’assassinat de la marchande de glaces du Luxembourg…
– Mais enfin, jeune fille, il faut raison garder ; aucune histoire de l’Antoine ne peut commencer par un assassinat ; de si loin qu’Antoine subodore un cadavre, il se sauve les jambes autour du cou.
– Justement cette Marguerite, pour des raisons de son enfance, de glace à la poire, de sa mère disparue dans un accident de voiture quand il avait onze ans, il la connaissait très bien et il paraît que juste avant de mourir elle a prononcé son nom. »
P.J.
Pomme Jouffroy est chirugienne à l’hôpital Saint-Joseph à Paris. Elle a publié un essai Il n’y a plus d’hôpital au numéro que vous avez demandé… (Plon, 2002) puis plusieurs romans : Les Immortelles (Le Palmier, 2005), Rue de Rome et Res Nullius (Des femmes-Antoinette Fouque, 2006 et 2007). De la rhubarbe sous les pylônes est son premier roman policier.
Extrait d’un texte d’Antoinette Fouque, éditrice pionnière des livres audio :
 En 1980, j’ai eu envie de faire une « bibliothèque des voix ». A l’époque, il n’y en avait pas en France et très peu, non plus, ailleurs. Je voulais dédier ces premiers livres parlants à ma mère, fille d’émigrants, qui n’est jamais allée à l’école, et à ma fille qui se plaignait encore de ne pas arriver à lire, et à toutes celles qui entre interdit et inhibition ne trouvent ni le temps, ni la liberté de prendre un livre.
En 1980, j’ai eu envie de faire une « bibliothèque des voix ». A l’époque, il n’y en avait pas en France et très peu, non plus, ailleurs. Je voulais dédier ces premiers livres parlants à ma mère, fille d’émigrants, qui n’est jamais allée à l’école, et à ma fille qui se plaignait encore de ne pas arriver à lire, et à toutes celles qui entre interdit et inhibition ne trouvent ni le temps, ni la liberté de prendre un livre.
Je crois que par l’oreille on peut aller très loin… On n’a peut-être pas encore commencé à penser la voix. Une voix, c’est l’Orient du texte, son commencement. La lecture doit libérer, faire entendre la voix du texte -qui n’est pas la voix de l’auteur-, qui est sa voix matricielle, qui est dans lui comme dans les contes le génie est dans le flacon. Voix-génie, génitale, génitrice du texte. Elle y est encryptée dirait Derrida, prisonnière dirait Proust.
La « bibliothèque des voix » compte aujourd’hui plus de 100 titres. Sont ainsi regroupés les voix et les textes de Nathalie Sarraute, Marguerite Duras, Julien Gracq, Françoise Sagan, Marie Susini, Danielle Sallenave, Georges Duby, et Catherine Deneuve, Isabelle Adjani, Arielle Domsbale, Jean-Louis Trintignant, Nicole Garcia, Michel Piccoli, Marie-Christine Barrault, Anny Duperey, Daniel Mesguich, Fanny Ardent … prêtent leur voix à Madame de Lafayette, Diderot, Balzac, Colette, Proust, Freud ou Stefan Zweig…
Mardi 16 juin, sur l’idée d’Antoinette Fouque, son éditrice, Jean-Joseph Goux rencontrera ses lecteurs à l’Espace des femmes (35 rue Jacob 75006 Paris). La soirée portant essentiellement sur Mai 68 – le thème de « Renversements » (notre nouveauté philo) – commencera à 19 h. Venez nombreux…!


Philo – Libé des Livres jeudi 11 juin 2009
Par Robert Maggiori
Jean-Joseph Goux – Renversements
Des femmes-Antoinette Fouque, 266 pp., 15 euros
Le sous-titre du livre – « L’or, le père, le phallus, le langage » est plus intrigant que son titre. Si on ajoute que « la monnaie doit être conçue comme l’équivalent général des marchandises », la parole comme « l’équivalent général des signes », le père comme celui des sujets, et le phallus, au sens lacanien, comme celui des objets de pulsion, on peut entrevoir ce que Marx a fait au niveau de l’économie, est ici tenté sur le plan psychanalytique, sémiotique et anthropologique, la notion d’échange permettant de bâtir une théorie générale du symbolique.
Philosophe, professeur à l’Université de Rice, Jean-Joseph Goux n’établit pas simplement des homologies entre la monnaie, le langage, la sexuation (où se manifeste l’hégémonie ancestrale du masculin sur le féminin) et la structuration des sociétés. Il tente, en prenant appui sur le « moment volcanique de Mai 68 », de montrer l’institution symbolique et les « héritages » de la société occidentale.
 France 3 LES GRANDS DU RIRE
France 3 LES GRANDS DU RIRE
Heure : 14:33:09
Durée : 00:02:27
Présentateur : Yves LECOQ
SUJET : Emmanuel Pierrat, auteur du CD « Troublé de l’éveil » aux éditions Femmes est invité de l’émission. Itw de M. Pierrat qui explique que ce CD est inspiré de son livre.
Yves Lecoq, en compagnie de nombreux invités, nous offre un condensé d’humour. L’occasion de voir ou de revoir les sketches inoubliables des plus grands humoristes et de découvrir la nouvelle génération… Un cocktail à consommer sans modération au cours de chaque émission. Avec : Sheila, Michel Leeb, Jacques Séguéla, Jean-François Kahn, Eve Ruggieri, Nicoletta, Henry-Jean Servat, Karen Cheryl, Daniel Herzog
Flirter au Bon Marché lu par Michèle Goddet

Ce court recueil, orchestré par son traducteur, Jean Pavans (également celui des nouvelles de Henry James), rassemble quatorze textes inédits parmi les plus incisifs, et ceux qui illustrent le mieux le génie de Stein. Écrivain cubiste, elle nous donne là des textes audacieux et radicaux sur les peintres de son temps et l’art pictural. Et quand elle ausculte le monde contemporain, tout est observé, dit, jugé, saisi dans sa complexité, mis en musique par des mots toujours justes. Flirter au Bon Marché est une sorte de florilège du meilleur Stein et nous découvrons que dès les années 20, Gertrude Stein annonçait Sarraute et Duras. Un classique de notre temps.