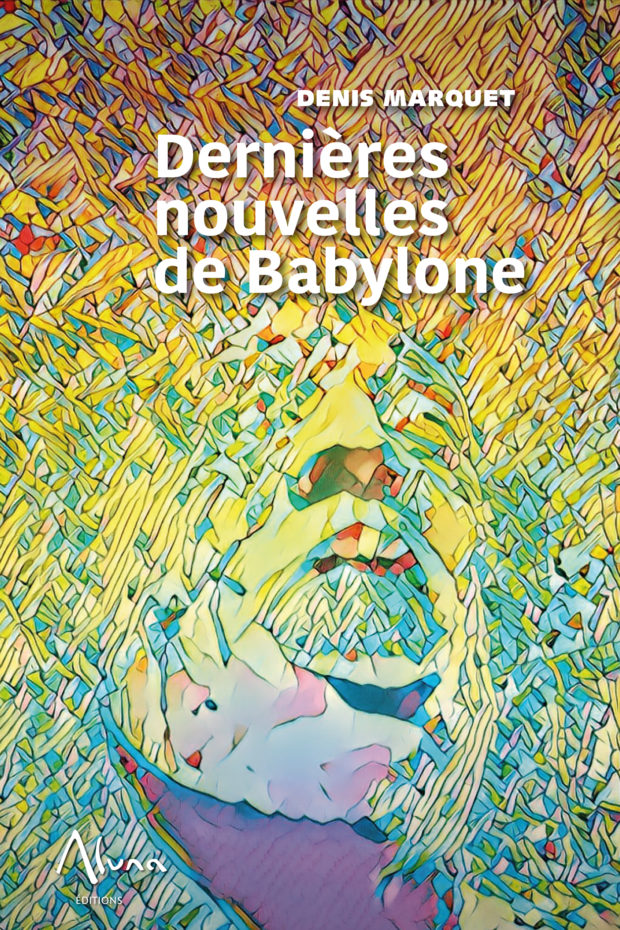 Denis Marquet publie Dernières nouvelles de Babylone, un recueil de vingt-deux récit présenté comme étant « une fable contemporaine orchestrée autour d’une galerie de personnages, chacun emblématique des impasses humaines de notre société ».
Denis Marquet publie Dernières nouvelles de Babylone, un recueil de vingt-deux récit présenté comme étant « une fable contemporaine orchestrée autour d’une galerie de personnages, chacun emblématique des impasses humaines de notre société ».
Vaste programme, pour ainsi dire, qui met à l’honneur le conte philosophique, un genre littéraire que l’auteur remet ici au goût du jour.
Vous êtes connu comme philosophe, thérapeute et romancier, vous accordez de l’importance au style et à la qualité de votre écriture. Et même si vous ne faites pas confiance au récit comme histoire d’une vie, pourriez-vous nous dire qui vous êtes et pourquoi vous vous définissez comme « un auteur inclassable » ?
Je ne me définis pas comme un auteur inclassable, ce qui serait encore une manière de me classer. Je n’aime pas me définir car l’auto-définition enferme dans une identité ; or, je crois que la créativité repose sur la capacité à toujours se laisser surprendre par soi-même, ce qui exige de renoncer à être identique à soi. Les récits sur soi sont un aspect important de la construction d’une personnalité mais, avec le temps, ils peuvent être lâchés, au profit d’une disponibilité aux élans profonds de notre être : la disponibilité du tout petit enfant, que nous avons perdue le plus souvent.
Ceci posé, j’ai constaté, il est vrai, que mes différents éditeurs avaient des difficultés à me placer dans des cases marketing. Après mon premier roman, Colère, un best-seller traduit en 8 langues, Albin Michel m’a considéré comme un auteur de thriller mais, dans ce roman, j’avais seulement voulu jouer avec les codes du thriller, pour délivrer un message à l’opposé de ce que dit le genre. Un thriller place en effet le personnage principal dans une situation où, pour survivre, il doit fuir ou se battre. Or, mon dispositif narratif (la terre se révolte contre l’homme) avait pour conséquence que la fuite était impossible et se battre une stratégie perdante ; ainsi fallait-il d’abord une mutation intérieure dont seuls quelques personnages étaient capables. Mon livre suivant, Père, était un roman à base autobiographique sur la naissance d’un homme à la paternité. De mon point de vue, il y avait une continuité thématique, notamment par rapport au thème qui m’est cher de l’initiation. Mais la forme était très différente et mon éditeur n’a plus su comment me vendre. Je comprends que, vu de l’extérieur, et surtout avec un point de vue commercial, ma démarche d’écrivain puisse dérouter ; d’autant plus que j’écris aussi bien des ouvrages philosophiques et spirituels que des romans — et à présent, avec Dernières nouvelles de Babylone, des nouvelles. Cependant, je perçois la cohérence profonde des 10 livres que j’ai publiés : tout s’articule autour d’un centre et j’espère que chacun de mes livres fait signe vers ce centre, cette unique chose indicible que tous mes livres essayent de dire.
En outre, comme vous le dites, j’attache de l’importance à l’écriture. Je fais mienne la maxime de Mark Twain : « la différence entre le mot juste et le mot presque juste est la même qu’entre l’éclair et le ver luisant ». Seule la justesse de chaque mot peut organiser l’ensemble du texte en une symphonie capable de toucher le lecteur en profondeur. Cela ne m’empêche pas, néanmoins d’adopter des styles très différents d’un livre à l’autre. Le style, pour moi, n’est pas l’expression d’une personnalité, encore moins d’une identité, le style n’est pas l’apanage de l’auteur : le style est celui d’un livre. Qu’ensuite on veuille bien me trouver un style, que l’on repère des constantes, un tour de main ou une singularité, je veux bien ; mais je ne le recherche pas.
Votre fréquentation de la philosophie et de la littérature sont deux pistes qui pourraient expliquer la préférence pour le récit court que vous avez choisi pour votre livre. Comment définir votre livre : un conte philosophique, une fable, une allégorie ?
En effet, mon livre est un recueil de récits courts, parfois très courts (certains font une seule phrase), qui mettent en scène un galerie de personnages emblématiques de ce que devient notre société, symbolisée par Babylone. La diversité des personnages s’articule donc autour d’un axe thématique que l’on peut qualifier de philosophique, mais au sens où la philosophie est d’abord l’art de questionner. Il n’y a aucune thèse ou théorie sous-jacente, mes personnages présentent des impasses, souvent, qui sont caractéristiques de ce que notre civilisation fait de l’être humain — et aussi des percées parfois qui ouvrent vers un espoir. Je crois en effet constater que notre société produit de plus en plus un homme déshumanisé, réduit au rang de consommateur pulsionnel, privé d’horizon et de sens, condamné à se divertir pour fuir son vide existentiel. Mais il ne peut fuir que toujours plus profond dans son impasse. Et il ne peut sortir de son impasse que par le haut. Chaque nouvelle questionne le lecteur dans les certitudes que le monde veut lui imposer, libre à lui d’aller aussi loin qu’il le souhaite dans l’inconfort du questionnement : il peut juste prendre plaisir aux histoires que je lui raconte.
Donc, un conte philosophique, oui, mais en ajoutant que mes personnages sont plus que des emblèmes ; mon projet était de les rendre vivants, personnels, attachants, favorisant l’identification. La dimension romanesque est également présente, et essentielle.
En lisant ces récits on sent votre délectation pour la narration, une vraie mise en valeur de l’expression littéraire à la fois comme invention et comme tableau multicolore de personnages les uns plus inattendus que les autres. Quel rapport entretenez-vous avec la fiction comme exercice de l’imaginaire et avec la joie d’inventer des personnages ?
Raconter une histoire, comme lire ou écouter une histoire, c’est d’abord retrouver le plaisir de l’enfance. Tout enfant aime les histoires. Aujourd’hui, on se plaint parfois que les enfants n’aiment plus lire mais, si on nourrit très tôt leur amour des histoires en leur en lisant ou racontant, ils iront ensuite les chercher où elles sont, y compris dans les livres ! Ensuite, lorsqu’on devient adulte (et c’est mon côté philosophe qui parle à présent), il est important de ne pas trop croire les histoires que l’on veut nous faire croire, pas plus que celles qui se racontent dans notre tête. Or le roman moderne, et Kundera l’a bien montré dans son Art du roman, met en scène le fait qu’il n’y a plus une vérité unique à laquelle tout le monde se référerait, un grand récit commun. Nous nous racontons donc chacun notre propre histoire en essayant de l’harmoniser tant bien que mal avec les histoires des autres… Le roman moderne, ainsi, raconte une histoire au second degré, au sens où son thème profond est toujours les histoires que l’on se raconte, et la multiplicité des récits personnels. A la limite, un personnage moderne est quelqu’un qui s’abuse de ses propres récits, et c’est ce que le roman met en scène.
Dans Dernières nouvelles de Babylone, derrière la diversité des histoires il y a, à chaque fois, une mise à distance, souvent comique, parfois plus sombre, des récits autour desquels un personnage a organisé sa survie. Mais un personnage doit aussi être aimé. J’aime qu’ils me surprennent, aient leur vie propre, comme j’imagine que Dieu, s’il existe, aime que ses créatures soient assez créatrices pour l’étonner. Quand cela arrive, c’est une grande joie ! Il m’arrive aussi de jouer avec la position du narrateur, de le mettre en scène de manière parfois un peu ironique. En effet, j’aime que le lecteur soit embarqué dans le récit, mais n’oublie jamais qu’on lui raconte une histoire. Nous ne pouvons pas vivre sans nous raconter d’histoire, mais nous ne sommes pas obligés d’y croire ! La dernière nouvelle du livre éclaire cette thématique, puisqu’elle commence par la phrase : « William venait de terminer son autobiographie, et il n’en croyait pas un mot ».
En parlant de vos personnages ce qui impressionne avant tout c’est leur diversité et leur capacité symbolique qui font d’eux de vrais caractères dans le sens classique du terme. D’où et comment les avez-vous choisi pour vous servir de modèles ?
Mes personnages, à l’exception des toutes dernières nouvelles qui offrent une perspective plus positive, ont pour point commun de représenter ou de donner à penser une impasse contemporaine. Notre société me semble en effet fabriquer un être humain qui n’est plus humainement viable. Chaque personnage est donc emblématique, ce qui lui donne en effet une dimension de caractère, au sens par exemple des caractères de La Bruyère. Mais mon désir était aussi de les rendre vivants. Il fallait donc éviter de les enfermer dans le symbole et les autoriser à exister : à ressentir, à agir, à créer, donc à me surprendre, à sortir de l’idée que je m’en faisais. Ils naissent en effet le plus souvent d’une idée, c’est-à-dire de mon regard de philosophe et de thérapeute sur ce qui enferme l’être humain contemporain dans sa souffrance existentielle. Mais ils finissent pas illustrer cette idée d’une manière pour moi inattendue. Je crois qu’un écrivain ne doit pas communiquer ce qu’il sait, mais plutôt apprendre et découvrir en écrivant. Il ne contrôle donc pas ses personnages, il s’agirait plutôt d’un dialogue où l’auteur se laisse aussi créer par le personnage.
De mon point de vue, un personnage naît toujours d’une situation conflictuelle qui le révèle par la manière dont il y réagit. C’est davantage le conflit premier dans lequel j’installe mon protagoniste qui illustre une idée et fera du personnage un caractère. Ensuite, les actions du personnage peuvent me surprendre, me le révéler par rapport par exemple à son passé, à la construction de sa personnalité. C’est cette relative autonomie du personnage qui, je crois, peut le rendre vivant.
Que doit-on entendre par Babylone dans le titre de votre livre ? Quel glissement sémantique y a-t-il entre le sens premier de ce toponyme et notre réalité contemporaine ?
Babylone est d’abord la capitale d’un royaume qui s’est acquis un empire important dans la première moitié du premier millénaire avant J-C. Il a notamment conquis le royaume de Juda, dont la capitale était Jérusalem. Babylone est ainsi devenue, dans la Bible, le symbole de la civilisation ennemie de Dieu. Lorsque saint Jean rédige son Apocalypse, Babylone est devenue un symbole négatif, associé à l’époque à l’empire romain, et désigne une société qui vit à l’opposé des lois divines. Saint Jean présente Babylone comme la « grande prostituée », la cité dont il faut se libérer intérieurement pour revenir à Dieu. Or, les traits par lesquels il la décrit ressemblent davantage à notre civilisation contemporaine qu’à l’empire romain ! C’est pourquoi j’ai choisi ce symbole pour décrire une civilisation à bout de souffle et qui cherche le Souffle (c’est le sens de l’image sur la couverture du livre). Nous vivons dans une société dont nous devons nous libérer pour accoucher d’un être humain viable, capable d’aimer, de créer et de vivre le sens.
Le titre Dernières nouvelles de Babylone joue à la fois avec le fait qu’il s’agit, si l’on veut, d’un recueil de nouvelles, et avec l’idée que je donne, dans ce livre, les nouvelles ultimes d’une civilisation qui touche à son terme. Je n’entends pas nécessairement par là un effondrement au sens des collapsologues, mais plutôt que l’être humain ne va pas pouvoir encore longtemps se cacher que cette société le déshumanise et étouffe ses potentialités les plus profondes. C’est aussi, par les voies humbles de la fiction, l’appel à un sursaut d’humanité.
Chacun de vos récits renvoie à l’introspection et à la quête personnelle et révèle l’être humain à lui-même comme un miroir. Quel rôle, quel sens accordez-vous à ce type de questionnement sur la nature de l’être humain dans votre livre ?
Nous vivons dans une société de consommation, c’est-à-dire une société qui a décidé de fabriquer un seul type humain : le consommateur — un être en qui la pulsion ne doit rencontrer aucun obstacle. La caractéristique de la Babylone moderne est donc d’absorber l’homme en direction de l’extérieur, vers des biens matériels dont l’accumulation et le renouvellement incessant ne peuvent en réalité le contenter. Cela génère une impasse humaine : un être humain toujours tendu vers un monde qui le sollicite sans cesse, un être humain qui ne sait donc plus ressentir, écouter, s’ouvrir au mystère de son être et à celui d’autrui. Dès lors, la clé me semble, d’une manière propre à chacun, d’inverser le mouvement et de retourner à l’intériorité. Mes personnages, à un moment de l’histoire, sont invités à ce mouvement. Certains s’y refusent et s’enferment dans leur impasse, et j’invite le lecteur à en rire ou en pleurer. Dans le dernier mouvement du recueil, d’autres y consentent, ouvrant vers un Souffle que, je crois, nous désirons profondément. Cependant, la dimension philosophique, ou « spirituelle », demeure en filigrane. Les personnages sont un miroir tendu au lecteur, un miroir dans lequel moi-même je peux facilement me reconnaître : je me suis souvent inspiré de mes propres impasses pour construire les situations dans lesquels ils sont plongés ! La fiction permet de poser des questions existentielles d’une manière qui s’adresse au cœur et aux tripes plus qu’à l’intellect, c’est son avantage par rapport à la philosophie.
La quête personnelle est en effet une thématique essentielle de ce livre. Nous cherchons tous à être heureux. Le progrès technique, la consommation, la richesse matérielle, s’ils facilitent la vie, n’ont rien à voir avec le bonheur. De mon point de vue, être heureux, c’est aimer et créer. La quête de soi n’est pas la recherche d’une nature qui serait commune à tous. Chacun de nous est unique, et nous désirons exprimer l’être unique que nous sommes (créer) et nous émerveiller de l’être unique qu’est autrui (aimer). Les impasses que je décris dans le livre sont autant d’obstacles à cela — que nous portons à l’intérieur de nous et dont nous pouvons, je crois, guérir.
Pour illustrer le contenu de votre recueil, permettez-moi, en conclusion, de vous inviter à nous parler d’un d’entre ces contes que je choisis ici par l’actualité de son sujet : « Bébé éprouvante [Chronique du dernier homme] ». Frédégonde et Orphéus, un couple aux prénoms bizarres, mais pas que, vont commander auprès du docteur Adéodat un enfant à la société Progéni. Ne satisfaisant pas leur idée préconçue d’enfant, les parents vont renoncer à Rika-Faustine, leur progéniture, portant malgré tout les qualités fixées par eux-mêmes. Que dit ce récit de notre société et quelle place occupe pour vous la problématique de l’humanité dans ce cas, mais également dans tous les autres contes que contient votre livre ?
Bébé éprouvante illustre ce que devient l’humain quand tout est devenu marchandise — y compris un nourrisson. Il s’agit d’un récit de légère anticipation (seconde moitié du XXIe siècle). Nous sommes dans un monde où la sexualité physique est tombée en désuétude, remplacée par un érotisme numérique et distanciel (les « éro-jeux senso-virtuels »), qui procure plus de satisfaction. Toute procréation est médicalement assistée, car les parents désirent une progéniture sans défaut : l’enfant est devenu un produit. Mais une marchandise n’est pas un autre, et l’on ne peut aimer qu’un autre. La mentalité de consommation nous pousse à ne plus chercher que des prolongements de nous-mêmes, des objets de satisfaction pour notre pulsion. Cela rend l’amour impossible. Les deux parents, même si leur réaction est différente, sont incapables d’aimer leur enfant précisément parce qu’ils en ont élaboré et commandé toutes les caractéristiques. Ce qu’on aime en l’autre, c’est le mystère qu’il est. La marchandisation de l’humain aboutit à ce que l’être humain est dépouillé de son mystère. A l’ère des sites de rencontre où l’on dresse un profil aussi précis que possible de la personne idéale, il est bon de se souvenir que le véritable amour porte sur un être qui nous échappe, qui est libre, différent de nous car unique comme nous. Le véritable amour porte sur autrui comme transcendance.
Comme vous le rappelez, la nouvelle est sous-titrée Chronique du dernier homme. C’est une expression de Nietzsche. Dans Ainsi parlait Zarathoustra, Nietzsche présente ainsi le dernier homme : « On aura son petit plaisir pour le jour et son petit plaisir pour la nuit ; mais on révérera la santé. “Nous avons inventé le bonheur”, diront les Derniers Hommes, en clignant de l’œil ». Le dernier homme est celui qui ne peut plus ni aimer, ni créer, ni désirer, celui qui « rapetisse toute chose » parce qu’il ne cherche que son petit plaisir pulsionnel de l’instant, et a perdu toute notion de dépassement de soi. Nous n’en sommes plus très loin, me semble-t-il. Mais je ne dis pas cela d’un point de vue pessimiste. Après le « dernier homme » peut venir l’Humain, un être qui bénéficie des acquis de la modernité, et notamment la liberté personnelle, et invente une nouvelle notion de cette transcendance que Babylone a détruite. Encore faut-il une prise de conscience, et un sursaut. J’espère y contribuer à mon niveau, mais elle viendra sans doute essentiellement des prochaines générations.
Propos recueillis par Dan Burcea
Denis Marquet, Dernières nouvelles de Babylone, Éditions Aluna, 2021, 186 pages.
 « 101 ANS MÉMÉ PART EN VADROUILLE » DE FIONA LAURIOL
« 101 ANS MÉMÉ PART EN VADROUILLE » DE FIONA LAURIOL








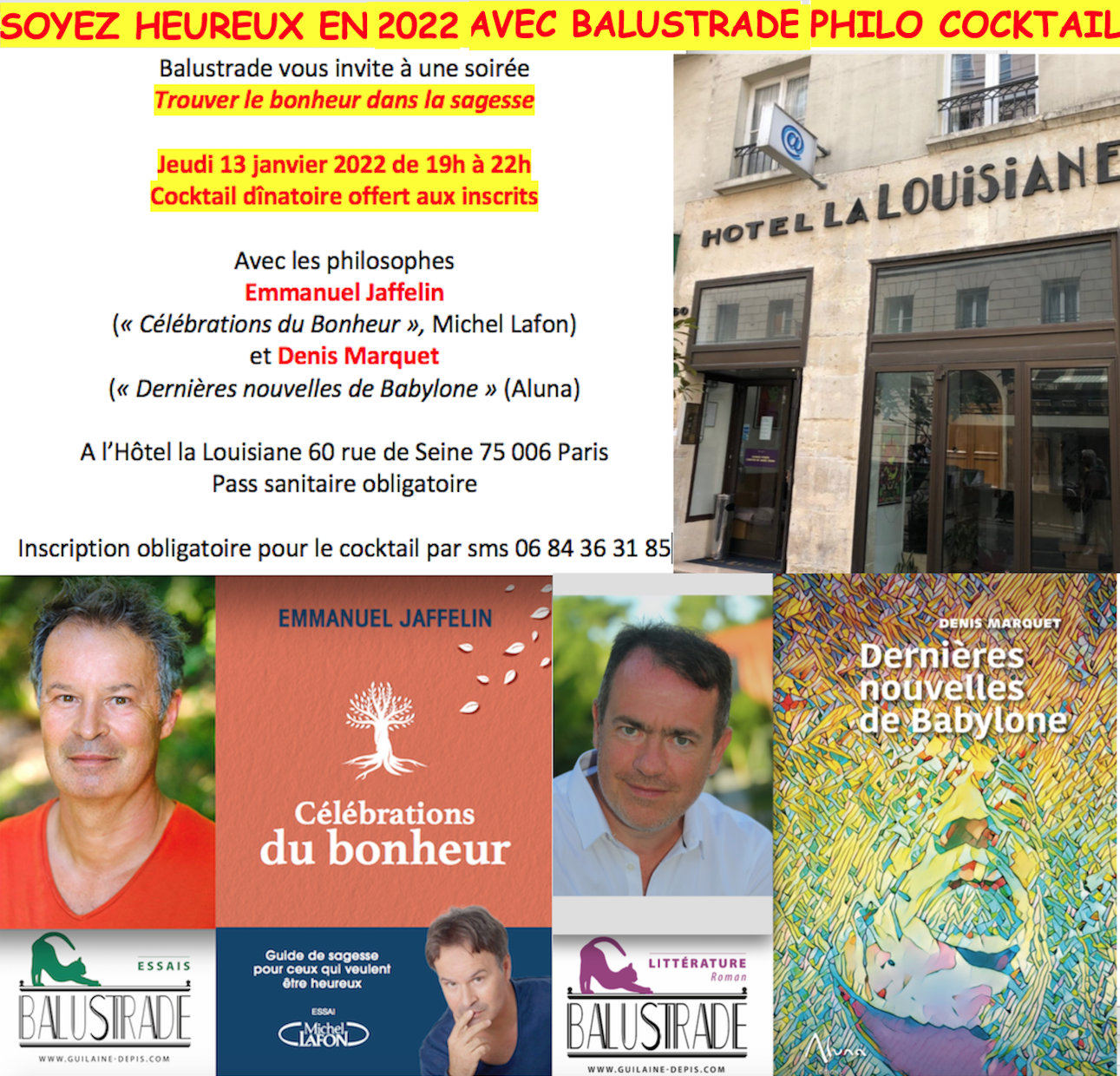


 Interview. Denis Marquet : « Chaque livre appelle sa propre écriture, car chaque livre est un appel vers l’unique »
Interview. Denis Marquet : « Chaque livre appelle sa propre écriture, car chaque livre est un appel vers l’unique »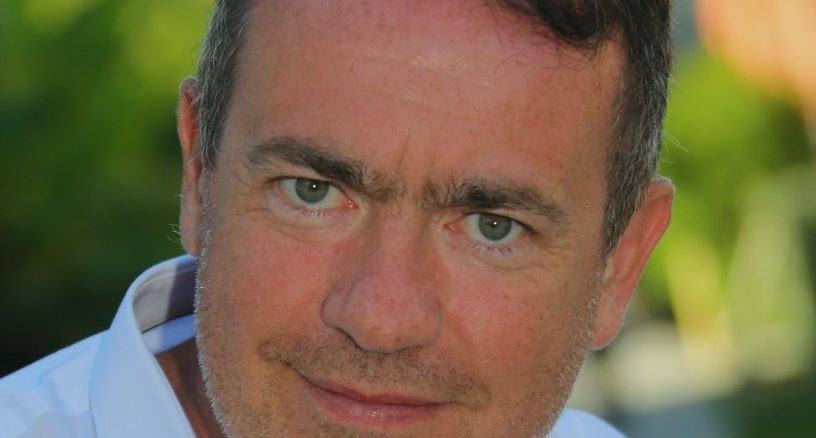
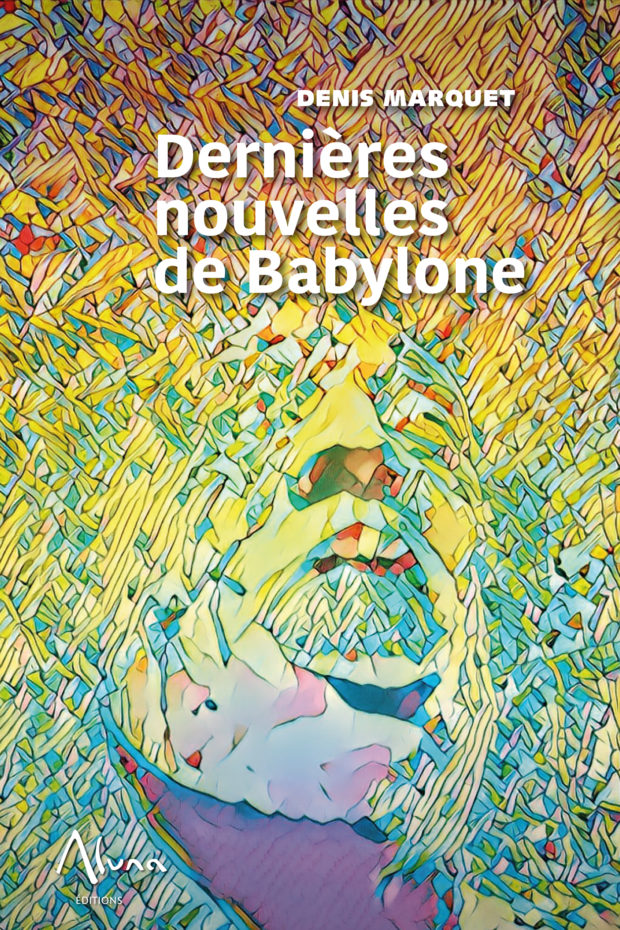 Denis Marquet publie Dernières nouvelles de Babylone, un recueil de vingt-deux récit présenté comme étant « une fable contemporaine orchestrée autour d’une galerie de personnages, chacun emblématique des impasses humaines de notre société ».
Denis Marquet publie Dernières nouvelles de Babylone, un recueil de vingt-deux récit présenté comme étant « une fable contemporaine orchestrée autour d’une galerie de personnages, chacun emblématique des impasses humaines de notre société ».