http://www.prison.eu.org/index.php3
http://www.prison.eu.org/article.php3?id_article=10074
 13 LE CHOC CARCÉRAL ET LES PREMIÈRES RUPTURES
13 LE CHOC CARCÉRAL ET LES PREMIÈRES RUPTURES
TROISIEME CHAPITRE :
LE « CHOC CARCERAL » ET LES PREMIERES RUPTURES
« Nous ne nous sommes pas quittés mais
[…] ils nous ont séparés. »
Eva FOREST, Journal et lettres de prison,
Paris, éditions des Femmes, 1976, p. 112.
Dans Les Romantiques (1964, 184), en grande partie autobiographique, le poète et écrivain turc, Nazim Hikmet, met en scène Eminé. Prisonnier, il risque de rester longtemps incarcéré et il implore sa jeune épouse, Nérimane, de « refaire » sa vie, se marier, avoir des enfants. Son propos fait écho à la dernière lettre à son épouse du résistant Missak Manouchian, du groupe Francs-Tireurs et Partisans – Main d’Œuvre Immigrée (F.T.P.-MOI), fusillé avec ses camarades le 23 février 1944. Aragon s’en inspira (« L’affiche rouge », Le Roman inachevé, 2002) et Léo Ferré la chanta : « Marie-toi sois heureuse et pense à moi souvent / Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses, / […] Ma Mélinée ô mon amour mon orpheline, / Et je te dis de vivre et d’avoir un enfant. » Près de deux siècles auparavant, les condamnés à la guillotine conseillaient, dans leurs dernières lettres à leurs proches, recueillies par Blanc (1984), d’éviter l’accablement.
En fait, se met souvent en place, dès l’incarcération, un discours qu’on explorera ultérieurement : « L’important, ce n’est pas pour moi, c’est le mal que ça fait à mes proches ». Il implique la minimisation de la souffrance causée par l’abandon des proches (« Il ne supporterait pas de venir au parloir, ») ou, à l’inverse, justifie une rupture volontaire (« Comme ça, ils souffrent moins »). Ce discours illustre l’éthique du « prendre sur soi » des personnes détenues (afin de préserver les proches) – une éthique du reste partagée par leurs proches.
A. L’ARRIVEE EN PRISON
La typologie de Chantraine (2004, 15) des rapports à l’incarcération propose cinq idéaux-types : « incarcération inéluctable » (aboutissement de la galère et de la répression routinière), « incarcération break » (arrêt d’une « dérive délictueuse » et/ou pause dans une « désorganisation interne »), « incarcération catastrophe » (rupture de la « normalité sociale »), « incarcération calculée » (passage assumé d’un mode de vie) et « incarcération protectrice » (fuite d’un dehors violent et/ou retour à un dedans intégrateur). Cette typologie permet de comprendre les parcours individuels. Elle éclaire donc notre objet, c’est-à-dire les histoires familiales : celles-ci s’écrivant avec celles-la.
1. La mise sous écrou et le « choc carcéral »
Redoutée ou pas, la prison est exceptionnellement parfaitement appréhendée par les individus qui n’y ont jamais été confrontés : l’incarcération est généralement un « choc », pour les détenus comme pour leurs proches. Certains disent l’avoir prévue, d’autres s’y être préparés… Mais aucun n’avait une juste appréciation de la vie carcérale et de ses conséquences. Il faut donc s’habituer à cet univers et à ses règles, qui sont sommairement expliquées par un livret remis aux arrivants (voir Annexes, doc. 2.a).
Des arrestations traumatisantes
Lors des entretiens, beaucoup de détenu(e)s ou de proches commencent spontanément leur témoignage par l’arrestation elle-même. Celle-ci marque l’irruption de la prison et du délit/crime dans la vie quotidienne et familiale. Par exemple, Brigitte (compagne de détenu) résume : « Pour moi, tout ça a commencé lorsque le Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (G.I.G.N.) a fait exploser ma porte à six heures du matin. » Beaucoup insistent sur le caractère traumatisant de l’arrestation pour les proches, en particulier pour les jeunes enfants et les parents âgés. À leur traumatisme, s’ajoute souvent l’humiliation d’être menotté devant eux ou devant des voisins, voire des collègues de travail. Le récit de Mohamed, détenu à la maison centrale de Clairvaux, est édifiant :
Le G.I.G.N. est venu chez moi, ils ont fait le grand jeu… Nous, quand on braque une banque, y a des psys pour les victimes, pour les familles, y a que dalle… La maison, elle a été complètement détruite…
L’arrestation, lorsqu’elle a lieu au domicile, est le premier (d’autres suivront) viol de l’intimité, comme le raconte Jena, incarcérée à la maison d’arrêt de Pau :
J’vais chez moi, et là, on m’ouvre la porte. C’était les gendarmes, en plus, il y avait des voisins à moi à l’intérieur… J’ai tapé ma crise. Ils ont fouillé le fin fond de mon intimité. Bonjour le respect ! En plus, mes voisins qui étaient là, ils connaissent rien à ma vie… Quand ils ont marché sur le carnet de santé des gosses, là, j’ai vraiment tapé ma crise, je leur ai gueulé dessus !
Du reste, la famille peut être « prise en otage » par le juge d’instruction ou la police lorsque la personne se soustrait à la Justice, c’est-à-dire lorsqu’elle est en « cavale ». Cela a été le cas de Fayçal (incarcéré au centre de détention de Bapaume) :
Y avait un mandat contre moi. Ils savaient que j’allais appeler chez moi, alors ils ont fait une descente chez moi, ils ont emmené dix-sept personnes au poste, même mes parents… Y avait toute ma famille, des amis qui vivent dans le même immeuble… Quand j’ai téléphoné, je me suis inquiété, j’ai téléphoné sur le portable de mon frère. Il m’a passé le commissaire, qui m’a dit de me rendre. Je voulais rien entendre, alors il m’a passé ma mère… J’ai dit : « C’est bon, j’arrive. » C’est comme ça qu’ils ont fait…
Les actes – et leurs motivations – qui amènent les personnes en prison sont d’une grande diversité. Mais, bizarrement, les récits de l’incarcération, par les détenu(e)s ou par leurs proches, ont beaucoup de similitudes, que l’acte s’inscrive dans une « carrière » délinquante ou qu’il arrive brutalement et accidentellement. Les premiers jours sont souvent marqués par un état de sidération, des symptômes de dépression (notamment l’amaigrissement), voire des tendances suicidaires. Beaucoup évoquent leur arrivée en prison par ses conséquences physiques. Ainsi, Guy, désormais incarcéré au centre de détention de Bapaume décrit :
Je suis rentré en prison à quarante ans. Quand je suis rentré en prison, j’ai eu peur pendant une semaine. C’est normal, j’avais l’image de la prison par les films américains ! En deux mois et demi, j’ai perdu quinze kilos !
Les « films américains » évoqués par Guy contribuent très souvent aux stéréotypes que les arrivants ont sur la prison. Les séries télévisuelles – souvent américaines, comme Oz (diffusée sur M6) – montrent d’ailleurs des conditions de détention qui ne peuvent être comparées avec celles des prisons françaises. Du reste, même dans les films « réalistes » français, les travestissements de la réalité sont fréquents (port d’uniforme par les détenus et usage d’un téléphone entre la personne incarcérée et son visiteur au parloir, par exemple). Ainsi, Jena (maison d’arrêt de Pau), ayant entendu parler des viols et de l’homosexualité dans les prisons d’hommes, était, au début de son incarcération, terrorisée :
On a peur quand on arrive ici. On m’a dit qu’il y avait des homos… Ça craint. Au début, j’étais dans une cellule avec une femme ho
mo. On m’avait dit de faire attention. Je me déshabillais pas devant elle, j’avais vachement peur.
L’idée selon laquelle les « sauvageons » ne seraient même plus effrayés par la prison, en plus d’être un poncif, est inexacte. Selon un lieu commun, véhiculé par les médias, la prison est l’étape finale d’un parcours délinquant et/ou judiciaire : le sentiment d’impunité (née de la commission de délits jamais condamnés) serait entretenu par le laxisme de la Justice (avec le préjugé de la non-exécution des « petites » peines). Familiers des admonestations par le juge pour enfants, des mesures de Travail d’Intérêt Général (TIG) ou de contrôle judiciaire, le jeune délinquant serait « déjà » inaccessible à la sanction carcérale. Or, selon Christie (2003, 49), si les « primaires » sont moins inquiets, c’est qu’ils sont ignorants. Les « sauvageons », si coutumiers de la Justice soient-il, ont sans doute davantage peur de la prison que ceux qui n’y ont jamais songé. Parmi ceux-ci, figurent notamment les personnes arrivées à un âge mûr, qui reconnaissent souvent qu’une expérience passée de vie en collectivité (armée, pensionnat, etc.) a atténué le choc.
Complétons ce tableau sur les conditions de l’arrivée en prison en évoquant le fait qu’il arrive que les proches soient témoins des faits et assistent, peu après, à l’arrestation. Cela a été le cas pour Jean-François, détenu à la maison d’arrêt des Baumettes :
Quand j’ai été arrêté la première fois, c’est à cause d’une fusillade que j’ai faite de l’appartement. Mes parents étaient là, ils m’ont vu me faire arrêter. Ça a du être dur pour eux de me voir arrêté. On en a reparlé une fois, mais vaguement.
Annoncer la détention
Excepté pour les mineurs, dont la famille est obligatoirement informée de l’incarcération par la direction de l’établissement, les détenus ont le choix d’avertir ou non leurs proches. Les proches ont d’ailleurs pu être prévenus lors du placement en garde à vue. À l’arrivée en prison, il est théoriquement possible de faire prévenir une personne de sa proche famille. Il arrive néanmoins que le service social, trop occupé [1], ne le fasse pas ou qu’il ne parvienne pas à le faire : par exemple lorsqu’il s’agit d’une personne dont la famille réside à l’étranger et/ou qui ne parle pas français. La famille peut alors être avertie par une lettre du détenu lui-même ou par un appel téléphonique d’un codétenu libéré ou d’un proche allé rendre visite à un codétenu et chargé de faire la commission.
Ils l’ont appris longtemps après… quatre ans après. C’est des amis qui leur ont dit que j’étais en prison, il m’avait connu en prison à Cayenne, et quand il est retourné au Surinam, il leur a dit. Ils avaient entendu que j’étais mort… Après, quand je suis arrivé en France, j’ai pu leur téléphoner… (Dennis, maison centrale de Clairvaux)
Le courrier est la première façon dont le détenu peut prendre contact, personnellement, avec ses proches. On pourrait croire que la première lettre est donc particulièrement difficile à écrire.
Il est vrai que les difficultés de certains à manier l’écriture font de ce courrier une vraie gageure, notamment lorsque s’ajoutent l’expression de sentiments complexes.
On a appris son incarcération par une lettre, mais je le connais, il a pas eu le courage d’écrire lui-même, il a demandé à son éducateur, il avait peur de notre réaction parce que c’est la deuxième fois, et quelque part, il nous a déçus… (Christine, mère de détenu)
La plupart des détenus racontent leur envie frénétique d’écrire à leurs proches lors des premiers jours d’incarcération, une frénésie souvent jamais ressentie auparavant. Du reste, la correspondance devient surtout difficile lorsque, par la suite, les personnes détenues ont l’impression de s’être installé dans la routine de la vie carcérale.
La première lettre, je l’ai écrite tout de suite. Résumer les deux jours de garde à vue… C’était pas dur à écrire, ça faisait du bien de se vider, j’avais besoin de m’exprimer. Comme j’avais rien pour écrire… Ça peut vous paraître bête, mais je n’avais pas de stylo, de papier, d’enveloppe… Eh bien, j’ai écrit sur une feuille de cantine verte, et puis j’ai trouvé un crayon… (Guy, centre de détention de Bapaume)
Cette première lettre est souvent impatiemment attendue par les proches. Monique Boiron, dont l’époux, André, avait, à 46 ans, déjà passé dix-huit ans en prison, raconte, dans Un foyer derrière les grilles (1995, 43), l’arrivée de son premier courrier après sa nouvelle arrestation, en 1989 :
J’ai ouvert sa première lettre avec fébrilité. Je n’avais pas communiqué avec lui depuis une éternité… La déception fut immense. André parlait presque uniquement des démêlés juridiques de son affaire, d’avocats, de jugement, établissait des pronostics sur sa peine. Tout juste semblait-il avoir pris conscience de la naissance de Damien.
La déception de Monique Boiron à la réception de ce premier courrier ressemble certainement à celle de beaucoup d’autres femmes. Comme la plupart des lettres envoyées de prison, celle qu’elle a reçue était remplie d’instructions.
Ma première lettre, c’était pour un collègue [« associé »] [2], mon meilleur ami. Le jour même je lui ai écrit… On vous donne tout ce qui faut le premier jour. Je lui ai écrit pour lui dire que je suis en prison, fais ceci pour moi, fais ça, ça va… C’est après que c’est dur d’écrire, car c’est toujours la même chanson… On voit les mêmes personnes, y a pas d’action… (Eric, maison d’arrêt des Baumettes)
Certains détenus désirent dissimuler leur incarcération à leurs proches ou à une partie d’entre eux. Les raisons invoquées sont l’âge – trop jeunes (les enfants) ou trop vieux (les ascendants) – ou l’état de santé. Cet argument est ainsi utilisé par Hocine, incarcéré à la maison d’arrêt de Pau :
Ma mère, mes deux frères, mes deux sœurs, ils ne le savent pas que je suis ici. J’ai peur que ma mère ne le supporte pas. Déjà, quand mes frères sont tombés, elle a failli mourir. Je préfère l’écarter de tout souci. Je veux pas lui faire de mal. Je lui téléphonerai quand je serai dehors, mais je lui dirai pas.
L’incarcération et ses motifs sont, surtout dans les premiers temps, souvent cachés aux enfants, avec la complicité du conjoint libre (voir Troisième partie, p. 204). En effet, les parents ne savent alors pas comment et quoi dire. Ainsi, Moktar (maison d’arrêt des Baumettes) raconte :
Je ne pense pas que mes enfants savent que je suis en prison… J’étais en Algérie, ils penseront que je suis resté plus longtemps. Ça m’arrivait de partir plusieurs mois… Je leur dirai s’ils insistent. Mais c’est entre moi et ma conscience. Je leur expliquerai pas tout… je leur dirais vaguement. On peut pas tout raconter à l’extérieur. Je ne suis pas un criminel, c’est que passager. Personne n’est parfait. Mais je pouvais pas expliquer, ça n’intéresse que moi. Celui qui veut des détails, il peut attendre.
2. Les réactions familiales à l’incarcération
Au début de l’incarcération, l’accaparement des proches par des démarches pratiques (dépôt de linge, demande de permis de visite, etc.) facilite paradoxalement la séparation. « Pour l’instant ça va, mais est-ce que je tiendrais jusqu’au bout ? » s’interroge ainsi une femme dont le conjoint vient d’être incarcéré. Pour les proches, l’annonce de l’incarcération s’accompagne souvent d’une blessure narcissique : « Comment a-t-il pu me faire ça ? A moi ? » Cette pensée peut déboucher sur deux réactions très différentes : une remise en cause personnelle (« j’ai raté quelque chose dans mon rôle de … ») ou le
questionnement sur leur relation (« s’il m’aimait, il n’aurait pas fait ça »).
Les réactions des personnes qui connaissaient les délits/crimes du détenu et/ou qui avaient choisi cette « vie-là » sont très éloignées de celles qui sont surprises par l’arrestation, l’incarcération et les faits reprochés. Nous avons mis en évidence quatre archétypes de réactions familiales à l’incarcération : le traumatisme de l’inimaginable, l’émotion de la mauvaise anticipation, le soulagement et l’indifférence (face à une incarcération inévitable et/ou routinière). Autant dire que la situation de Marie-Françoise (maison d’arrêt de Pau) est exceptionnelle, car elle a eu le temps, après sa condamnation, de se préparer et d’y préparer ses proches :
Il y a eu huit mois entre ma condamnation et mon incarcération. Ça a été un peu surréaliste… Un gendarme m’a téléphoné pour ma convocation d’incarcération. Je partais le lendemain en congé pour quinze jours. Il m’a dit de partir, mais que lui partait deux semaines plus tard… Bref, il m’a retéléphoné un mois plus tard. Il m’a dit qu’il m’attendait le lendemain, et que si je voulais, je pouvais laisser ma voiture sur le parking de la Gendarmerie. J’ai donc eu le temps de préparer ma famille à mon incarcération.
Le traumatisme de l’inimaginable
Pour beaucoup de personnes, l’incarcération d’un proche est, à proprement parler, inimaginable. D’abord parce que la prison est étrangère à leur univers social. Plus souvent encore, ce sont les faits incriminés qui troublent l’entourage du prévenu : soit ils ne peuvent même pas concevoir la commission de tels actes (« comment peut-on faire ça ? ») et ressentent une impression de radicale étrangeté à leur proche, soit les faits paraissent incompatibles avec la personnalité habituelle du prévenu (« comment mon père, si…, a-t-il pu faire ça ? »). Parfois, le choc ressenti est celui que provoque par Un ami insoupçonnable, pour reprendre le titre du livre du docteur Tersand (2000), à propos de Guy Georges. Dans d’autres cas, le crime a été commis sous le coup d’une passion ou d’une émotion violente. Simplement et brutalement, Georges (maison d’arrêt des Baumettes) raconte : « Un jour, j’ai perdu la tête, je l’ai tué. » Faouzi (maison centrale de Clairvaux) explique pour sa part : « Ben… Moi, je me suis réveillé un matin et j’ai fait une connerie, et je suis en prison. » Dans de nombreux cas, au choc de l’incarcération, s’ajoutent les conséquences de l’acte. Alors, comme l’écrit Marchetti (2001, 53) :
C’est sans doute l’homicide d’un proche et notamment des enfants qui engendre le plus de remords ; dans ce cas l’endeuilleur se retrouve aussi fréquemment endeuillé, et donc doublement susceptible de souffrir.
Lowenstein (1986) a enquêté auprès de 118 familles de prisonniers. Il a estimé que l’incarcération est particulièrement pénible pour les proches d’auteurs de délits financiers ou de délits/crimes à caractère sexuel. Effectivement, ces personnes n’avaient eu aucun contact avec la Justice auparavant. Le choc est d’autant plus brutal, notamment dans les villes de province, que la personne bénéficiait précédemment d’une situation sociale avantageuse, liée à sa profession (métier de maintien de l’ordre public, chef d’entreprise, profession libérale, etc.) ou à sa notabilité (élu local, responsable associatif, par exemple). Les témoignages que nous avons recueillis corroborent les observations de Lowenstein.
J’ai jamais pensé venir en prison… Vous voyez, votre question me fait sourire…Non, je l’imaginais pas, j’avais mes occupations, pour moi, ça a été la chute du haut de la falaise… Me retrouver de l’autre côté de la barrière. J’étais adjudant de Gendarmerie, j’étais comme on dit un ange de la route… (Jean-Luc, centre de détention de Caen)
Je ne pensais pas aller en prison. Je menais une vie d’honnête citoyen, mais pas de bon père complètement, par rapport à une de mes filles, la plus grande. Ça a été un drame terrible, épouvantable… En plus, je suis un ancien policier syndicaliste. C’est une tragédie, un drame épouvantable. Nous vivons un drame depuis cette époque-là. Je pense constamment à la souffrance des miens. (Raymond, maison d’arrêt de Pau)
L’incarcération peut être d’autant plus inimaginable que ses circonstances sont médiatisées : certains proches apprennent en effet par les médias, non seulement l’arrestation, mais ce qui est reproché à leur proche.
Elle ne l’a pas su tout de suite. Elle l’a appris malheureusement quand j’ai été arrêté. Elle l’a appris au J.T. [Journal Télévisé]. Pour elle, c’était la stupeur. (Frédéric, maison centrale de Clairvaux)
J’ai pas eu besoin d’expliquer à mon fils pourquoi je suis en prison… Les journaux s’en sont chargés. Et maintenant, y a même un livre… Il ne parle pas que de moi, mais une page ou deux… Mon fils, de toute façon, il m’a toujours connu en prison. On n’en a jamais parlé. (Serge, maison d’arrêt des Baumettes)
La surprise des proches (et éventuellement leur déception) s’explique souvent également par leur découverte des faits reprochés qui ne correspondent pas à ce qu’ils savent de la personne et/ou qui ne concordent pas avec son caractère. Fayçal, détenu au centre de détention de Bapaume, relate ainsi la réaction de sa famille :
Pour l’I.L.S.[Infraction à la Législation des Stupéfiants]. , ils sont tombés de haut… On n’en parle jamais. Si, des fois, ils me disent : « Mais où t’as caché l’argent ? » Parce que dehors, j’étais un rat, je leur donnais rien…
Il faut également noter que beaucoup de personnes incarcérées pour des délits/crimes sexuels ne comprennent pas leur arrestation : ils ne conçoivent tout simplement pas le caractère délictueux des faits qui leur sont reprochés. C’est notamment fréquemment le cas des pères poursuivis pour un inceste. Ainsi, l’un de ceux que nous avons interrogés nous demandait, perplexe : « Si vous aviez fait l’amour avec votre père, vous l’auriez dénoncé après ? » Plus fréquemment, dans les cas de délits/crimes à caractère sexuel, c’est la banalité (selon l’intéressé) des faits qui est soulignée par leur auteur, comme dans le cas de Gérard (maison d’arrêt de Pau), mis en détention préventive pour un viol :
Pour moi, c’est une connerie de troisième mi-temps… Vous voyez ce que je veux dire… Moi, il y a vingt ans, je faisais du rugby, j’ai fait des choses équivalentes, il ne m’est jamais rien arrivé !
La surprise de l’entourage naît souvent de son propre aveuglement, auquel s’ajoute l’habilité de la personne à avoir dissimulé ses problèmes et/ou son nouveau mode de vie. Ainsi, Nordine (centre de détention de Bapaume) raconte :
Ça a surpris tout le monde, j’avais jamais de problèmes, j’étais apprécié par tous. Ils sont tombés en larmes… Je sais pas ce qui m’a pris, ça a mal tourné et j’ai mangé douze ans. […] J’ai écrit tout de suite à ma famille, pour demander pardon.
Dans beaucoup de familles, l’incarcération est une surprise car elle ne concerne pas celui pour qui, unanimement, cette issue était redoutée, voire parfois attendue. C’était le cas pour Dominique, incarcéré au centre de détention de Bapaume, suite à un drame passionnel :
Tout le monde a été surpris, parce que dans la famille, avec mon frère A***, qui est plutôt chabraque [« remuant »], bagarreur, c’était plutôt lui qu’on se serait attendu qu’il aille en prison. Moi, personne s’y attendait, et j’dirais même qu’ils ont culpabilisé. Ils savaient pas que j’étais dans un état dépressif aussi grave… Le service social a prévenu mes soeurs, et une de mes filles l’a appris dans le journal… En garde à vue, j’étais pas moi-même, j’éta
is pas en l’état de penser à les prévenir.
 L’émotion et la mauvaise anticipation
L’émotion et la mauvaise anticipation
Certaines personnes s’attendent à connaître la prison, car ils ont choisi le « métier de voleur » et le mode de vie afférent. À moins d’être un as en la matière (et d’avoir de la chance), le banditisme implique inéluctablement l’incarcération : ce sont les « risques du métier », comme l’analyse Pascal, incarcéré à la maison centrale de Clairvaux :
Je ne suis pas un accidenté. Voleur, c’est mon métier. Quand j’ai été arrêté à vingt-sept ans, je connaissais les risques… La prison, c’est les risques du métier.
On ne peut pas aller plus loin que la prison.
Pour certains couples, la délinquance est donc choisie, ses risques (la prison, la mort, etc.) évalués et partagés. Les femmes mènent donc une vie de « femmes de voyou », avant de devenir des « femmes de détenu », ainsi que le raconte Jacques (maison d’arrêt des Baumettes) :
J’ai tout fait en parfaite osmose avec ma femme. Quand je partais sur une affaire, elle le savait […]. Je lui ai rien caché quand on s’est rencontré. Je me suis mis à table direct.
Le risque d’être arrêté/incarcéré, même lorsqu’il est connu, est souvent mal appréhendé : les détenus et leurs proches qui considéraient la prison comme inéluctable sont souvent surpris par leur propre désarroi. D’ailleurs, les « affranchis » disent, lorsqu’ils sont arrêtés, qu’ils « tombent » : n’est-ce pas éloquent du caractère finalement foncièrement imprévisible de l’incarcération ? En effet, elle peut se produire quand on ne s’y attend plus. De plus, une vie déviante n’implique pas forcément une juste anticipation de ses conséquences (« l’engrainage » [sic]) et notamment des risques encourus. Ainsi, partager sa vie avec une personne qui se prostitue suppose, si on est un tant soit peu lucide, se savoir susceptible d’être interpellé pour proxénétisme. Néanmoins, Gent, détenu à la maison centrale de Clairvaux, raconte benoîtement : « J’avais jamais pensé y aller… […] Je vivais avec une gonzesse qui faisait le trottoir. »
Le soulagement
Certains auteurs de délit/crime à caractère sexuel attendent, finalement avec impatience, leur interpellation, vécue avec soulagement. Une enquête auprès de délinquants sexuels a montré que l’arrestation était considérée comme un soulagement pour 38% d’entre eux (Ciavaldini, 2001, 84). Parmi les témoignages de nos interlocuteurs, celui de Stéphane, incarcéré au centre de détention de Caen, est éloquent :
J’attendais. D’ailleurs, je pense que c’est significatif de quelque chose, parce que lorsque j’ai été convoqué et que le policier m’a demandé si je savais pourquoi, j’ai répondu : « Oui, enfin. » De toute façon, j’avais mon sac dans la voiture, je savais où j’allais. J’avais réalisé avant d’être incarcéré.
Certains, même s’ils ne le reconnaissent que difficilement, voient la détention d’un proche comme une consolation, notamment ceux qui craignaient une issue fatale à une spirale dans la délinquance ou à un engagement politique (et militaire). C’est par exemple le cas de Philippe (maison centrale de Clairvaux), militant basque, vivant, à son incarcération, depuis sept ans dans la clandestinité : « Je pensais me faire tuer… J’ai trouvé super d’être en vie, alors, le reste, c’est du bonus. » Le soulagement des proches est mêlé de culpabilité. Ainsi, Hélène, compagne d’un détenu, dit avoir été « heureuse, parce que l’incertitude, c’était terminé » : « là, je savais ce que j’avais à faire, j’avais plus à me poser des questions, c’était plus simple d’une certaine façon. Même si je l’aurais jamais dit que j’étais soulagée, parce que ça aurait voulu dire que j’étais contente qu’il était en taule. » C’est une situation similaire, dans sa version « voyou », qu’expose Jean-Pierre (maison d’arrêt des Baumettes), dont les proches craignaient le décès lors d’un « coup », d’un « braquo » (« braquage ») :
Ils l’ont appris par le tapage médiatique… Oui, faut comprendre que je suis pas arrivé ici par accident. Donc, ils s’y attendaient. Mais pour eux, le pire, c’était que j’arrive dans un sac en plastique.
Beaucoup de proches de toxicomanes considèrent également la prison comme une issue préférable à la mort qui semble inexorable, l’incarcération venant donc briser une « spirale du pire » … même si elle enclenche souvent un « cercle vicieux », car la prison n’a jamais été un lieu thérapeutique :
Ma mère, c’est dur à dire, mais je suis sûr qu’elle était plutôt… pas contente que je sois en prison, non, ce serait trop fort… Mais déjà, elle s’y attendait, et puis elle savait que ce serait une petite peine… Elle a plus peur qu’il m’arrive du mal, avec des produits… (Hassan, ex-détenu)
Dehors, il y en a qui sont contents que je sois en prison. Ma belle-mère par exemple. Elle me l’a pas dit bien sûr, mais elle a toujours essayé de préserver le petit de moi, alors c’est sûr, elle préfère que je sois en prison… (Hocine, maison d’arrêt de Pau)
Derrière les propos de certains détenus, qui semblent entretenir des relations tyranniques avec les autres membres de leur famille, on devine que, pour les proches, l’incarcération peut être un soulagement. Deux extraits d’entretien nous paraissent particulièrement significatifs :
Au bout d’un mois que j’étais en taule, j’étais trop véner [énervé] parce que ma soeur m’avait pas apporté mes affaires. Elle s’est trop foutue de ma gueule ! Mais elle a vu comment ça s’est passé quand je suis ressorti ! (Hassan, ex-détenu)
Ma soeur, elle a rien fait quand j’étais au placard, rien… Ça, pour sortir avec un tel ou un tel, ça va… Pour toutes les fois où je l’ai aidée ! Elle sait très bien qu’il y a des choses, je pouvais pas le demander à ma mère, elle est trop fatiguée, et déjà, qu’elle vienne de temps en temps au parloir, c’était déjà beaucoup. Mais elle, elle pouvait apporter du linge. C’est facile… Tiens, quand je suis sorti, elle a tout de suite arrêté ses conneries… (Ahmed, ex-détenu)
La garde-à-vue, ainsi que le début de l’instruction, est souvent l’occasion pour les familles, comme pour les détenus, d’apprendre des faits, des événements passés, des éléments de l’histoire conjugale ou familiale qui avaient été cachés. Ainsi, Bertrand (maison d’arrêt de Pau) a appris pendant sa garde-à-vue que son épouse le trompait. En ce sens également, l’incarcération peut être un soulagement, car « tout devient clair ».
L’indifférence : l’inévitable et le routinier
« Quand je suis incarcéré ? Mes proches, ils sont blasés… » Les propos d’Hassan, déjà incarcéré à quatre reprises, révèlent un entourage habitué à la prison. Parce que les incarcérations sont devenues routinières ou parce que le comportement devait aboutir à la prison, les proches peuvent également exprimer une impression de routine, voire de la lassitude.
Certains détenus ont eu, par la famille ou plus généralement les proches, si ce n’est une « socialisation délinquante », au moins une familiarisation avec l’univers de la prison, qui fait de l’incarcération un événement possible. Ces personnes connaissent donc déjà certains usages de ce milieu.
Je suis arrivé en prison comme si j’allais à la boulangerie… J’avais des connaissances du quartier qui y étaient déjà allées. J’avais vaguement pensé y aller, mais je ne me rendais pas compte. Les deux premiers jours, j’ai rien compris… Après, c’est dur. (Je
an-Marc, maison d’arrêt de Pau)
La première fois, je ne me suis pas inquiété, et c’est ça qu’est grave pour les mecs comme nous qui grandissent dans les cités. Parce que pour moi, c’était une deuxième cité. Y avait que des gens que je connaissais. On retrouve toujours les mêmes, c’est un peu comme une carte de fidélité le placard. Tu grattes, t’as des points, jusqu’à ce qu’ils te lâchent parce que t’es plus tout jeune ! (Samir, centre de détention de Bapaume)
A dix-huit ans, bien sûr que j’savais qu’un jour j’irais en prison… parce que tous mes potes y étaient déjà, ils faisaient l’aller-retour. En plus, j’allais les voir sur la colline, à V***. Derrière la prison, y a un endroit pour faire des sortes de parloirs sauvages… En plus, quand je suis arrivé au placard, j’étais là pour une agression à deux francs… J’ai vu qu’les autres, au moins, ils s’étaient fait de l’argent, et ils allaient se prendre comme moi. Alors quand je suis sorti, j’ai vendu du shit. Et c’est ce qui m’a ramené en prison, l’I.L.S. La première fois, la maison d’arrêt, c’est un piège pour les jeunes comme nous. On rencontre tous nos potes, que des personnes que tu connais, t’as tous tes repères… (Fayçal, centre de détention de Bapaume)
Certains détenus (parfois auteurs des crimes les plus graves) constituent un vrai défi aux théories dites de la « rationalité de la peine » : passés à l’acte en toute connaissance de la peine encourue et certains d’y être condamnés, ils ont donc été insensibles à la fonction inhibitrice de la prison. Ainsi, Yannick (maison centrale de Clairvaux) a commis le crime pour lequel il purge une peine de réclusion à perpétuité lors d’une permission de sortir obtenue au cours d’une précédente peine de dix ans :
Bien sûr que je savais que j’allais aller en prison. Je ne suis pas un imbécile. C’était soit la morgue, soit la prison. Je savais ce qui m’attendait… Dans mon histoire, il n’y a rien de passionnel. Je savais que c’était la perpétuité. Mais pas au-delà ! [Il rit.] Le verdict, je me le suis donné d’avance… Mes proches ne connaissaient pas mes intentions, sinon ils ne m’auraient pas laissé sortir…
Les proches peuvent également ne pas se sentir concerné ou être indifférents à l’incarcération, car l’histoire familiale s’est écrite à partir d’expériences davantage déterminantes (un décès, une agression sexuelle, etc.). Il ne faut pas oublier que la prison est une unité théorique, née de l’intérêt du chercheur (on l’a vu par exemple avec les parcours toxicomaniaques : Devresse, 2004, 135-136). L’expression d’une continuité du vécu social dedans et dehors n’est pas rare, comme le trahit cette formule : « La zonzon, c’est comme dehors. » On retrouvera d’ailleurs ce discours à propos de la « misère sexuelle ».
3. La famille, au risque de la prison
Il existe deux préjugés opposés et tout aussi faux : l’un fait des proches de détenus des victimes, l’autre associe aux délinquants leurs familles. Celles-ci seraient, au pire, coupables (par association/complicité ou par contamination) et, au mieux, responsables. D’ailleurs, l’article 227-17 du Code pénal permet de sanctionner les parents pour les fautes de leurs enfants avec des peines allant jusqu’à la prison ferme.
Le lien entre famille dissociée et délinquance n’est pourtant pas établi. Wells et Rankin (1991, 1985) ont recensé les corrélations établies par une cinquantaine d’études depuis plus d’un demi-siècle. La mesure de cette relation varie de un à dix, essentiellement selon les présupposées, la méthodologie et les indicateurs utilisés. La corrélation entre famille dissociée et délinquance est faible ou nulle pour les délits graves (vols, comportements violents), un peu plus forte pour la consommation de drogues (surtout « douces ») et seulement significative pour les « comportements problématiques ». Or on sait que la définition de ceux-ci résulte de critères culturels. Ainsi, une étude, menée dans les années 1990, par le programme International Self Report Delinquency, indique que les « broken homes » sont liées à la consommation de drogues et aux « status offenses », non à la délinquance et à la criminalité (in Mucchielli, 2000). Hirshi (1969), puis Wells et Rankin (1985) et Von Voorhis et al. (1988), ont noté que la proportion d’enfants issus de familles dissociées est plus forte parmi ceux condamnés et/ou suivis par la Justice que parmi les mineurs qui déclarent des comportements délictueux dans les enquêtes de délinquance autorévélée. Cela traduit un double effet de stigmatisation : c’est d’une part la conséquence du préjugé selon lequel le parent seul serait moins capable d’élever correctement son enfant ; d’autre part, si les délinquants et les familles dissociées se retrouvent plus dans les classes populaires, établir un lien de cause à effet serait une erreur.
B. LES PROCHES FACE A LA PRISON
L’incarcération d’un proche implique l’apprentissage des nouvelles règles auxquelles les relations avec lui seront soumises. La plupart des établissements affichent des notes explicatives comme celle de la maison d’arrêt de Pau (voir Annexes, doc. 2.b). Il n’est en effet pas rare que certains ignorent la nécessité d’un permis de visite pour rencontrer la personne incarcérée, d’autres pensent qu’on peut, en permanence, la voir ou même lui téléphoner.
Parmi leurs premières impressions, les familles de détenus citent unanimement le mépris avec lequel les institutions, à commencer par l’Administration pénitentiaire, les traitent. Deane (1988, 48) insistait notamment sur le sentiment des proches d’être traités « comme des criminels ». Bénédicte, compagne de détenu, exprime cette sensation :
En France, les familles, quoique « privilégiées » (« Travail, Famille, Patrie », hein ?), ami(e)s et autres, c’est attention ! Danger pour la sécurité ! On fait chier d’exister, alors charité chrétienne et pays des droits de l’homme obligent, on nous donne des micro miettes de temps pour leur conscience et leur humanisme, et surtout pas de sexe, « pas de ça chez nous » ou alors juste un peu… Oui, mais, le colis de Noël, qui fait l’unanimité dans toutes les taules : « Merci, mon Dieu ! » [Elle rit.] On est ceux/celles en général qui rentrons le moins loin dans la détention, bon d’accord, ça permet à ceux et celles que l’on vient voir d’être près de la sortie !
Au début de l’incarcération (marquée par l’instruction, puis le procès), la famille se réorganise, les proches manifestent ou non leur solidarité. La désapprobation ou l’absence de soutien peut entraîner des séparations, notamment lorsque la belle-famille rejette la responsabilité sur la femme (Carlson, Cervera, 1991a). D’ailleurs, l’incarcération peut être un moyen pour la famille (en particulier la mère) de « récupérer » le détenu.
Cette période est particulièrement difficile pour le détenu car ses liens avec sa famille (et plus généralement ses proches) subissent un « moment de vérité » : les ruptures ont proportionnellement davantage lieu au début. Selon l’INSEE (2002, 43), plus d’une union sur dix serait rompue dans le mois qui suit l’incarcération. Ensuite, 20% le seraient au cours de la première année, 25% dans les deux premières années et 36% dans les cinq premières années.
Mais l’INSEE se déclare incompétente à déterminer si les comportements délictueux sont à l’origine ou, à l’inverse, le résultat des ruptures d’union. Si les proches rompent souvent relativement vite, avec le temps, les couples continuent à se séparer, nonobstant une diminution (en proportion) de la tendance. Une union a donc moins de risque de se rompre, après trois ans d’incarcération, pendant les deux prochaines années que durant le premier mois
d’incarcération. Le début de l’incarcération est donc généralement décrit comme le plus douloureux, concentrant la plupart des ruptures et des déceptions, comme le raconte Fayçal (centre de détention de Bapaume) : « Tu tombes de haut… Tout le monde te lâche… »
1. L’expérience de la séparation
Durant les premiers jours de l’incarcération, dans l’attente de la première lettre et du premier parloir, les détenus appréhendent généralement la façon dont leurs proches ont appris la nouvelle de leur détention. Ils ne savent souvent encore rien de comment leur entourage a vécu leur arrestation.
Pourvu qu’on ne lui dise rien ! Pas encore, oh, pas encore ! Le temps que tout s’arrange ! Pauvre Grand-mère ! Comment supporterait-elle un choc pareil ? Une honte pareille ? Sa gamine en prison ! Grand-mère, fragile des jambes, du coeur. La nouvelle pourrait la tuer. Une crise cardiaque, et j’en serais responsable ! Pourvu que ces imbéciles ne lui envoient pas un dossier officiel trop tôt ! (Saubin, 1991, 107)
Beaucoup de détenus se disent déconcertés par la solidarité de leurs proches, leur amour et leur confiance. Ils s’attendent à leur rejet, voire le sollicitent. Cette attitude est souvent interprétée par travailleurs sociaux, prompts au psychologisme, comme relevant d’une tendance masochiste. Elle relève plus certainement d’une réaction de protection : préférer quitter qu’être quitté. Ainsi, Jean, un prêtre incarcéré à la maison d’arrêt de Pau, raconte :
La congrégation a été très surprise. J’ai écrit à mes supérieurs pour leur dire que je me jugeais indigne de continuer à faire partie de la congrégation et donc pour m’exclure. Mais ils ont refusé, rien n’a été fait en ce sens.
Lorsque le détenu a déjà été confronté à la Justice dans le passé, les conséquences de son incarcération sur ses relations familiales sont parfois davantage angoissantes que pour un primaire. Il peut en effet craindre que la colère de ses proches, leur désapprobation, etc., surmontées jusqu’alors, ne soit, cette fois-ci, indépassables. Ce serait alors l’incarcération « de trop », celle entérinant une rupture.
Mes parents, ils ont changé. Là, je les ai tués avec ce qui m’arrive, c’est dur pour eux. La première fois, ça nous avait rendu plus fort, ça nous avait rapproché, surtout au début. Après, quand j’étais en C.D., loin, ça nous avait éloigné… Mais là, ça m’a encore plus éloigné d’eux. (Jean-François, maison d’arrêt des Baumettes)
Je croyais que ma famille voulait pas venir. Après, ils m’ont dit qu’ils allaient venir. J’ai failli refuser. Je savais pas quoi leur dire. Mon père me disait toujours : « Si tu vas en prison, tu n’es plus mon fils. » (Nadir, maison d’arrêt de Pau)
Nous l’avons observé durant notre activité de visiteuse de prison : les auteurs des crimes les plus graves préfèrent s’attendre au rejet. Généralement, ils disent « le pire », le moins écoutable, vite et brutalement. Si le bénévole ne part pas, s’il revient même, alors une relation peut s’instaurer et ils risquent peu d’être ensuite déçus, puisque le plus difficile, selon eux, a été surmonté. Ce type de comportement est souvent mal compris par les proches, qui peuvent penser, à l’instar d’Olivier (compagnon d’une détenue), qu’ils sont rejetés : « J’avais l’impression qu’elle voulait m’écoeurer pour que je ne vienne plus, comme si elle devait se manger sa connerie jusqu’au bout. »
La première lettre, j’y ai été franco. En cinq ou six lignes. J’ai mis le motif, la date… Mais j’ai mis du temps à me décider. J’ai eu une réponse dans la même semaine. Ça a été une surprise… Ça m’a réconforté. (Dominique, maison d’arrêt de Pau)
D’ailleurs, beaucoup de détenus se disent rassurés lorsque les proches expriment leur colère et/ou leur déception. C’est connu : rien n’est pire que l’indifférence. Souvent, ces discussions houleuses sont décrites comme permettant justement à la relation de continuer, comme le raconte Mikaël (incarcéré au centre de détention de Bapaume) : « Ma femme m’a passé un savon, surtout qu’elle ne savait pas tout. Mais on n’en parle pas trop. » D’ailleurs, dans certains cas, l’incarcération peut être l’occasion d’une réactivation des solidarités. Louise, une jeune « voyageuse » (manouche), incarcérée à la maison d’arrêt de Pau, craignait tout particulièrement l’abandon de ses proches, étant incarcérée suite à un infanticide :
Ma famille est encore plus proche. Maintenant, ils me font la bise, alors que ça se faisait jamais. Mon père, il me disait : « T’es la moins de toutes les filles. » C’est une expression… Maintenant, je me sens plus aimée. […] Je pensais qu’ils allaient même pas me voir. Tout le terrain, ils me passent le bonjour. Ils ont compris. Y a même une femme mariée qui va faire une demande de parloir.
D’une façon générale, les premiers temps de l’incarcération éclairent ce qui, pour la personne incarcérée, fait sens dans ses relations familiales : « Que je sois là, ce n’est pas grave, ce que je ne supporte pas, c’est que ma mère souffre à cause de moi », « je m’attendais à ce qu’ils me lâchent… », etc. Rapidement, s’esquisse une réorganisation des liens familiaux, comme le raconte Lucette, centre de détention de Bapaume : « J’ai été bien entourée. Dès le départ, mes proches étaient en colère contre mon ex-mari. Mon fils, il m’a dit : -J’en veux à Papa, pas à toi, Maman.- [Elle pleure] »
2. Le premier parloir
Les personnes rencontrées se souviennent généralement parfaitement du premier parloir. Celui-ci est souvent empreint d’une dureté, mêlée à une impression de soulagement. En effet, la visite marque une solidarité réelle, bien plus qu’un courrier ou même un mandat :
La première lettre, c’était très court. Je l’ai écrite après le premier parloir. C’était angoissant ce premier parloir. Je n’attendais rien, mais j’attendais beaucoup… si vous voyez ce que je veux dire. Ils ne m’ont pas jugé, c’était surtout : « Pourquoi tu nous as pas dit ? On aurait pu t’aider financièrement… » La plupart des gens l’ont appris par la presse. (Jean-Rémi, centre de détention de Caen)
Le premier parloir, oui je m’en souviens… […] La peur, surtout. La peur, c’est quelque chose, quand on entre en prison, qui ne vous quitte plus, elle est toujours présente. Alors, de ce premier parloir, je ne me souviens que de la peur. Parce que même si avec ma soeur, il y a les liens du sang, je me demandais quelle serait sa réaction. Même si on se rend compte du mal qu’on a fait, on a besoin de ce soutien, de cette présence. Moi, j’ai la chance que ma famille m’ait suivi. Mais je me posais la question de leur réaction par rapport aux faits, à l’incarcération… On a peur que la personne vienne pour dire qu’elle ne viendra plus. J’étais prêt à accepter n’importe quoi. Ma mère m’a giflé, mais c’était presque un soulagement. Ça ne voulait pas dire qu’elle me pardonnait, mais qu’elle restait ma mère. C’était sa punition à elle. Et ce geste-là fait moins mal que certaines paroles. (Alain, centre de détention de Caen)
Le soulagement est visible, même si peu de propos sont échangés lors du premier parloir, comme Louise (maison d’arrêt de Pau) nous le raconte : « Mon premier parloir avec ma mère, c’était très, très dur, il y avait trop d’émotions. On a fait que pleurer. J’ai pas desserré les dents. » Roselyne (centre de détention de Bapaume), incarcérée six ans auparavant, raconte :
Le premier parloir, c’était avec mon mari. Il a été prévenu par les services sociaux. Ça était un soulagement, mais c’était dur. Je savais que c’était pour des années. Il y a eu beaucoup de pleurs.
De plus, pour certain
s proches, la réalité découverte lors de l’incarcération d’un proche est tellement brutale que leur état est proche de la sidération. C’est par exemple le cas décrit par Frédéric, détenu à Clairvaux, lorsqu’il évoque son incarcération après une cavale durant laquelle il a rencontré, puis vécu avec sa compagne actuelle :
Elle est venue au parloir comme si rien ne s’était passé. Comme si de rien. Pour moi, c’était bien. De toute façon, je n’avais pas les réponses aux questions qu’elle aurait pu me poser… Lorsqu’on regagne sa liberté de la façon dont je l’ai regagnée [par une évasion], et que tout s’arrête, on repart à moins zéro… Il faut déployer beaucoup d’énergie. Et elle a compris ça. Elle a été présente. Sincèrement, je ne pensais plus à rien. Et quand j’y ai pensé, je me suis dit qu’elle ne pourrait qu’être là. Parce que pendant ce temps regagné, c’était intense. Après, on a reparlé…
Dans le contexte du parloir – auquel les uns et les autres doivent s’habituer -encore sous le « choc » de l’incarcération, il est souvent difficile au nouveau détenu de s’exprimer.
Mon père, il est d’abord venu tout seul au parloir. Il voulait parler avec moi, rien que lui et moi. Il voulait des explications. Non, j’arrive pas à lui expliquer. Il me pose des questions. (Nadir, maison d’arrêt de Pau)
Les conditions concrètes de la visite, notamment sa brièveté et souvent la présence simultanée de plusieurs membres de la famille, empêchent souvent de réelles discussions et explications lors de ce premier parloir :
Mon premier parloir, c’était avec mon père, ma mère, ma soeur. C’était très chaud entre mon père et ma mère. Ils s’engueulaient… Ma mère accusait la famille de mon père… J’étais content d’avoir remué toute la merde ! (Cédric, centre de détention de Caen)
J’ai eu mon premier parloir après un mois, un mois et demi… On n’avait pas notre intimité. Sur le plan du couple, j’aurais souhaité qu’on soit tous les deux, mais il y avait tout le temps mes parents ou ma fille. (Jean-Luc, centre de détention de Caen)
Lors de ce premier parloir, la plupart des détenus veulent absolument (y compris malgré l’apparence flagrante du contraire) rassurer leurs proches. Ce souci de faire « bonne figure » est également partagé par les proches. On voit finalement moins de larmes dans les parloirs qu’à leur entrée ou à leur sortie.
Mes grands parents sont venus un mois après. C’est la première fois que mon grand-père pleurait. Je n’ai pas voulu pleurer pour ne pas leur faire du mal, mais j’ai craqué ensuite en cellule. (Valéry, centre de détention de Bapaume)
Mon premier parloir, ma mère est venue seule, elle m’a dit : « Ça te fait rire ? » Pour elle, c’était dur. Je lui ai montré que ça va, pour la rassurer. (Mikaël, centre de détention de Bapaume)
Plus rarement, ce premier parloir est l’occasion de renouer avec des personnes. Ainsi, Quentin (détenu à Caen), qui n’entretenait plus de relations avec sa mère, raconte :
Mais quand je l’ai vu, j’étais content, parce qu’on était fâché depuis deux ans… Alors ça m’a soulagé de la voir, parce que je pensais pas qu’elle allait venir. C’était parti en crabe [« mal parti »].
Dans des cas où le délit/crime est expliqué par la personne détenue comme une volonté de s’opposer à la famille, certains prisonniers expriment franchement leur plaisir (sadique ?) à voir leur proche venir au parloir :
Je crois pas que ça me faisait mal de les voir là, parce que pour moi, c’était plus comme une vengeance, comme pour leur faire du mal. Mais ça, je l’ai compris plus tard. (Pierre, maison centrale de Clairvaux)
Mon premier parloir, c’était avec ma mère, quelques semaines après mon arrestation… Bien sûr que je m’en souviens… Ma mère pleurait, et moi, ça me faisait rigoler. […] Ce qui me faisait rigoler ? Pour comprendre, il faut que je vous dise que ma mère est une femme très dure, alors, de la voir pleurer, je la voyais un peu petite… Ce qui me faisait rire, c’était de voir une femme qui pleure la douleur de son fils. (Marc, centre de détention de Bapaume)
C. L’EPREUVE DU PROCES
Le procès fait partie des moments décrits comme une épreuve par les détenus : d’après Fishman (1981), il serait aussi traumatisant que l’incarcération. La médiatisation de certaines affaires est particulièrement redoutable pour la cohésion familiale et difficile à vivre pour les personnes concernées [3]. D’ailleurs, les juges et la presse (bien plus que les policiers et les surveillants) suscitent parfois de durables sentiments de haine et furieux désirs – fantasmatiques – de vengeance. Jean-Rémi (centre de détention de Caen), dont l’histoire a d’ores et déjà inspiré un livre et un film, affirme nettement : « Le procès a été la semaine la plus dure en dix-neuf ans de prison. » La publicité des débats n’est pas étrangère au sentiment de honte souvent évoqué par les détenus, comme l’exprime Cédric (centre de détention de Caen) :
À mon procès, ma mère et mon amie de l’époque sont venues témoigner. Mais elles ne sont pas restées. C’est délicat, c’est gênant, c’est la honte pour une mère de voir son fils aux Assises, surtout pour ce que j’avais fait.
La médiatisation est d’autant plus cruellement ressentie par le détenu que le délit/crime, notamment s’il a un caractère sexuel, est stigmatisé. Ainsi, Christian, ancien détenu, raconte :
Pour ma famille, ça était très dur, mon arrestation et après le procès. La presse m’a descendu, ils disaient que j’étais un monstre. Aux Assises, c’était terrible aussi. Ma mère, elle a vieilli d’un coup…
Même lorsque la personne dit n’avoir pas honte de ses actes, voire en tire une certaine fierté (en particulier lorsqu’il s’agit d’actes politiques ou de grand banditisme), le procès est, par nature, humiliant. Frédéric, aujourd’hui incarcéré à la maison centrale de Clairvaux, et qui avait rencontré sa compagne pendant sa cavale, raconte ainsi :
Elle a été présente à tous mes procès. J’aurais préféré qu’elle ne soit pas là. C’était inutile. De voir un homme menotté, avec les entraves, dont on véhicule une certaine imagine de dangerosité, c’est pas beau à voir…
L’instruction, puis le procès (notamment au moment des témoignages), peuvent faire émerger des divisions au sein de la famille. Lorsque le procès doit juger un délit/crime commis sur une personne de la famille, le risque de cristallisation de conflits est évidemment encore supérieur. Ainsi, Louise, une jeune femme, incarcérée suite à un infanticide commis sur un enfant né d’une relation avec un proche, appréhende particulièrement son jugement :
C’était un homme de la famille. J’ai plus de contact. Il est parti. Mes parents étaient pas au courant, sinon, je serais pas ici. J’ai pas envie de le revoir, mais il va peut-être venir au procès. C’est ça que j’ai peur. Je voudrais pas le voir.
Lors du procès, les proches doivent décider de témoigner ou non en faveur de l’accusé. Or le fait que ses proches se désolidarisent est souvent plus blessant pour la personne jugée que n’importe quelle attitude malveillante de la famille des victimes. On accepte davantage d’être offensé par ceux qui nous sont, a priori, hostiles que d’être déçu par ceux qui sont supposés nous aimer. Ainsi, Patrice, incarcéré à Bapaume, relate :
Les familles des victimes, elles m’ont pardonné. Elles me l’ont même dit au procès… Mais ma famille, elle est venue témoigner contre moi. […] Au procès, en appel, juste avec le regard, je vais leur faire peur. J’ai fait du satanisme, j’ai appris la haine. Moi, je peux pousser quelqu’un au suicide rien qu’en regardant sa photo. Moi, j’ai adoré Satan, et pour s’en sor
tir, c’est pas facile, c’est comme une spirale, alors…
On a parfois l’impression que le procès est, pour certains détenus, l’occasion de se venger, publiquement, de leur famille. On surprend même, croyons-nous, dans les propos de Ronan (maison centrale de Clairvaux), une certaine délectation de l’embarras qu’a causé, à ses proches, son jugement :
Ma famille a eu très mal à mon procès, en particulier à cause de mes
déclarations. J’ai revendiqué mon crime. J’ai dit que je tenais à personne, et je l’ai dit très crûment. Ils s’en doutaient, en plus je leur avais déjà dit, mais là, de se s’entendre dire devant tout le monde… Ils se sont beaucoup remis en question sur mon éducation. Oui… parce que j’ai tué pour voir ce que ça faisait. Et ce qui s’est passé, c’était inimaginable pour eux.
L’histoire familiale s’écrit et se réécrit lors des procès. En effet, ceux-ci sont parfois l’occasion, pour les condamnés, d’apprendre des détails, jusqu’alors cachés, de leur vie familiale : des incestes, des violences, etc. Autant dire qu’on se découvre rarement, dans les salles des tribunaux, un « oncle d’Amérique ». Ainsi, Jean-Rémi, détenu au centre de détention de Caen, a appris les circonstances de son abandon très précoce. Lors de son procès, c’est toute son histoire familiale que Jean-François (maison d’arrêt des Baumettes) a découvert :
Mes parents étaient à mon procès, pour me soutenir et pour me témoigner. Mais ce qui a été dur, c’est que j’ai appris des choses… Les histoires de ma mère avec sa mère… Apparemment, y a eu des actes de barbarie… Moi, je croyais que ma mère était orpheline… Tout cela, je l’ai appris aux Assises. Même maintenant, d’y repenser, c’est dur. J’aurais préféré ne pas le savoir. Ça était plus dur que les dix ans que je me suis pris.
La publicité des débats peut permettre aux proches d’exprimer, par leur présence, leur solidarité. Beaucoup d’ailleurs nous ont dit leur déception que l’intéressé ne la remarque pas, trop absorbé par l’enjeu de l’audience. Toutefois, pour les personnes accusées des crimes les plus graves, rien (même la présence de leurs proches) se semble susceptible de les soutenir dans cette épreuve, comme le raconte Sonia (maison d’arrêt de Pau) :
Je ne suis pas pressée de passer en procès… Ça va être le lavage de linge en famille devant plein de personnes. On n’arrête pas de me rabâcher : « Trente ans ! » Mon père, je n’ai pas de nouvelles de lui depuis que j’ai cinq ans… Il ne me connaît pas. Il y a des chances qu’il soit à mon procès, ça va être bizarre. Ma mère, ça me fait chier qu’elle soit là… Honnêtement, y a rien qui pourrait me soutenir pendant mon procès.
La présence de proches est quelquefois moins charitable. Elle est parfois commandée par le désir d’observer la « tenue » de l’inculpé et de vérifier qu’il est « régulier » (« réglo »). En outre, certains procès sont, notamment dans le cas des crimes les plus odieux, des catalyseurs des passions collectives, comme le film M le Maudit (Lang, 1931) le montre bien. Les proches préfèrent donc s’épargner ce spectacle, auquel les autres assistent, fascinés par la « chute ». Ce voyeurisme est souvent douloureusement ressenti par les détenus, comme en témoigne Yannick (centrale de Clairvaux) :
– Mes parents sont venus à mon premier procès, pas au second. Ils ont beaucoup souffert au premier à cause des journalistes. Pour le second procès, c’était un show. J’ai donné à la presse ce quelle voulait…
– Qu’est ce qu’elle voulait ?
– Elle voulait découvrir une bête… J’étais déjà condamné. J’ai jamais plaidé mon innocence… Mais la Justice a fait de moi ce que je suis maintenant…
Kokoreff (2004, 108) remarque justement que le procès produit un « double travail de mise en scène de l’action pénale et de trajectoires biographiques ». En effet, le judiciaire rationalise l’expérience personnelle et l’acte, aidé, surtout lors d’un passage devant un cour d’assises, par les expertises psychologiques. Durant le procès, ces dernières, exposées publiquement, sont fréquemment particulièrement mal vécues. Entendre parler de soi et de ses proches, notamment par des « experts », provoque souvent un sentiment de solitude et de « déshumanité ». Les proches sont d’autant plus heurtés qu’ils peuvent eux-mêmes être tenus (publiquement) pour « moralement » responsables de la personnalité (et incidemment de tel ou tel passage à l’acte) de leur proche. Pierre, incarcéré à la maison centrale de Clairvaux, raconte ainsi :
Mon père est venu pendant mon procès aux Assises. On a expliqué qu’il était responsable de ce qui s’était passé… Mon père comprenait pas… Et tous ont dit pareil. Après, il a fait un accident cardiaque, il est tombé d’un coup à la barre.
Le sens de ces expertises sont généralement moins bien comprises et admises par les membres des classes supérieures, dont on connaît la plus forte réticence à recourir à des solutions légales pour des questions d’ordre privé (voir Sherman, Policing Domestic Violence, 1992). Se joue effectivement, au cours du procès, une disqualification sociale, diversement marquée selon les origines sociales. Pour ceux issus des classes populaires, le procès ne fait habituellement qu’entériner le sentiment d’exclusion. Celui-ci se manifeste notamment dans les différences de compétences linguistiques, c’est-à-dire la confrontation à un langage commun aux juges et aux avocats. En ce sens, il faut noter, avec Kokoreff (2004, 116), que le rôle de l’avocat entérine une double disqualification du prévenu : c’est celui qui parle bien (le « baveux ») et qui présente bien (le « pingouin »).
[1] Il y a, dans les établissements pénitentiaires, en moyenne, un CIP pour 100 détenus
[2] Dans les extraits d’entretien, les éléments entre crochets sont de la rédactrice.
[3] À cet égard, l’affaire « Grégory » est exemplaire. Voir : Lacour (1993)
English
La rencontre
Ban public est la première étape de la réalisation d’une promesse faite à d’anciens compagnons, amis. La volonté de ne pas cesser de lutter en sortant. Et le serment était d’autant plus impossible à oublier que la peine et l’enfermement continuaient même dehors. Pour le reste ce fût une série de belles rencontres, d’énergies, d’envies communes, pour réunir en un seul lieu toutes les sources d’information sur la prison. Ban Public naît durant l’hiver 1999 de ce besoin de dire, de rompre le silence.
L’association
BAN PUBLIC est une association, loi de 1901, areligieuse, adogmatique et apolitique, qui a pour but de favoriser la communication sur les problématiques de l’incarcération et de la détention, et d’aider à la réinsertion des personnes détenues.
Par son nom, l’association BAN PUBLIC se veut un lien symbolique entre le dedans, caché parce qu’infâme aux yeux du monde, et le dehors qui ne sait pas ou n’accepte pas son reflet, son échec. Nous voulons ouvrir les portes et les yeux, afin que la prison devienne l’affaire de tous.
Composée d’ancien(e)s détenu(e)s, de journalistes, d’universitaires, d’artistes, d’associations… de citoyens, BAN PUBLIC développe son action autour d’un site Internet, prison.eu.org.
Un site indépendant consacré aux prisons
Ce projet est né d’une observation simple : la relative confidentialité et surtout la dispersion des sources, témoignages, rapports et études consacrés aux prisons et aux prisonnier(e)s.
L’objectif est double :
1. Créer une plate-forme d’information et de réflexion accessible et pédagogique, le site ayant pour objet l’échange et la production d’information et, plus globa
lement, la mise en relation de celles et ceux qui travaillent sur les prisons et pour les détenu(e)s.
2. Accroître la visibilité du problème de la détention et sensibiliser le grand public à ces questions.
Le contenu
Les informations disponibles en ligne touchent autant à la vie “ dedans ” que “ dehors ”. La ligne éditoriale privilégie le service (infos pratiques, guide forum, listes de diffusion) et l’information (veille, analyse, documentation). Les archives intègrent des documents aussi différents que des textes de lois, des rapports, des lettres, photos, dessins, articles, études, statistiques, liens hypertextes ou interviews, structurés par une base de données et coordonnés par un puissant moteur de recherche. L’accès à la totalité des contenus est gratuit.
Le réseau
La dynamique fédératrice du projet fonctionne sur la constitution d’un réseau transversal de (ex)détenu(e)s, de familles, d’intervenants professionnels ou bénévoles, d’associations, de journalistes ou de chercheurs. Ces producteurs d’informations sont reliés par une liste de diffusion, et les associations membres de BAN PUBLIC peuvent créer leur propre site Internet au sein du réseau prison.eu.org.
http://www.prison.eu.org
Ban public (adresse postale) 12 villa Laugier 75017 Paris
redaction@banpublic.org 06-62-85-62-97
Siret : 449-805-928-00016
 Dédicace au Sénat ce samedi 10 novembre, de 14 à 19 h, dans le 77ème après-midi du Livre de l’Association des Ecrivains Combattants
Dédicace au Sénat ce samedi 10 novembre, de 14 à 19 h, dans le 77ème après-midi du Livre de l’Association des Ecrivains Combattants La Maison des Babayagas… ou comment monter sa maison de retraite autogérée
La Maison des Babayagas… ou comment monter sa maison de retraite autogérée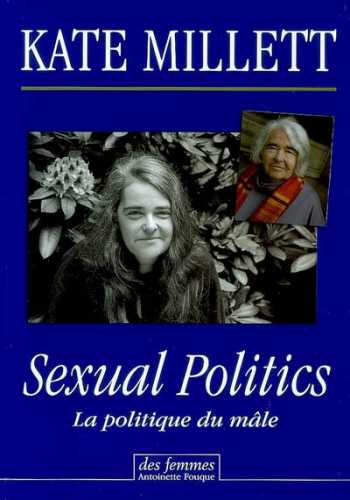 Millett Kate –
Millett Kate –