 un commentaire sur « On dirait une ville » à paraitre dans la revue des lettres de l’univ de beyrouth
un commentaire sur « On dirait une ville » à paraitre dans la revue des lettres de l’univ de beyrouth
« On dirait une ville »
Françoise Collin
Editions des femmes- Antoinette Fouque
Le texte que propose « On dirait une ville » se donne sous une forme apparemment simple. Mais cette simplicité « trompe l’œil », car en vérité elle transporte une construction complexe, où des flux d’images et de pensées conjoignent rêves, souhaits perceptions et souvenirs qui se croisent, entrent en résonances, se font écho, dessinant en filigrane, une fiction.
On peut lire cette fiction comme une genèse : celle d’une naissance à un monde multiple où la vie ne se soutient que par l’écriture.
Avant, il y a la douleur : un meurtre mal effacé, les sables d’un désert, la confusion des pôles, la folie. Deux enfants nus, desséchés . Peinture inaugurale d’un paysage dévasté, image à la Tarkowski d’un univers sans dieu, livré au vide, à la douleur hantée par l’oiseau doublé d’un ange.
Où chercher l’ombre de sa vie d’abord perdue sinon au delà du désastre ?
Voilà qu’ à l’horizon une forme noire grandit, c’est celle d’une femme qui « avance d’un pas décidé ». Armée de plans et d’instruments de mesure elle choisit et construit non sans joie, son lieu : un chez elle où elle pourra écrire. Alors une ville naît à la place du désert. Est-ce un cimetière ? L’oiseau et l’ange tournoyant autour des restes de la douleur se posent sur le papier en milliers de signes, nous entrons dans le cœur du texte.
Etrange rencontre dans cette ville, que celle des étrangers qui vous font découvrir que vous aussi êtes une étrangère, mais différente d’eux. Etrange, l’appartenance à ses origines, au pays où vous êtes né, à la culture qui a fabriqué votre identité, aujourd’hui vacillante. Tout se trame par petites touches, par petites scènes, par petites histoires. Une galerie de portraits, apparemment. Mais s’y nouent des vœux et des rêves. Tandis que la mort rôde partout voici qu’elle se souvient du temps très long que prend une année dans l’enfance. Tantôt, elle convoque l’inexistence, tantôt elle suspend le temps et son être à une goutte d’eau jusqu’à ce qu’elle tombe.
Mais elle joue le jeu, va à ses rendez-vous, semble faire comme les intellectuels natifs de cette ville, devenue Paris grâce aux noms propres des lieux égrenés ; elle les imite mais eux, qui la renvoient à son étrangeté, sont également pour elle des étrangers, avec leurs mœurs, « leur parler parisien » ; elle va, elle revient dans son quartier proche de la rue Saint Maur, où elle coudoie Africains, Indous, Lettons, Arabes, Turcs,Vietnamiens, mais aussi des squatters dont un breton qui la vole, la boulangère maquillée dès le matin, la chauffeur de taxi épuisée. en fin de journée. Les uns l’irritent, l’encombrent, d’autres l’attendrissent, la grugent, la volent. Elle se sent plus proche de ceux-là que des autres Chacun, chacune son histoire.. C’est un broyage immense dont elle devient le témoin.
Elle joue le jeu certes, mais si elle habite toujours ce monde là qu’elle a rencontré et dont elle fait la plus contemporaine des expériences, il reste qu’elle s’en sépare légèrement, laissant les cris et les paroles résonner « sous elle ».
Ainsi à travers les récits d’aventures quotidiennes sommes-nous reconduits à penser les fils d’un processus qui tressent, étape par étape, le devenir d’une inscription dans un monde perçu comme chaotique.
« Chronique d’un été » , l’intitulé de la seconde partie de ce livre fascinant, célèbre le temps d’une grâce donnée : « Ce qui faisait chemin depuis longtemps est arrivé » . Un vœu s’est posé sur la table : il faut laisser être ce qu’on n’ose pas nommer des retrouvailles, seulement inscrire ce qui les compose et les accompagne. Tempo de sonate : quatre ou cinq mots – un lys, une rose, une cerise – ce sont les notes d’une mélodie, reprises à travers chaque mouvement et composées jusqu’à la fin ; il y a les temps d’allégresse – un oiseau sans nom chante – et les andante des jours immobiles. Il faut retenir son souffle, célébrer un dimanche sur la Lys, entendre le bruit de la tondeuse. C’est un été chaud. Un mot de trop tuerait le miracle en cours. De toute façon il n’y a plus rien à dire. On est au delà de l’adieu.
L’art, le grand art de Françoise Collin tient à sa capacité de suggérer une pensée, un désir à travers la mise en forme d’un détail qui vous tient en arrêt, qu’on exhausse en le nommant dans sa pure nudité. Entre l’Epiphanie joycienne et le Haïku, elle nous tient, dans son style à elle, dénudé, sans pathos. Alors, d’un simple mot à l’autre, l’énigme ne cesse pas de résonner et congédiant tout sens, on peut entendre bruisser le pas du temps, la mort omniprésente, cet indicible réel qui nous hante.
Marie claire Boons-Grafé

 Catherine Weinzaepflen, Laurence Zordan, Michèle Ramond, Françoise Collin (à confirmer) seront également heureuses de rencontrer leurs lecteurs à cette occasion. Dès 16 heures également le samedi 20 juin.
Catherine Weinzaepflen, Laurence Zordan, Michèle Ramond, Françoise Collin (à confirmer) seront également heureuses de rencontrer leurs lecteurs à cette occasion. Dès 16 heures également le samedi 20 juin. 
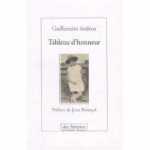



 http://sophiavaillant.com/topic/index.html
http://sophiavaillant.com/topic/index.html http://www.duosugiyama.com/at-concerti-fr.html
http://www.duosugiyama.com/at-concerti-fr.html un commentaire sur « On dirait une ville » à paraitre dans la revue des lettres de l’univ de beyrouth
un commentaire sur « On dirait une ville » à paraitre dans la revue des lettres de l’univ de beyrouth