http://www.inventaire-invention.com/lectures/gibourg_cavalli.htm
Mes poèmes
ne changeront pas le monde
Patrizia Cavalli
éditions Des Femmes, bilingue,
2007, 489 pages, 23 €
Lectures
Jusqu’à il y a encore peu, comme aux enfants, on interdisait la parole aux femmes, et la maîtrise qui va de pair, en tout cas qu’on lui associe souvent. Bien sûr, l’exercice de la parole est en partie lié à l’exercice d’un pouvoir, mais en donnant la parole aux femmes – plutôt en acceptant progressivement de les voir se l’approprier – on (c’est-à-dire les hommes mais aussi les femmes qui pouvaient ne pas trouver très bien de dire ce que l’on pense, a fortiori quand ça dérange – il y a des choses qu’on ne dit pas, n’est-ce pas ?) s’est donné la possibilité de faire une découverte, notamment dans le domaine de la littérature ou de la poésie, nouveauté qui consiste à voir dans l’usage de la parole non pas l’occasion d’exercer une forme de domination mais d’encourir un risque dont la forme ultime serait comme l’envers de la conquête : je veux parler de la reconnaissance d’une perte. Pourquoi est-ce aux femmes que nous devons de redécouvrir cette vérité première – elle est ancienne, hors d’âge, la culture n’a jamais fait que travailler à sa dissimulation –, eh bien pour la raison qu’elles ont l’art d’aborder le domaine des sentiments et du vécu amoureux avec une sensibilité, voire une simplicité, qui généralement font défaut aux hommes, plus fiers, et davantage coupés de leurs émotions au nom d’une éducation privilégiant la froideur et la raison, le calcul, et encore une fois la maîtrise, la poigne. Oui, à nous autres garçons ce n’est que depuis peu qu’il nous est permis de faire cas de nos larmes, et encore cela passe-t-il souvent pour de la mièvrerie. Un homme ça mange de la viande et ça ne pleure pas. Pour ma part, je considère comme précieuse l’œuvre qui ouvre des voies à des pensées ou des affects bloqués quelque part dans les circuits du corps, qui libère et fait circuler en moi (voire au dehors) ce qui ne demandait qu’à être, qu’à sortir du néant.
Patrizia Cavalli est une de ces voix conduisant à l’essentiel. Ce n’est pas un hasard si l’amour occupe une place si cruciale au sein de ses écrits. Ce qui existe à peine, ce qui est rêvé, désiré tout autant que perçu ou palpé. Mais comment le saisir, l’approcher sans le faire fuir ? Un jeune chevreuil sortant à peine du bois ne serait pas plus saisissable. Les poèmes de Cavalli ont cette fulgurance, cette fugacité, cette immédiateté qui expriment à la fois l’intensité et l’illusion, l’ambiguïté de ce qui est. Abstraite sa poésie, métaphysique ? Oui, à force de parler des corps, des désirs et des émotions. Ce n’est pas là le moindre des paradoxes et la moindre des énigmes de la vie que d’adjoindre ou de mêler le plus consistant au plus éthéré, le plus vital au moins évident. Paradoxe de l’instant, fait de rêve et de bouleversement, de vacillement, d’émerveillement. Patrizia effleure, pique ou épingle. Elle est parfois cruelle, mais toujours délicate. Telle est la nature de son travail, et encore ce mot de « travail » ne convient-il guère. Il dit trop l’effort, la contrainte et la sueur, bien qu’il ait le mérite de mettre l’accent sur la part physique, concrète, de l’activité poétique, sa part rythmique et nerveuse. Sans oublier une dimension ludique, présente dans l’esprit espiègle de l’auteur, mais aussi dans une pratique non systématique du jeu de mots. Poésie ironique ou humoristique pour ne pas être trop sentimentale, voire pathétique, se faisant légère pour ne pas être trop grave, distante pour ne pas paraître trop blessée, poésie directe sans être toujours explicite, courageuse, sans chichi et sans fioritures, poésie dense, philosophique et vagabonde, instruite de l’éphémère comme de l’infime, poésie en équilibre, funambule, maître en vertige et en figures peintes au-dessus du vide :
« Chaque jour maintenant dans chaque instant
dans chaque mot il y a toute ma vie,
gloire ou ruine me vainquent à l’excès.
L’amour est présomption de son état. »
En 2002, Lidia Breda a eu la lumineuse idée de publier le « Toujours ouvert théâtre » de Patrizia Cavalli dans la Petite bibliothèque Rivages. C’est comme ça que je l’ai découverte. Par chance. Il est vrai que la signature d’Agamben en quatrième de couverture ne pouvait que m’encourager à aller plus loin. On retrouve le philosophe dans « Mes poèmes ne changeront pas le monde », cette fois comme préfacier. Patrizia Cavalli serait-elle une poétesse pour intellectuels ? Certes pas, ce serait très réducteur que de penser cela, même si le noyau intime de sa poésie est je crois en puissance d’attirer des intelligences moins émotives, comme si cette poésie à la fois singulière, franche et économe, dévoilait un envers à des êtres moins capables de simplicité (je me répète) et leur fournissait comme un complément inespéré, un double salutaire.
Une des forces de Patrizia Cavalli consiste à exposer une intimité, une « domesticité » même, sans jamais se raconter. Un coup de projecteur éclaire une scène, ou une pensée, mais toujours rapidement et incomplètement. Au lecteur de recomposer ou de laisser son imagination vagabonder à la suite de la vérité échappée. Pas d’explication, pas d’analyse, pas de discours, mais des traits saillants ou des fragments colorés. Le poète est moins proche du romancier que du peintre ou du photographe. Il décrit et exploite son sens averti du détail. Son « moi » n’est pas tant la matière de son inspiration qu’un point de vue privilégié. Le « je » remplace l’objectif ou la caméra, le pinceau ou le couteau. Aussi nulle saturation narcissique mais plutôt la générosité de quelqu’un qui accepte de dévoiler des pans d’une réalité à la fois intime et personnelle en même temps que commune et banale. « Je » dissous et traversé, dépassé, surmonté, oublié.
Un poème long toutefois, le seul avec La journée atlantique à porter un titre, les autres désignant des ensembles qui sont autant de mouvements d’un chant général. Et qui s’appelle : Le moi singulier qui n’est qu’à moi. Pour une fois, la poétesse s’explique et répond indirectement aux critiques de ses amis qui lui reprochent précisément de ne plus voir les autres à force de s’observer soi-même.
« …
Si quand je parle je dis toujours moi
ce n’est pas attention particulière et malsaine
à moi-même, ce n’est pas complaisance,
bien au contraire je ne me considère
qu’un exemple quelconque de l’espèce,
et donc ce moi verbal n’est autre
qu’un moi grammatical.
Et quand bien même ce moi
serait mon moi charnel, me voici encore
exemple, certes peu enviable, plutôt
mal réussi, du corps primordial.
… »
Mais on ne convaincra pas ceux qui vivent et sentent autrement. Mes poèmes ne changeront ni le monde ni les gens.
Le « moi » est comme une loi, une convention, psychologique, philosophique, grammaticale, on pourrait ajouter juridique, la question de la responsabilité (du responsum , de la réponse) lui étant consubstantiellement associée. Mais que se passe-t-il quand cette loi ne vaut plus, quand dans cet adagio que serait la vie la loi s’est perdue (la formule est de Cavalli) ? Peut-être entre-t-on en poésie ou en tout cas s’est-on suffisamment dépouillé de soi pour pouvoir y entrer. Mais ce « je » alors, qui traditionnellement célèbre ou se plaint ? Un reste, un résidu, un vestige conventionnel à partir de quoi la langue est ressuscitée. Ce n’est pas même une main, plutôt un gant, mais cela suffit pour redistribuer le monde et ses catégories, à ceci près que dès que le poème rencontre le monde ordinaire qui prend volontairement les conventions pour des faits bruts, alors le malentendu commence, et le débat, et la fatigue. Le poète est en équilibre entre un monde conventionnel auquel il fait, pour les bienfaits de son œuvre, peu ou prou semblant de croire, et un monde de choses et d’êtres physiques et métaphysiques difficilement contestable, qu’il soit prodigue en bonheurs ou en déceptions. Le poème vacille, et s’il détient une vérité, elle est là, dans le fait de tituber, de chanceler, dans cet espace, ce théâtre.
Une chose restera toujours difficile à accepter, c’est que la scène de l’art puisse peser autant dans la balance que la scène dite de la vraie vie. A fortiori un art de signes, de traces, comme l’écriture ou la peinture (c’est plus ambigu avec le spectacle vivant). On voudrait que la vie soit poétique et l’art vivant, on ne veut pas voir le prix à payer d’une telle accolade, le brouillage des catégories, l’abandon de quelque chose qui doit bien remonter jusqu’à la croyance (et pas seulement au sens religieux du terme, je le dis au sens où la croyance est le ciment de nos représentations).
La poésie la plus fragile devient alors la plus subversive, mais d’une subversion douce que beaucoup ne voient pas, et pour cause, ils n’entendent pas le silence entre les mots qui défait les nœuds qui retenaient l’embarcation.
C’est parti, on s’en va, il n’y a plus qu’à suivre le mouvement de la dislocation et de l’enchantement. Il y a bien une forme de renoncement au fondement de cette élévation, de cette libération qui parfois est si étouffante, une forme d’acquiescement. Et que dit-elle ? Elle ne promet rien, elle est comme libérée de l’engagement. On trouvera cela léger, insignifiant. A moins que cela laisse songeur et qu’on éprouve en même temps qu’une forte empathie une sorte d’inquiétude, presque agréable, étrangement consolatrice. La voix des prophètes s’est tue, il reste celle des éléments et des origines balbutiantes, le fondement désagrégé de nos rêves de construction les plus fous et les plus ordinaires :
« Sylvie, Valérie, Stéphanie, Anne-Marie,
connais même pas, qui c’est ?
Laissons tomber, je renonce, pas la peine.
Si ça se trouve elles sont belles, douces et hardies.
Mais j’y crois pas. Et puis qu’est-ce que j’en ferais ? »


 Résumé : Danielle + Antoinette + Colette = trois excellentes raisons de venir à l’Espace Des femmes mardi 29 janvier. ( + une quatrième : les premières soldes culturelles : livres de George Sand, Lou Salomé, Virginia Woolf etc à 2, 4 ou 6 euros)
Résumé : Danielle + Antoinette + Colette = trois excellentes raisons de venir à l’Espace Des femmes mardi 29 janvier. ( + une quatrième : les premières soldes culturelles : livres de George Sand, Lou Salomé, Virginia Woolf etc à 2, 4 ou 6 euros)
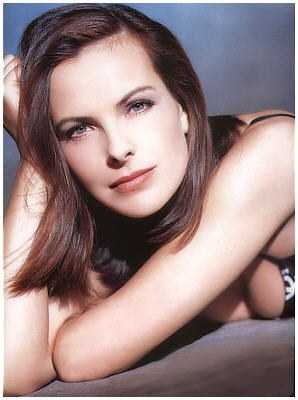 22.01.08
22.01.08