Article de Psychologies magazine sur « Mondial stéréo »



Guilaine Depis, attachée de presse (Balustrade)
Rampe de lancement ! Appuyez-vous sur la balustrade !
Article de Psychologies magazine sur « Mondial stéréo »



 Jasmine Catou et le Covid 19
Jasmine Catou et le Covid 19
Je m’étire voluptueusement sur notre canapé, en m’efforçant de reproduire au mieux une posture présentée dans l’émission de télévision, le chat, son maître et le yoga. Je me sens bien, détendue. Je savoure pleinement l’instant présent et le rayon de soleil qui réchauffe mon ventre. Ah ! Maman s’approche de moi en souriant. Ma récréation est terminée, je crois ; elle me saisit et m’affuble d’un drôle de masque, un cône blanc, avant de me porter jusqu’à ma cage de transport. Je savais que je devais sortir ce matin, mais ce déguisement ridicule me surprend et m’exaspère. Ma mère m’a avertie hier que nous étions attendues aujourd’hui dans un studio d’une radio parisienne pour présenter Les enquêtes de Jasmine Catou, le livre dont je suis l’héroïne. Heureusement, les auditeurs ne me verront pas si on excepte ceux qui suivent l’émission sur Internet. Ceux-là se moqueront de moi. L’animateur estime que ses invités se livreront d’autant mieux en présence d’un animal et, malgré mes réticences à quitter le havre de notre appartement, je pensais jusque-là qu’il avait raison. Mais si cet accoutrement est obligatoire pour accéder au studio, je refuse de m’y rendre ! Foi de Jasmine Catou !
Je m’agite derrière les barreaux et j’essaye de retirer le masque avec mes pattes, si bien que Maman doit me sortir quelques instants pour me caresser et m’apaiser.
– Je sais, mon cœur : tu es gênée par ce bout de papier, mais il n’est là que pour te protéger du virus.
Maman, voyons ! Je suis une chatte, pas une humaine. Je ne risque absolument pas d’attraper ou de transmettre la maladie. Tu n’as pas pris au sérieux ce reportage que nous avons vu à la télévision sur ce chien de Hong Kong testé faiblement positif au Coronavirus, j’espère ! Je tourne la tête pour lui signifier que je trouve son idée grotesque.
– Pardon, ma chérie, mais Augustin l’animateur a imposé le port du masque à tous ses invités y compris aux deux animaux présents.
Parce qu’en plus, je ne serais pas la seule créature à quatre pattes à participer à cette émission ! Je devrais partager la vedette ? Maman s’est bien gardée de m’en informer de cette cohabitation qui change tout.
Elle me remet dans la cage et s’apprête à son tour. J’ai envie de m’esclaffer en la voyant ainsi harnachée, avec ce papier blanc qui couvre sa bouche, avant de me renfrogner. Je dois moi-même prêter à rire.
Nous partons pour le studio de Radio Tour Eiffel. D’après ce qu’a expliqué Agathe à son amie Armelle par l’intermédiaire du téléphone – elles n’ont plus droit de se rencontrer depuis lundi dernier– Augustin, l’animateur, se gargarise d’être entré en résistance contre la quarantaine ; il essaye de maintenir une grille de programmes proche de la normale. Maman a beaucoup hésité à accepter son invitation du fait des risques encourus, mais elle a choisi d’y aller par conscience professionnelle. Elle estime de son devoir de promouvoir son auteur qui a su mettre en musique mes exploits. C’est aussi sa contribution au maintien du moral des confinés puisque la lecture est l’une des dernières activités permises aux humains avec la télévision, la radio et Internet. J’espère que, pour la récompenser de s’être déplacée, nous gagnerons la sympathie d’un large public.
Nous grimpons à l’arrière du taxi qui nous attendait au bas de chez nous. Je suis d’abord amusée par le spectacle d’Agathe ouvrant la portière de la Mercédès avec la manche de son manteau, avant de me reprocher mon ironie : la situation est suffisamment grave pour qu’on prenne le maximum de précautions. Je dois arrêter d’être sarcastique ; tout n’est pas prétexte à moqueries.
Paris est vide. Alors que d’ordinaire les rues sont encombrées, que des travaux ralentissent la circulation, nous ne mettons que quelques minutes pour gagner le studio d’enregistrement qui se trouve place du Trocadéro. Après avoir payé à l’aide de sa carte bleue, être sortie du taxi et m’avoir posée avec ma cage sur le sol, ma mère s’est lavé les mains avec un liquide contenu dans un petit flacon. Je n’aime pas l’odeur de ce produit que je trouve trop forte. Je sais : je suis bien grincheuse aujourd’hui et tout m’est prétexte à râler. Ce masque stupide est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase ! Déjà que participer à cette émission ne m’emballait pas même si j’apprécie que les feux des projecteurs soient braqués sur moi. Vous savez comme je suis casanière : je n’aime que notre petit appartement. Allez détends toi Jasmine Catou ! C’est la rançon de la gloire. Cent mille personnes vont entendre parler de toi et de tes exploits. Il faut les convaincre d’acheter notre livre.
Maman appuie sur le clavier extérieur et sur la clinche par l’entremise de son manteau. Une dame est en train de nettoyer le hall, Maman la contourne en se plaquant contre le mur, pour mettre le maximum de distance entre cette employée et elle. En d’autres circonstances, je trouverais ses contorsions amusantes, mais ce matin je dois m’efforcer de garder mon sérieux. Que c’est difficile !
Radio Tour Eiffel est située au rez-de chaussée. La porte du studio est entre-ouverte sans doute pour éviter qu’on ne la touche. Maman la pousse de l’épaule avant de la refermer à demi avec le pied. Les humains sont passés en quelques jours d’un extrême à l’autre : la semaine dernière ils se pressaient dans les parcs si j’en crois les images des reportages télévisés. Désormais ils voient partout des virus grimaçants qui cherchent à sauter sur eux et à les mordre : un vrai film d’horreur, comme celui avec des zombies que Maman a regardé le mois dernier. Enfin je ne suis qu’une chatte, je ne comprends pas tous les tenants et aboutissants de cette situation complexe !
Un homme assis autour d’une table salue Maman de la main et nous convie à prendre place sur un siège placé à un mètre de distance de lui. Il doit s’agir d’Augustin. Un autre invité est déjà arrivé.
– Docteur Yves de Pérec, vétérinaire exerçant à Neuilly Agathe Boulay et la célèbre Jasmine Catou, nous présente l’animateur.
Je me rengorge. Voilà un homme qui sait parler aux félins !
– Votre livre est amusant, commente le médecin pour animaux, excessif bien sûr, mais nous en reparlerons à l’antenne.
Que voulez-vous sous-entendre docteur avec ce mot « excessif » ? Le poulain de Maman qui rapporte mes aventures n’exagère nullement contrairement à ce que vous semblez insinuer. Hum ! Mon interview ne sera pas une partie de plaisir : j’aurai un contradicteur qui cherchera à me dénigrer. Heureusement, Maman a du répondant.
Un homme tenant en laisse un westie affublé d’un masque aussi comique que le mien, nous rejoint. Voilà sans doute le troisième humain invité. Il s’installe à la dernière place libre. L’animateur fait les présentations :
– Griffouille et Bernard Perroche, professeur de philosophie au lycée Louis le Grand de Paris et auteur de dialogue entre Socrate et mon chien, nous apprend-il.
L’enseignant a un bouc grisonnant hirsute et est mal peigné. Ses verres de lunettes sont sales. Quant à son animal ! En principe il devrait être blanc, puisque c’est la couleur de cette race canine. Mais son poil est emmêlé, et il est roux en de nombreux endroits. Et je ne parle pas de sa barbe : une horreur. Même s’il se disent philosophes tous les deux, ils n’ont pas la classe de notre ami Michel Becker toujours tiré à quatre épingles. Ils me font penser à Diogène, le clochard qui vivait dans un tonneau et qui a répondu à Alexandre le Grand « Ôte toi de mon soleil », alors que le roi lui demandait ce qu’il pouvait faire pour lui. Je tiens cette anecdote de Michel, il l’a racontée à Maman. Je ne manque jamais une occasion de me cultiver en écoutant les convives qui viennent se régaler chez Agathe ou les reportages à la télévision. Miaou, je ne suis pas une chatte ignorante des rues.
Je soupire en regardant les nouveaux venus. M. Perroche et son animal aurait dû faire un effort, aller chez le coiffeur et chez le tondeur. Ils seront filmés et seront vus par les auditeurs qui suivent l’émission sur internet. L’image qu’ils donnent est désastreuse et rejaillit négativement sur Maman et moi alors que, nous, nous faisons attention à notre apparence.
– Nous commençons dans cinq minutes, prévient Augustin.
– Puis-je permettre à Jasmine de quitter sa cage ? demande ma mère. La pauvre va faire de la claustrophobie.
– D’accord si elle reste près de vous.
– Bien sûr. Mon cœur tu ne t’éloigneras pas de moi ? Promis ? Ne va surtout pas réclamer des caresses.
Maman, j’ai compris la situation. Compte sur moi pour rester sage comme une image.
Ma maîtresse me pose sur le pupitre ; je me redresse et repère la caméra ; je m’entraîne à faire un sourire enjôleur, enfin à ma manière de chatte. Comme je vous l’ai déjà dit à de nombreuses reprises, j’aime paraître à mon avantage.
– Je vous remercie d’être venus, reprend Augustin. Je trouve important pour la qualité de nos émissions qu’elles soient enregistrées en direct. Nous perdrions de la spontanéité en utilisant le téléphone pour recueillir l’avis des intervenants.
– J’espère, réplique ma mère avec une pointe d’inquiétude dans la voix que cette rencontre n’aura aucune répercussion fâcheuse pour l’un d’entre nous.
– Nous avons pris toutes les précautions, enfin je l’espère.
– Montaigne a quitté son poste de maire de Bordeaux, pérore l’enseignant, juste avant que n’éclate une épidémie de peste. Il ne se cache pas dans ses essais avoir fui la contagion et cette attitude lui a beaucoup été reproché par ses commentateurs. Nous serons donc plus courageux que lui.
Quel prétentieux ! Faire la leçon à Michel de Montaigne ! Si je savais parler, je le lui clouerais le bec.
– L’émission commence, prévient Augustin.
Il entame un décompte avant d’ouvrir le débat en professionnel de la radio.
– Bienvenue sur l’antenne de Radio tour Eiffel pour notre débat, l’animal et la littérature…
Il poursuit en gratifiant chacun d’entre nous de quelques mots aimables ; même Griffouille est présentée comme une chienne lettrée, alors que pour ma part je l’aurais qualifiée de sac à puces.
– Monsieur Perroche, dans votre livre, votre compagnon à quatre pattes tient des propos philosophiques de haute tenue et répond au grand Socrate. Bien entendu, c’est vous qui vous exprimez à la place de votre animal.
Le professeur de philosophie n’a pas le temps de répondre, le vétérinaire intervient et lui coupe la parole :
– L’exercice d’antropo-morphisme réalisé par cet auteur est intéressant tout en atteignant rapidement ses limites ; il prétend présenter le point de vue d’un chien qui réagirait sur des problèmes et des questions essentiels en usant à la sagesse inhérente à son espèce, mais son exposé reste terriblement humain. La logique employée est nullement canine, elle appartient en fait au monde des hommes.
L’enseignant contre-attaque au quart de tour et défend son œuvre. Il emploie des mots abscons, fait appel de grands principes, mais je ne dois être qu’une chatte stupide, je ne comprends rien à ses arguments.
La discussion devient confuse, le vétérinaire et le professeur parlent en même temps, s’empêchent mutuellement de s’exprimer. Il ne manquerait plus que Griffouille ne se mette à aboyer pour que le chaos soit à son maximum. Augustin essaye de reprendre le contrôle de son émission et se tourne vers Maman.
– Et vous Agathe, vous nous présentez des énigmes qui seraient résolues par votre chatte. Évidemment, il ne s’agit que d’une fiction parodique.
– Pas du tout, mon auteur n’a pas écrit une œuvre d’imagination : il a rapporté des histoires réelles.
Le vétérinaire éclate d’un rire sonore.
– Votre chatte ne sait pas parler. Donc ces nouvelles ne sont qu’interprétation et affabulation de la part d’un écrivain à la plume trop prolixe.
Il dresse la liste des prétendues invraisemblances et exagérations qu’il a relevées. Il met en pièces Les enquêtes de Jasmine Catou et Maman peine à me défendre. Comment lui venir à l’aide et faire taire ce praticien trop acerbe ?
J’ai bien une idée qui me trotte dans la tête, mais de quelle façon puis la faire comprendre à mon entourage ? Je rencontre toujours le même problème. Je m’en remets à la télépathie, qui à quelques reprises dans le passé a fonctionné. Je songe très fort à ma solution et me concentre pour toucher l’esprit de ma mère. Hélas le lien ne s’établit pas aujourd’hui ; Agathe ne propose pas le test que j’essaye de lui suggérer. Essayons autre chose. Je traverse la table et vais me planter face au vétérinaire, droite sur mes pattes.
– Pour nos auditeurs, je précise que Jasmine vient de se placer juste devant Yves, s’amuse Augustin. Docteur, vous lancerait-elle un défi ?
– Votre remarque n’a aucun sens. Elle est incapable de comprendre que j’émets des doutes sur ses capacités de détective, car elle est une chatte qui ne décrypte pas le langage humain. Aussi, ne vous lancez pas dans des explications anthropomorphiques, ne vous imaginez surtout pas qu’elle vient protester. Elle s’est approchée de moi uniquement parce que je suis celui qui parle le plus dans ce studio.
Vous vous trompez du tout au tout ! Comment vous le faire comprendre ? Et si je secouais la tête ?
– Yves, j’ai l’impression qu’elle vous dit « non » en hochant sa gueule de gauche à droite, remarque hilare l’animateur.
– N’importe quoi, rétorque M. de Pérec.
– Peut-être attend-elle que vous lui proposiez une énigme à résoudre ? s’esclaffe Augustin.
Tout à fait ! N’est-ce pas là le meilleur moyen de faire taire ce vétérinaire si catégorique ?
– Votre émission sombre dans le grotesque, proteste M. de Pérec. Un chat détective, quelle absurdité ! Vous nagez en plein délire à l’Ionesco.
– Vous connaissez le but que nous poursuivons, réplique amusé l’animateur, nous mettons en présence des personnalités dont l’approche est totalement différente et nous suscitons ainsi des débats. Jouez le jeu !
– Vous devenez un émule en pire de M. Hanouna.
– Je me dévoue, intervient ironique M. Perroche. Je vais poser une devinette à notre Sherlock Holmes félin : qu’est-ce qui marche sur quatre pattes le matin, sur deux le midi et sur trois le soir.
Pff c’est facile. Notre ami Michel Becker nous a déjà expliqué lors d’un déjeuner chez Maman le fin mot de cette charade philosophique posée par un drôle d’animal à un roi antique. Je traverse la table et me dirige vers l’enseignant avant de poser ma patte sur sa main.
– Voudrait-elle signifier que la réponse est l’Homme ? s’étonne Augustin.
– Je m’interroge en effet, confirme M. Perroche.
Le vétérinaire hausse les épaules :
– Arrêtez de délirer et cessez de prêter des sentiments humains à cette chatte pourtant banale.
– Elle n’avait pas d’autre moyen de donner la solution de cette devinette, s’insurge Maman. Elle ne sait ni parler ni écrire.
– Vous seriez-vous tous les trois concertés pour me jouer un tour ? s’interroge caustique le médecin. Avez-vous dressé Jasmine pour qu’elle fasse semblant de résoudre des énigmes ?
Eh ! Je ne suis pas une chatte savante ou un animal de cirque.
– Si vous émettez ces doutes, c’est que vous êtes troublé, rétorque ma mère. Pour emporter votre conviction, donnez-lui à votre tour un mystère à résoudre et elle le fera à sa manière.
– Certainement pas. Je suis un scientifique sérieux et respectable. Je refuse de participer à cette farce.
– Agathe a raison, se gausse Augustin. Un chercheur fait des expériences pour découvrir la vérité, non ? Nous vous suggérons donc d’en effectuer une.
– J’ai lu Les enquêtes de Jasmine Catou, fort amusant du moment qu’on les considère comme une œuvre d’imagination. Cet animal aurait démasqué un assassin, découvert le lieu où se cachait un chien. Je n’ai aucune enquête policière de ce type à lui proposer.
– Dommage, regrette l’animateur.
– J’ai une idée, raille M. de Pérec. Je viens tout juste de perdre mon téléphone. Votre magicienne féline a-t-elle le pouvoir de le retrouver ?
– Oh ! Vous placez la barre fort haute, constate Augustin.
– Jasmine Catou est-elle géniale ou pas ?
– À l’impossible nul n’est tenu !
– En fait je plaisantais. Je n’attends absolument pas qu’elle me restitue mon smartphone. Je ne suis pas envoûté comme vous par cette chatte et ne lui prête pas des pouvoirs extra-sensoriels.
– Avez-vous seulement égaré votre portable ? interroge le philosophe.
Sa voix est empreinte d’hostilité. Sans doute reproche-t-il au vétérinaire d’avoir dénigré les qualités philosophiques de sa chienne.
– Je ne l’ai plus et j’ignore ce qu’il est devenu.
– Quel est le dernier endroit où vous vous souvenez l’avoir eu en votre possession ? demande ma mère.
– Dans un taxi.
– Vous l’avez probablement oublié dans ce véhicule.
– Non j’ai joint la compagnie qui m’a dirigé vers le chauffeur. Il a fouillé sa voiture en vain.
– Un des clients qui vous a suivi l’a peut-être pris, avance le maître de Griffouille.
– Il l’a gardé pour lui alors. Il ne l’a pas donné au conducteur
– De quelle façon est verrouillé votre smartphone ?
– Par l’empreinte de mon pouce et la reconnaissance faciale. Je suis prudent : j’ai doublé les sauvegardes
– Ces codes seront vraiment difficiles à casser. Si un passager du taxi l’a gardé, il n’en aura pas l’usage, remarque Augustin. Il va s’en débarrasser.
– En effet. Sans doute mon smartphone va-t-il finir dans une poubelle ou dans la Seine.
– Avez-vous malgré tout tenté de faire votre numéro depuis un autre appareil ? Si vous n’avez pas encore essayé, je vous prête mon portable, propose le papa de Griffouille.
– Je vous remercie, mais cela ne servirait à rien. J’avais fermé mon téléphone après avoir raccroché vu je me rendais dans ce studio et que je ne voulais en aucun cas que nous soyons dérangés par un appel intempestif
– Comment avez-vous joint le conducteur, si après le taxi, vous nous avez immédiatement rejoint, interroge soupçonneux M. Perroche.
C’est la deuxième fois que le philosophe exprime des doutes. Cette histoire de téléphone disparu serait-elle une fake-new comme disent les humains, une fausse énigme posée par ce vétérinaire pour me ridiculiser ?
– Je suis passé chez ma mère avant de venir ici, elle m’a prêté son téléphone. Elle a quatre-vingt-dix ans ; avec le covid 19, elle ne sort de plus de chez elle. Je lui ai apporté ses courses de la semaine. Arrivé à son domicile, je me suis aperçu que je n’avais plus mon appareil.
– Avez-vous fouillé chez elle ? s’enquiert Agathe.
– Bien sûr, j’ai regardé si je ne l’avais pas fait tomber dans son entrée, dans le hall de son immeuble ou sur le trottoir devant chez elle. Mais je n’ai rien trouvé.
– Vous avez téléphoné lorsque vous étiez dans le taxi ?
– Tout à fait : à ma mère pour la prévenir que j’arrivais.
– J’en tire la seule conclusion possible : vous avez oublié votre smartphone dans le VTC, conclut Augustin. Vous n’avez pas vraiment donné une énigme à résoudre à la chatte d’Agathe. Sa solution était évidente depuis le début.
– J’ai fait semblant de jouer votre jeu. C’était une plaisanterie, bien sûr.
– Nous allons alors clore cette parenthèse, avance l’animateur.
Sur une défaite de Jasmine Catou ? Certainement pas. Je saute à terre et frôle Griffouille qui se met à japper. Désolé, mon frère je prends au plus court. Arrivé près de Maman, je pose sur mon postérieur sur le sol et bat l’air avec mes pattes avant, tout en frottant mon museau et mon masque contre le manteau d’Agathe. Hélas Griffouille m’a suivie en grognant et je dois sauter sur la table pour mettre de la distance entre lui et moi, même s’il ne peut me mordre avec son masque. Quel chien stupide !
– Attention à vos animaux, reprenez-les en mains ordonne Augustin.
Maman fait mine de me saisir, sans doute pour me remettre dans sa cage, mais je me réfugie au centre du pupitre.
– Jasmine aurait-t-elle voulu nous faire passer un message ? s’amuse l’animateur.
– Encore une fois : arrêtez de l’humaniser, proteste le vétérinaire. Elle n’est qu’un animal.
Maman, Augustin : réfléchissez que diable ! Je ne peux plus vous donner d’autres indices : je suis au centre de la table et il vaut mieux que je ne bouge pas.
L’enseignant accroche sa laisse au collier de Griffouille et l’oblige à s’éloigner. En principe avec le confinement, les humains doivent se tenir à un mètre l’un de l’autre. Je culpabilise d’avoir, par ma maladresse exposé Agathe à la contagion.
– Si ma chatte essayait de nous expliquer quelque chose, marmonne Maman, c’est en rapport avec mon manteau.
Oui, tu es sur la bonne voie !
– Madame Boulay, je suis découragé de toujours me répéter : votre minette est dépourvue d’intelligence.
Eh ! Ne m’insultez pas docteur !
– Je connais ma chatte, reprend Maman malgré les injonctions du vétérinaire. Elle avait une idée derrière la tête en touchant mon vêtement, mais laquelle ?
Enfin Maman, c’est évident pourtant ! Augustin fronce les sourcils :
– Docteur, comment vous êtes-vous aperçu que vous n’aviez plus votre smartphone
– Il ne pesait plus contre ma jambe. Je le place toujours dans la poche droite de mon pantalon.
– Avez-vous vérifié si votre téléphone n’était pas dans votre loden ? C’est peut-être ce que Jasmine voulait nous suggérer.
– Inutile. À chaque fois, je replace mon appareil dans mon jean.
– Regardez rapidement dans votre parka et changeons de sujet. Nous en avons fait le tour et nos auditeurs vont s’impatienter, tranche Augustin.
Le vétérinaire s’exécute maussade. Il explore de la main dans sa poche droite. Apparemment elle est remplie de d’objets divers qu’il a du mal à identifier, car sa paume reste au même endroit.
– Videz le contenu sur la table, vous verrez mieux grince le philosophe.
– Je ne préfère pas, se défend Yves de Pérec.
Soudain de la stupéfaction se reflète sur son visage.
– Ce n’est pas possible, grommelle-t-il.
Il en sort son smartphone.
– Il n’a aucune raison d’être là. Je ne comprends pas.
– Avez-vous fait autre chose pendant que vous teniez le téléphone, interroge le professeur de philosophie.
– Non, enfin si le chauffeur de taxi, m’a indiqué le prix à payer. J’étais arrivé à destination.
– Voilà l’explication. Vous avez été dérangé dans vos habitudes.
Son ton est ironique. Le chien pousse un petit cri plaintif. Approuve-t-il son maître ? Serait-il moins idiot qu’il en a l’air ? C’est vrai qu’avec sa barbe sale, je l’ai peut-être mal jugé. Je partage les doutes de Griffouille et de son papa : cette histoire de téléphone égaré était-elle véridique ? Ne s’agit-il pas d’une fausse énigme ?
– Le test est concluant, constate l’animateur. Nos auditeurs ont vécu un grand moment de radio : une enquête en direct de notre chatte détective, la grande Jasmine Catou.
– Tout est dans l’interprétation des faits et gestes du félin de madame Boulay, bougonne Yves de Pérec. Je reste sur ma position. Je ne crois pas qu’elle ait découvert quoi que ce soit.
Mauvais joueur va !
– Au public de juger ! tranche Augustin. Monsieur Perroche, pensez-vous que Socrate aurait aimé débattre de philosophie avec Griffouille ?
Quelle question naïve ! Comment auraient-ils pu échanger ? Le philosophe antique aurait été incapable d’interpréter les aboiements de Griffouille même s’il est aussi intelligent que moi. Le vétérinaire aurait eu raison de souligner que le présentateur confond allégrement humains et animaux. Mais il se tient coi pourtant, il est devenu prudent. Jasmine Catou tu as encore triomphé !
Christian de Moliner
 LA CORONOTENTATION D’UN VAGUE VACCIN
LA CORONOTENTATION D’UN VAGUE VACCIN
— Il va falloir que je te laisse, Werner, parce qu’on m’appelle sur le chantier. Vois-tu, même si ce que nous avions fait ensemble, chez Jonquart, était passionnant, mon activité ici me procure un sentiment de plénitude comme je n’ai jamais éprouvé. Et encore une fois, merci beaucoup pour ta générosité. Je t’embrasse.
— Tu es une femme exceptionnelle, Toni, répondis-je. Je t’admire vraiment. A bientôt.
J’étais sincère. Toni m’appelait depuis Patna, la capitale du Bihar, un état situé dans le nord-est de l’Inde. Après m’avoir cédé la présidence du groupe agro alimentaire qui porte mon nom, elle avait pris la direction d’une ONG indienne et entrepris de construire un hôpital de campagne, afin d’y traiter des malades du Covid-19. Dans une contrée aussi pauvre que le Bihar, le virus se déployait à une vitesse affolante.
Ses remerciements redoublés m’avaient mis mal à l’aise. Certes, la somme que j’avais fait virer sur le compte de son ONG était considérable, même si Axel Tischgart m’avait assuré qu’elle serait déduite de notre résultat fiscal. Je me sentais troublé parce que, pour des raisons beaucoup moins nobles, j’avais accordé des subventions, dont le total était presque équivalent, à des centres de recherches et de laboratoires de Cuba. Des dépenses pour lesquelles je n’avais pu faire autrement que de dévoiler mes intentions à Axel et de lui faire profiter, à lui et à sa famille, du même traitement que pour la mienne.
Il faut dire que j’avais été bien inspiré, le mois dernier, de téléphoner à Camilo, à La Havane. Nous avions été très copains, une quinzaine d’années plus tôt, lorsque nous combattions côte à côte pour la révolution mondiale voulue par Fidel Castro. Les temps avaient changé. Fidel avait disparu, mais son esprit planait encore sur la mémoire des jeunes guérilleros de l’époque.
Dans la République de Cuba, Camilo occupait depuis six ans le poste de vice-ministre de la Santé Publique et l’on sait bien que dans les démocraties vraiment populaires, les vice-ministres ont souvent plus de pouvoir que leurs ministres.
— Hola, Romain ! Comment vas-tu, vieux compañero ? avait-il lancé au téléphone, lorsque nous fûmes connectés.
— Camilo, ça me fait drôlement plaisir d’entendre ta voix, avais-je répondu. Mais il faut d’abord que je te fasse un aveu, mon vrai nom est Werner, pas Romain…
— Ha ha ! Parce que tu crois que moi je m’appelle réellement Camilo ? répliqua-t-il en partant d’un gros rire.
Nous échangeâmes quelques souvenirs. Je m’enquis de son mode de vie, était-il marié, avait-il des enfants ? Il me demanda si j’étais toujours avec Julia.
— Sacré veinard, me balança-t-il lorsque j’eus acquiescé. Maintenant, dis-moi, camarade, j’imagine que tu ne m’appelles pas juste pour prendre des nouvelles de ma famille ou de la revolución. Que puis-je pour toi ?
Je répondis que selon des indiscrétions qui m’étaient parvenues, des chercheurs cubains auraient réussi à isoler une molécule, inhibant, dans certaines conditions, les protéines les plus agressives du coronavirus nommé Covid-19, et que ces protéines se transformaient alors en agents anticorps. J’en avais déduit que cette molécule pourrait être le principe actif du vaccin que le monde attendait désespérément.
— Je vois que tu es bien informé, camarade, dit-il sèchement après un silence.
Je respectai à mon tour un silence, avant de reprendre la parole d’un ton mièvre.
— Ils ont beaucoup de chance, ceux qui parviennent à mettreleur famille à l’abri.
À nouveau, un silence pesant, que je me gardai bien de rompre. Je l’entendis grommeler, puis il reprit.
— Je me souviens du jour où tu m’as sauvé la vie, camarade. Et donc je vais te faire passer en Europe de quoi vacciner une vingtaine de personnes. Mais tu n’ignores pas que notre pays manque cruellement de moyens. Et comme moi aussi je suis bien informé, je sais que tu es devenu un homme très riche. Alors je vais t’adresser une liste de comptes bancaires d’instituts qui me sont rattachés, avec les sommes que tu vas leur transférer.
J’eus un choc lorsque je fis le total des montants qu’ilm’indiqua, mais je m’exécutai sans discuter.
Deux semaines plus tard, il me rappela pour s’assurer que le précieux élixir me soit bien parvenu.
— Tu sais, me dit-il, à part toi, il n’y a qu’une seule autre personne, hors de Cuba, à avoir reçu de quoi faire vacciner sa famille.
— Sans indiscrétion, qui est-ce ?
— Le président américain. Pourquoi crois-tu qu’il se soit mis à serrer les mains de tout le monde ?
 Louise et Louis Alain Llense mars 2020
Louise et Louis Alain Llense mars 2020
« Et pour dire simplement, ce qu’on apprend au milieu des fléaux, qu’il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser ». Albert Camus, La Peste (1947)
Dans les jours gris, ceux d’avant le jour noir, Louis avait beaucoup marché et Louise beaucoup peint. Pour eux comme pour tous les autres d’ici, la menace avait d’abord été lointaine, exotique, asiatique et chacun l’avait prise du haut de ses certitudes, de sa petite supériorité européenne, de sa conviction d’être au-dessus d’un tel risque puisque ne consommant ni pangolin ni chauve-souris et faisant partie d’un peuple si supérieur aux autres que rien ne pouvait l’atteindre.
Quand le virus avait enjambé océans, continents, montagnes et frontières pour se présenter aux portes de leurs villes, ceux d’ici avaient continué de bomber le torse, il n’y avait encore que quelques cas, des gens pour la plupart très âgés et qui seraient, quoi qu’il en soit, morts à courts termes si le virus ne les avait pas pris. Louis qui vivait Rive droite à Paris et ne savait rien de Louise disait, il m’en faut plus pour m’empêcher de marcher. Louise qui vivait Rive gauche à Paris et ne savait rien de Louis disait, ce n’est pas pour cela que j’arrêterai de peindre. Autour d’eux, se trouvaient bien quelques oiseaux de mauvaise augure, promettant l’enfer pour bientôt, dénonçant l’inconscience ou la stupidité de leurs semblables mais ils étaient noyés dans la masse de ceux qui riaient de la situation, juraient que ce n’était qu’une manœuvre de plus des gouvernants pour éteindre les révoltes, pariaient que l’on ne mourrait pas plus de cette maladie là que de la grippe ou de la gastro-entérite.
Puis le nombre de cas avait enflé quotidiennement, il avait fallu fermer les écoles autour desquelles Louis marchait, les monuments que Louise peignait et inciter les gens à rester chez eux. On avait aussi initié toute une série de rites censés empêcher ou ralentir la propagation, on se lavait les mains à tout bout de champ, les masques de protection fleurissaient au nez de ceux qui pouvaient s’en procurer et les supermarchés étaient dévalisés par des foules hystériques qui se disputaient monceaux de nouilles et amas de papier toilette. On ne se touchait plus, ni bises ni serrements de mains et, quand on se croisait encore, l’un avançait machinalement vers l’autre par habitude puis les deux reculaient brusquement en se rappelant soudain que ce drôle de tango désarticulé était désormais la seule danse qu’il leur était permis de danser.
 Quand il fallut intimer l’ordre de ne plus sortir de chez soi que pour se nourrir ou se soigner, Louis fit exactement l’inverse. Non qu’il fut réfractaire aux ordres ou aux consignes, non qu’il fit partie de ceux qui, inconscients, bravaient les injonctions à garder le foyer pour s’en aller lézarder en promiscuité sur les quais, dans les parcs où le printemps déjà s’invitait, mais Louis partit de chez lui un matin, son appareil photo en bandoulière, son ordinateur portable dans un sac à dos, simplement pour donner à voir ce que ce monde d’intouchables masqués avait à raconter. Louise, elle, ouvrit sa fenêtre au soleil blanc qui s’offrait, posa, devant, son chevalet et sa palette, et entreprit de peindre à grands traits d’huile fine l’insolence bleue du ciel et l’immuabilité grise des toits. Autour d’eux, une pesanteur s’installait, le sentiment diffus que tous pouvaient être touchés gagnait du terrain et les regards se chargeaient d’une électricité mauvaise puisque l’ami, le voisin, l’inconnu pouvait être celui par qui le mal viendrait.
Quand il fallut intimer l’ordre de ne plus sortir de chez soi que pour se nourrir ou se soigner, Louis fit exactement l’inverse. Non qu’il fut réfractaire aux ordres ou aux consignes, non qu’il fit partie de ceux qui, inconscients, bravaient les injonctions à garder le foyer pour s’en aller lézarder en promiscuité sur les quais, dans les parcs où le printemps déjà s’invitait, mais Louis partit de chez lui un matin, son appareil photo en bandoulière, son ordinateur portable dans un sac à dos, simplement pour donner à voir ce que ce monde d’intouchables masqués avait à raconter. Louise, elle, ouvrit sa fenêtre au soleil blanc qui s’offrait, posa, devant, son chevalet et sa palette, et entreprit de peindre à grands traits d’huile fine l’insolence bleue du ciel et l’immuabilité grise des toits. Autour d’eux, une pesanteur s’installait, le sentiment diffus que tous pouvaient être touchés gagnait du terrain et les regards se chargeaient d’une électricité mauvaise puisque l’ami, le voisin, l’inconnu pouvait être celui par qui le mal viendrait.
Autour du trentième jour de l’épidémie, tout s’enflamma et devint incontrôlable. Le nombre d’infectés doublait chaque matin, la courbe des malades s’envolait verticale et surtout celle des morts atteignait ce qui la veille encore était un plafond et ne serait bientôt plus qu’un plancher. Les hôpitaux débordaient d’impuissance, des tentes de fortune accueillaient les malades à même le bitume des rues et des camions militaires évacuaient discrètement des cadavres d’hommes et de femmes qui n’avaient eu d’autre choix que de trépasser seuls, loin de l’amour de leurs proches obligés de les fuir pour ne pas risquer d’être contaminés. Louis continuait de marcher et photographier tout le jour sans prendre la peine, à présent, de regagner son domicile devenu inatteignable depuis que les transports en commun avaient été contraints de s’interrompre un à un. Il passait ses nuits dans des gymnases bondés où l’on entassait les sans toits d’hier, les touristes malchanceux qui ne pouvaient rester dans les hôtels, les fugueurs de toutes fugues à qui l’on offrait un toit, une soupe et un lit de camp pour la nuit. Louise continuait de peindre et le ciel et les toits, les jours passant ses lignes droites se faisaient courbes, ses bleus plus sombres, ses gris plus prononcés. Elle ne s’arrêtait de peindre que pour une boîte de sardines consommée à même l’évier de sa cuisine, une douche rapide au crépuscule annoncé ou un mauvais sommeil de quelques heures à peine.
A l’aube du jour noir, Louis quitta le gymnase- dortoir dans lequel il venait de passer une nuit insomniée entre les quintes de toux de ses voisins d’infortune et les âcres odeurs corporelles que la promiscuité rendait insupportables. Le froid, plus vif que les derniers matins, le contraignit à serrer son écharpe autour de son cou en un geste frileux qu’il croyait remisé jusqu’au prochain hiver. En allumant sa première cigarette de la journée, il leva au ciel un regard distrait et fut saisi par les couleurs qui semblaient s’y disputer le pouvoir, une lutte indécise pour y établir laquelle serait la dominante et qui nimbait la ville dans une lueur hésitant entre le mauve et le noir. A son lever, Louise embrassa aussi le ciel de son regard de peintre et voulut aussitôt en transposer l’étrangeté et la beauté sur une toile blanche. Mais elle eut beau chercher, retourner son appartement, regarder sous son lit et fouiller ses placards, plus aucune toile vierge ne s’y trouvait. Le magasin dans lequel elle se fournissait en toiles et peintures était à deux pas, cinq minutes à peine lui étaient nécessaires pour faire l’aller- retour, aussi résolut-elle de s’y rendre malgré les consignes de confinement strictes que la police faisait respecter à coups d’amendes rédhibitoires. A peine le temps d’enfiler à la hâte le vieux pantalon de jogging qu’elle ne quittait plus depuis quelques jours, de le couvrir de sa parka à capuche, et elle se jeta sur le boulevard désert dont elle entama l’ascension en direction du magasin. Au même moment, Louis tournait le coin de la rue du gymnase pour entamer la descente du même boulevard.
Longtemps après, quand ceux qui avaient survécu racontèrent ce matin là, tous parlèrent du noir. Du ciel matinal agité par la lutte des couleurs puis de l’incontestable victoire du sombre.
Comme une nuit tombée brutalement à quelques encablures de l’aube, comme un deuil qui se serait annoncé par les cieux, comme une défaite totale matérialisée par la disparition de la lumière. Le noir saisit Louis dans l’encore haut du boulevard en déclenchant automatiquement le flash de son appareil photo alors qu’il immortalisait un chat perdu au beau milieu d’un jardin d’enfants désert. Le sombre cueillit Louise, sa remontée vers le magasin à peine entamée, avec une telle soudaineté qu’elle manqua de trébucher sur le rebord métallique d’une plaque d’égout. D’abord le noir puis, quelques secondes après, le son strident des sirènes. Dans le sens de la descente, des camions de pompiers dévalèrent le boulevard, toutes sirènes dehors et dépassèrent Louis à hauteur du numéro 19. A l’opposé, des camions militaires sur lesquels des jeunes soldats en treillis hurlaient au travers d’immenses mégaphones, se portèrent au niveau de Louise qui se réfugia sous le porche du numéro 12. Le mariage contre nature des sirènes et des ordres hurlés donnait lieu à une cacophonie inaudible que pompiers et soldats tentaient de compenser en faisant de grands gestes de leurs bras, semblables à ceux des hôtesses de l’air à l’heure des consignes de sécurité dans les avions. Louise et Louis arrivèrent concomitamment devant le numéro 15 au moment où les camions de pompiers disparaissaient dans la désormais pénombre du bas du boulevard. D’un coup d’un seul, simultanément, ils comprirent enfin ce qu’hurlaient les soldats des camions « Rentrez ! Rentrez n’importe où pour vous mettre à l’abri ! Le virus est dans l’air ! Le virus est dans l’air ! Rentrez n’importe où pour vous mettre à l’abri ! ». Leur regards se croisèrent et, dans leurs regards, leurs peurs se croisèrent, inhibitrices, paralysantes, sables mouvants dont personne ne pourrait les tirer. Au loin déjà les militaires s’éloignaient, sur le boulevard les derniers passants s’engouffraient en hurlant sous les portes cochères. Un petit groupe passa à grands cris près de Louis et de Louise, groupe mené par un homme qui bouscula Louise et la fit tomber au sol. De colère elle hurla, son cri sembla la réveiller et réveiller du même coup Louis qui prit par la main Louise et sa colère, les releva et, de leurs rages jumelles, ils se jetèrent à l’intérieur de l’immeuble numéro 15 juste avant que la nuit ne s’abatte définitivement.
Ω
Un matin de plus pour Louis et Louise dans l’appartement de Paul, Virginie, Ethan et Lisette. Deuxième étage, porte gauche en sortant de l’ascenseur, appartement traversant avec vue, au Sud, sur le noir du parc et, au Nord, sur le noir du boulevard, numéro 15. Un matin uniquement reconnaissable au fait qu’il suit immédiatement le sommeil mais qu’on ne pourrait identifier à la lumière du jour revenue puisque, depuis le jour noir, la lumière n’est plus revenue. Louise flâne encore, un livre à la main, dans le grand lit de Paul et Virginie, Louis en termine de sa douche matinale dans la salle de bain des enfants. Dans quelques minutes, comme ils en ont désormais l’habitude, ils prendront ensemble leur petit déjeuner dans la grande cuisine américaine, ils échangeront quelques mots courtois, Louise demandera si le nuage est passé et Louis répondra une nouvelle fois qu’il n’en est rien. Pour le prouver, il se lèvera, ira à la fenêtre et tirera un pan de rideau et son geste, ce matin encore, ne dévoilera qu’un brouillard opaque et sombre. Referme s’il te plaît, murmurera Louise et Louis refermera dans un sourire forcé et répondra, demain peut-être. Chacun ensuite prendra possession de son atelier pour la journée, Louise investira le bureau de Paul pour y retrouver ses esquisses, Louis la salle de jeux des jumeaux pour y brancher son ordinateur et travailler sur ses photos. Leur journée sera douce, créative, silencieuse, quelqu’un arrivant à l’improviste et les découvrant tous deux affairés dans cet appartement superbe penserait à un couple heureux, en pleine réussite sociale et personnelle, goûtant avec gourmandise à une vie de volupté. Ce visiteur ne saurait rien, ne devinerait rien de la violence originelle, de ces deux êtres qui ne s’étaient jamais vus il y a dix jours, de la noirceur de leur passé récent et de l’incertain de leur futur proche. Comment imaginer que pour parvenir à cette image d’Epinal en rose bonbon, il avait d’abord fallu s’extirper d’une masse de bras, jambes, têtes, se hisser sur des corps tombés au sol, laisser derrière soi sur le perron de l’immeuble les plus faibles qui allaient en mourir ? Comment se figurer qu’une fois dans l’immeuble et la lourde porte de bois refermée derrière eux, il y avait encore eu une mêlée informe pour prendre possession de la loge de la concierge, des appartements du premier étage dont deux étaient occupés et fermés à double tour pour atteindre le second, le dépasser et trouver le petit escalier de service qui menait au logement superbe dans lequel Louis et Louise vivaient depuis dix jours ?
Si Louis avait trouvé la force de leur faire quitter le trottoir et ses sables mouvants, c’est Louise qui les avait guidés à l’aveugle dans le dédale des escaliers et les avait fait atteindre seuls ces sommets alors que d’autres rescapés de la rue continuaient de se battre en dessous pour pénétrer dans les logements. Louise encore qui avait habilement crocheté la serrure de l’appartement, en quelques minutes à peine et à l’aide d’un mystérieux outil métallique sorti de son sac à main. Louise enfin qui avait refermé sur eux et à double tour le verrou de la porte d’entrée. Il y avait eu ensuite quelques moments de panique, des mouvements de l’un et de l’autre vers les fenêtres qui donnaient sur la rue, des oreilles collées à la porte d’entrée jusqu’à ce que s’éteigne le brouhaha infernal des bagarres qui faisaient rage aux étages inférieurs. Mais personne n’avait trouvé le petit escalier de service pour grimper jusqu’à eux et les différentes fenêtres, pourtant larges et hautes, renvoyaient désespérément le même spectacle désolant d’un brouillard épais et sombre. Il y avait eu, plus tard, un peu de gêne entre eux que Louis avait tenté de dissiper en disant, bonjour je m’appelle Louis ce à quoi Louise avait répondu, bonjour je m’appelle Louise. Ils avaient souri du hasard de leurs prénoms jumeaux puis s’étaient accordés sur la nécessité de trouver une télévision ou un poste de radio. Un écran immense ornait l’un des murs du salon mais, une fois la télécommande dégottée à grand peine et le téléviseur allumé, l’écran n’affichait qu’un désespérant grésillement aveugle. Trouver un poste de radio fut beaucoup plus compliqué car si l’appartement regorgeait d’ordinateurs fixes ou portables, d’enceintes Bluetooth et de toutes sortes de matériel connecté, il semblait vierge de tous ces petits objets issus des siècles précédents et qui font le charme des intérieurs vieillis.
Finalement, c’est sur une étagère en désordre, fixée au-dessus du plan de travail de la cuisine, qu’ils avaient repéré un poussiéreux transistor à antenne. La molette avait tourné un moment dans le vide sous les doigts nerveux de Louis avant qu’un mince et presqu’inaudible filet de voix ne se fasse entendre autour du 100.6 de la bande FM. La voix disait au mot près ce que les soldats avaient hurlé plus tôt, dans le chaos du boulevard, « Rentrez ! Rentrez n’importe où pour vous mettre à l’abri ! Le virus est dans l’air ! Le virus est dans l’air ! Rentrez n’importe où pour vous mettre à l’abri ! » et, après quelques minutes d’écoute, Louise et Louis comprirent qu’il s’agissait en fait d’un message enregistré sans doute à la hâte et tournant en boucle sur les ondes.
Dans les premiers jours, leur vie ressembla à celle des explorateurs découvrant avec avidité une terre inconnue. Il fallut d’abord reconnaître chaque pièce de l’appartement qui en comptait de nombreuses et détailler chacune qui faisait la taille d’un studio confortable. Tout dans le salon, les chambres, les bureaux, la cuisine, les salles d’eau et de bain disait le confort cossu, les meubles de prix, l’aisance assumée mais affichée sans ostentation. Cette découverte des lieux s’accompagnait de celle, passionnante et grisante pour Louise et Louis, de la vie de leurs hôtes. Celle-ci était facile à recomposer puisque les murs du salon, des chambres et même des deux cabinets de toilette, étaient recouverts de photos qui la retraçaient à différentes époques et dans différents lieux. Sous chacune de ces photos des prénoms, toujours les mêmes, Paul, Virginie, Ethan et Lisette. Deux adultes formant un couple parfait, pareil à ceux des publicités ou des comédies sentimentales américaines, lui grand, musclé, souriant de toutes ses dents, elle, longue, élancée, blonde, une pointe de mélancolie dans le regard pour y atténuer un bonheur sans cela insupportable au commun des mortels. Dans les toilettes, des photos d’eux deux seuls, des Etretat, Monaco, Marbella, Bali, Vienne, immortalisés au temps d’avant les enfants, main dans la main, yeux dans les yeux, mouvements de valses ou de slows figés en 400 Asa pour emprisonner le bonheur. Dans les autres pièces, deux bébés blonds prenaient la suite et toute la place, jumeaux montrés nus et hilares sur le tapis d’éveil d’une chambre rose et bleue , enfants modèles et sages devant la grille de leur première rentrée, pré adolescents au regard frondeur soufflant les treize bougies d’un gâteau d’anniversaire dans ce qui semblait être la photographie la plus récemment affichée. Louis et Louise scrutaient longuement chaque photo comme une politesse due à ces hôtes qu’ils ne pourraient jamais saluer, s’obligeaient à un petit mouvement de tête ou de sourcils en passant devant eux, veillaient à ce que la poussière ne s’installe sur aucun des portraits de couple ou de famille. Ils leur parlaient aussi, les remerciaient régulièrement pour leur accueil sans tâche, pour avoir abondamment rempli frigidaires et placards de provisions permettant de tenir un siège de plusieurs mois, ils leur souhaitaient le meilleur pour ce qui ressemblait à un exil précipité auquel Paul, Virginie et les jumeaux avaient certainement dû se résoudre comme nombre de parisiens échappés de la capitale quelques heures avant le jour noir.
En dehors des temps consacrés aux besoins vitaux d’alimentation, d’hygiène et de sommeil, leur vie n’était qu’art. Louise, arrivée dans l’appartement vierge de tout matériel de peinture puisqu’initialement partie en acheter au matin du jour noir, avait trouvé son bonheur dans le dressing de Virginie. Sous une rangée de manteaux, vestes de tailleurs, chemisiers de toutes couleurs et de toutes formes, à l’angle du meuble immense et bas où patientaient des paires de chaussures surnuméraires, dormait l’une de ces boîtes dans lesquelles l’on remise rêves de jeunesse et passions précocement abandonnées. Ce carton là n’échappait pas à la règle puisque contenant en vrac des photos noir et blanc d’une Virginie adolescente s’essayant au tennis, deux aiguilles à tricoter plantées dans une pelote de laine rouge et, tout en dessous, un carnet de dessin à spirales auquel ne manquaient que quelques pages. Louise s’en était emparée avec l’avidité de l’assoiffé rencontrant une fontaine, avait sorti la boîte de pastels qu’elle gardait toujours dans son sac à main puis fait du bureau de Paul son nouvel atelier. Louis s’était contenté de libérer la grande planche-bureau posée sur deux tréteaux qui traversait la salle de jeux des jumeaux, avait précautionneusement posé au sol leurs cahiers de cours, feuilles volantes et globe terrestre lumineux pour les remplacer par son appareil photo et son ordinateur portable. Du premier passaient au second des milliers de photos prises dans les jours gris d’avant le jour noir, des vues de rues, avenues, lieux publics peu à peu vidés de leurs occupants, d’ultimes passants passant pressés comme des fantômes dans des lieux désertés et peu soucieux de l’objectif immortalisant leur fuite. Il s’arrêtait brièvement sur chaque photo, décidait de leur intérêt puis, d’un clic, classait dans différents dossiers chronologiques celles qu’il souhaitait conserver et envoyait vers la corbeille de l’ordinateur celles qui n’avaient aucun intérêt à ses yeux. Le soir, chacun montrait à l’autre son travail du jour, ce faisant une complicité naissait qui ne disait pas son nom, régulièrement et au prétexte de mieux voir le dessin ou la photographie, il passait derrière elle et frôlait son dos, Louise posait ses doigts sur le clavier de l’ordinateur alors que ceux de Louis s’y trouvaient déjà et un frisson les parcourrait. Ils vivaient ainsi, tranquilles et sereins, un peu honteux de leur presque bonheur alors que, derrière les rideaux de leur chez eux de circonstances, le malheur était partout.
Ω
Cette après-midi, Louis a fièrement décrété que cela faisait désormais un mois tout rond qu’ils étaient confinés dans l’appartement et il a dit à Louise, fais toi belle, ce soir je vais nous préparer un repas de fête. Louise a pris un long bain dans lequel elle a versé sels et lotions sagement rangés au dessus de la baignoire et s’est laissée couler dans l’eau brûlante et odorante avec l’ambition de ne penser à rien. Elle y a réussi pendant plusieurs minutes même si des pensées minimalistes germaient parfois dans son esprit embrumé mais elles les chassaient aussitôt, facilement, comme si elle crevait des bulles de savon à la surface de l’eau. Elle reprenait ensuite sa rêverie méditative, ne l’interrompant de temps à autres que pour rajouter de l’eau brûlante dans le bain devenu tiède. A un moment pourtant, une pensée s’est imposée à elle. Moins qu’une pensée, une image, claire, limpide, incontestable comme le sont toutes les vérités que l’on a depuis longtemps enfouies quand elles s’imposent en évidences.
Louis a cuisiné toute l’après-midi. Posé sur le plan de travail de la cuisine, son ordinateur s’est mué en livre de recettes dans lequel il a d’abord fallu effectuer une recherche par ingrédients en tenant compte de l’inventaire des placards et du frigo congélateur. Il a ensuite longuement débattu avec lui-même sur les préférences supposées de Louise, ses aversions quasi sûres pour le poisson ou le curry, sa peut-être réticence aux repas de fête, son si ça se trouve appétit de moineau. Il a finalement choisi du poulet, tout le monde aime le poulet, je vais lui faire du poulet thaïlandais, je suis sûr qu’elle aime ça la bouffe asiatique. Il a décongelé la viande dans le micro-ondes ultra moderne dont il a peiné à comprendre le fonctionnement, l’a découpée en fines lamelles comme le précisait la recette du site internet pour femmes modernes et l’a mise à mariner dans un mélange d’huile, de sauce soja et d’épices prises un peu au hasard sur les étagères. C’est à ce moment là que la honte est venue. Discrète mais insidieuse, entêtante, comme la rengaine dont on peine à se défaire, infondée et pourtant incontournable.
Louise est entrée dans le dressing de Virginie, son image idée fixe toujours devant les yeux. Louis a fouillé dans les placards de Paul sans se départir de sa petite honte bue.
Elle a opté pour une robe sage, motifs blancs sur fond noir, manches longues, liseré argenté au-dessus du genou et a déposé une goutte de parfum au creux de son cou.
Il s’est marré en enfilant un smoking superbe, en constatant qu’il manquait quelques centimètres au pantalon pour atteindre ses chevilles, en imaginant le rire de Louise quand elle le verrait ainsi attifé.
Elle a effectivement ri, beaucoup, d’un rire sonore juste un peu trop appuyé.
Il a ri avec elle, ri en tournant sur lui-même pour montrer les ourlets trop courts sur son grand corps d’épouvantail, ri en bouffant des yeux la robe sage et les formes qui s’y dessinaient.
Elle a fait un pas vers la table, un pas vers lui, elle a dit, ça sent bon en tout cas.
Il a fait un pas vers la table, un pas vers elle, il a répondu, j’espère ne pas t’empoisonner. Elle a levé vers lui ses grands yeux équivoques.
Il a posé sur elle un regard sans nuances.
Et il n’y a pas eu de repas, le poulet thaïlandaise a refroidi, seul, sur la table du salon pourtant joliment dressée.
Sur la même table, le Côte de Beaune déniché dans un placard a décanté dans sa superbe carafe de cristal sans que personne ne fasse attention à lui. Sur l’ordinateur de Paul, Otis Redding a chanté en boucle Sittin’ on the dock of the bay puisque la fonction « Répéter » avait été malencontreusement activée. Dans leurs cadres d’éternité Paul, Virginie, Ethan et Lisette ont détourné les yeux. Sur un roulis, un tangage, une houle de deux corps en écumes. Sur une robe tombée à l’entrée de la cuisine, un smoking roulé en boule au pied du canapé, des chaussures et chaussettes orphelines disséminées comme les cailloux du Petit Poucet jusqu’à la chambre. Sur des baisers, sur des caresses, sur des doigts, sur des mains, sur des bouches, sur des sexes, sur des unions, des désunions, des prises, des reprises, des méprises de trop d’empressement, sur des je t’aime et des je n’attendais que toi, sur des j’ai pensé à toi dans mon bain répondant à des j’ai eu honte de te désirer à ce point. A part ces quelques phrases peu de mots, pas de serments ni de promesses, pas de quand tout sera fini ou de si jamais je t’avais rencontrée avant. Juste des souffles, des regards, des accords tacites et silencieux, des volontés unies pour repousser le sommeil et éterniser la nuit. Se prendre, se reprendre, ne rien perdre des regards, des enchevêtrements, des postures comme si Louise les fixait à l’huile sur ses toiles ou Louis dans l’objectif de son appareil photo. La vie, seulement la vie, après et au milieu de tant de morts, toute la vie en une nuit.
Il y aura toujours un couple frémissant pour qui ce matin-là sera l’aube première. Il y aura toujours l’eau, le vent, la lumière ; rien ne passe après tout si ce n’est le passant. Un poème en guise de réveil, Aragon pour remplacer le room service qui jamais ne viendra toquer à la porte de la chambre, armé d’un plateau gargantuesque.
Un poème revenu ce matin à Louis des tréfonds de sa mémoire écolière, trois vers appris il y a un siècle, dans un autre monde et une autre vie, appris pour revenir aujourd’hui se poser sur cette aube là. Louis se dit, il est là le couple d’Aragon, j’en suis l’homme déjà éveillé, l’homme qui porte le même prénom que le poète, épuisé mais émerveillé de sa nuit et veillant sur elle et son sommeil profond, dans un lit qui n’appartient ni à l’un ni à l’autre. Elle est la femme du couple d’Aragon, mon Elsa à moi, ma Louise, ma compagne de cette nuit, seulement habillée de mes baisers et de nos sueurs jumelles. Il est là le matin du poète, pareil à tous les matins du monde pour ceux qui s’éveillent ailleurs que dans cette chambre, une aube soumise aux hommes, à leurs caprices, à leurs vanités, à leurs nuages sombres mais pas pour nous, pas ce matin, pas ici. Elle est là l’eau que nous n’avons pas bue, il est là le vent que nous n’entendons pas. La suite il ne veut pas la dire, il la sait pourtant depuis que ses yeux se sont ouverts tout à l’heure à grand peine et, qu’effrayé, il les a refermés brusquement, il la connait pourtant depuis que ses oreilles ont entendu et que pour les assourdir il a glissé sa tête sous l’oreiller protecteur. Retarder le moment, différer l’aveu que l’on se fait à soi même, se taire c’est arrêter le temps, ne pas dire c’est changer l’histoire, en modifier le cours, de la rivière détourner le lit. Ne pas s’avouer que c’est fini, que la lumière du poète est là aussi, derrière les rideaux encore tendus, sur ce boulevard qui ne désirait qu’elle et qui en hurle de joie. Si la lumière est là c’est que le nuage est parti, que la rue est sûre, que ceux qu’il entend chanter malgré l’oreiller sur sa tête hurlent de fête, de leur victoire inespérée.
Si la lumière est là c’est que bientôt ils seront là aussi, Paul, Virginie, les jumeaux, ils ne sont pas de ceux qui se rendent aux nuages fussent-ils noirs, aux épidémies fussent-elles mortelles, aux locataires provisoires fussent-ils armés d’amour et d’insouciance. Ils vont rentrer bientôt retrouver leurs vies de carte postale, leur appartement de magazine déco, rentrer pour reprendre leur vie et fabriquer des souvenirs qui rempliront ensuite leurs foutus cadres photos. D’ici là, il faudra être partis, retrouver les rives opposées de la Seine et une vie où Louise et Louis n’auront plus rien à se dire puisqu’il n’y avait qu’une fois, que c’était celle-là, que c’était cette nuit et qu’à cette aube tout s’achève.
Louise vient de bouger dans le lit. Elle s’y retourne, elle s’y détend, bientôt elle ouvrira les yeux et saura. Alors Louis tire sur eux le lourd édredon pour en faire une tente indifférente à la lumière et aux cris de la rue, un abri de fortune pour glaner quelques instants encore, elle ouvre les yeux, il l’embrasse et récite Il y aura toujours un couple frémissant pour qui ce matin-là sera l’aube première. Il y aura toujours l’eau, le vent, la lumière ; rien ne passe après tout si ce n’est le passant.
FIN
 Pour échapper au confinement, par Eric Jeux
Pour échapper au confinement, par Eric Jeux
Atteint par le Coronavirus la veille, ce début de confinement m’a paru bien naturel. Heureusement pour moi, les symptômes que je ressentais étaient légers : petite fièvre, grattements de gorge, maux de tête et courbatures. Ils étaient de l’ordre d’un gros rhume. Sans doute en temps normal, j’aurais poursuivi ma vie habituelle. Cette fois-ci, il s’agissait d’éviter tout contact afin de ne pas transmettre davantage la maladie à des gens plus fragiles ou moins chanceux que moi. Je restai donc cloitré en attendant que le mal passe, incapable d’une activité intellectuelle et créative, et livré à mes seuls démons intérieurs. Au bout de quatre jours, les symptômes de la maladie disparaissant, je retrouvai ma sérénité et mon imagination. Je pouvais donc à nouveau m’intéresser au sort de mes chersInfralents, les héros de ma saga de science-fiction.
Mes personnages vivent dans un monde virtuel où ils ont la capacité de façonner la réalité en fonction de leurs souhaits. Cela pose la question de l’imagination puisque pour pouvoir créer un objet, un lieu, voire un animal, il faut d’abord l’imaginer, c’est-à-dire en construire l’image et toutes les caractéristiques à l’intérieur de son cerveau. J’ai pu me rendre compte lors de mes nombreuses visites dans les collèges et les lycées, que ce travail d’imagination n’est pas du tout évident pour la plupart des gens et mêmes des ados. Il s’agit pourtant d’une capacité toute naturelle puisque le monde dans lequel nous vivons n’est pas seulement le monde extérieur tel qu’il nous est donné, mais surtout le monde tel que nous nous le représentons. A chaque instant, notre cerveau crée à partir de nos sens, une représentation complète du monde extérieur et c’est dans cette représentation personnelle que nous vivons.
Il est donc tout à fait possible et même naturel d’utiliser nos capacités cérébrales pour créer des représentations de réalités alternatives pour nous y échapper : « Je m’imagine dans une verte prairie vallonnée, l’herbe odorante effleure mes pieds nus, je marche au gré d’une pente douce par les méandres herbeux jusqu’à la mer qui se dévoile d’un coup. J’aspire à grand coup, l’air frais et iodé se mêle aux effluves tièdes de fleurs et de foins… »
Personnellement, je suis attiré par les grands espaces, tel se retrouvera plutôt dans un stade bondé, tel autre sur une piste de danse survoltée. Ce qui compte, c’est d’ouvrir les portes de ses mondes virtuels et de les sonder, les nourrir, afin d’aider notre esprit à combattre l’enfermement : le rétrécissement. Nous pouvons nous appuyer sur des paysages connus, sur des souvenirs ou des photos dès lors qu’ils sont le tremplin, le point d’appui pour le grand saut dans notre imaginaire. Nous ne sommes pas condamnés à l’angoisse et la déprime, contre lesquelles les petits écrans ne nous permettront pas seuls de lutter. Il nous faut aller puiser à d’autres sources, telles la lecture, pour retrouver les trésors oubliés de nos mondes intérieurs. N’hésitons pas à les explorer, à nous y promener. Ils nous aideront mieux que tout divertissement à respirer et à nous libérer le temps de ce confinement.
Eric Jeux
Le temps des Infralents chez PGDR
Tome 1 : L’envol de Lena, Tome 2 : Les chimères de Karl.
 Le cauchemar Corona
Le cauchemar Corona
Nous vivons un moment terrible, certains disent historique !
Je ne le croyais possible que dans les films catastrophes !
J’espère que je fais un mauvais rêve avant de m’éveiller dans un rayon de soleil !
Mais non ! Mon président, l’air grave et l’œil bleu sombre, m’affirme que le pire est à venir et que si je veux sauver ma peau et celle des autres, je dois me planquer, me terrer, me confiner, me blottir au fond de mes draps, faire le dos rond et espérer !
Moi, qui n’ai connu que la paix, les 30 glorieuses ; qui n’ai pensé qu’à mon bien être, celui des miens et de ceux que j’aime en toute bonne conscience ; on m’annonce que je suis en guerre ! Contre un ennemi, réductible certes, mais invisible, redoutable et vengeur. Situation ubuesque pour un enfant gâté du siècle !
Du fond de ma solitude et de mes angoisses entretenues par des médias, aussi moralisateurs qu’amplificateurs, me voilà plongé dans les réminiscences de mes plus jeunes années, au sortir de la terrible guerre où il n’était question que de bombardements, de morts de barbarie de haine, de pénuries et de danger permanent !
Il n’est rien de tout cela, grâce au ciel, mais le scénario est comparable ! C’est clair, Satan nous joue un mauvais tour ! En attendant, je me morfonds au fond de mon canapé, en proie à toutes les pensées et tribulations en tous genres initiées par ce drame que nous vivons. Dès lors qu’il est en grand danger, l’être humain vaniteux ingrat et repu de toutes ses certitudes à quatre sous, se souvient brusquement de l’existence du ciel.
Serait-ce un signe, un avertissement, un pré déluge ? L’homme a-t-il oublié ou travesti sa condition, ses origines, sa finitude ; comme pour s’enivrer ?
Sans revenir à l’âge de pierre, nous voilà privés de nos habitudes, de notre environnement, de notre douce insouciance et précipités dans un état primaire et anxiogène ? Serait-ce une plongée au sein de notre paradis perdu ?
Est-ce que ce terrible épisode, cette mise entre parenthèses, ce drame épouvantable qui frappe tant des nôtres nous replace dans notre statut d’êtres de la terre !
À genoux, à plat ventre, mordons la poussière et ouvrons les yeux sur la réalité, en espérant qu’il ne s’agisse que d’un avertissement !
Marc Lumbroso
18 03 2020
Opération Coronavirus, contribution de Domitille Marbeau Funck-Brentano
 Coronavirus, nous n’avons plus que ce mot à la bouche, les réseaux sociaux, les médias, les groupes de parole en sont infectés. Pas d’autres sujets de conversation depuis qu’une mobilisation générale a été décrétée il y a quatre jours par le gouvernement.
Coronavirus, nous n’avons plus que ce mot à la bouche, les réseaux sociaux, les médias, les groupes de parole en sont infectés. Pas d’autres sujets de conversation depuis qu’une mobilisation générale a été décrétée il y a quatre jours par le gouvernement.
Moi qui n’ai pas connu la guerre et qui culpabilisais d’avoir vécu depuis des années dans le confort et la sécurité, je suis servie !
Cette guerre est totalement nouvelle et fait émerger chez beaucoup des comportements anxiogènes.
Mais le danger est d’une tout autre nature : pas de bombes ou de fusils, c’est un ennemi invisible qui s’attaque à votre santé et pour lequel la seule réplique est de ne rien faire si ce n’est respecter une injonction générale qui porte le nom magique de CONFINEMENT.
Si l’on cherche ce mot dans le dictionnaire, on trouve la définition suivante : Fait d’être confiné, ou situation d’une population animale trop nombreuse dans un espace trop restreint et qui, de ce fait, manque d’oxygène, de nourriture et d’espace.
Les magasins sont dévalisés, les gens se battent pour un paquet de pâtes, les lignes téléphoniques sont saturées, des groupes de parole se forment sur la toile, La peur se transforme en panique, la dépression nous guète !
Puis la solitude est rompue par des petits clics indiquant qu’un des membres du groupe a posté vidéo, photo, ou quelques phrases pour créer un lien qui se fait subitement jour
Une guerre où le seul combat possible est de rester chez soi, est porteuse d’une stratégie déstabilisante. Restez chez vous martèle la télévision dès qu’on l’ouvre. Les gens se retrouvent enfermés avec eux-mêmes s’ils sont seuls ou avec conjoint et enfants s’ils sont en famille. Il faut apprendre à vivre avec ses proches, découvrir ceux que l’on côtoyait tous les jours quand ce n’est pas expérimenter l’enfer, c’est les autres.
Quand j’entends les plaintes incessantes de certains confinés qui tournent en rond dans leur logement, je ne peux m’empêcher de penser à Anne Franck qui est restée deux ans cachée dans un réduit avec sa famille avant d’être découverte et emmenée avec elle vers les camps de la mort.
Le plus difficile pour moi est de ne pouvoir adopter une attitude active, et reprenant ce que j’écrivais dans mon premier roman, L’Écho répété des vagues : « je suis née trop tard pour épouser mon cousin chéri, quand je s’rai grand tout le monde s’ra vieux et quand j’s’rai vieux tout le monde s’ra mort », et d’ajouter aujourd’hui : « je suis née trop tôt pour m’engager auprès du corps médical, être un vrai petit soldat et endosser l’étoffe des héros ! »
Toujours ce problème du moment, celui où l’on arrive sur la terre, pour un temps finalement très court qui s’accélère avec l’âge et nous fait comprendre que la vie est un miracle qu’on ne peut se permettre de gâcher car elle est unique.
Le confinement : un voyage avec soi-même, entouré de nos livres, disques, photos, temps volé au temps où toutes les contraintes sont abolies, où nous sommes autorisés enfin à jouir de tous les instants pour penser.
Le confinement : un voyage initiatique, mais comme tout voyage Il peut aussi prendre corps dans un voyage extérieur, un voyage à Bayreuth dont j’ai fait un roman La Défense d’aimer.
Aller à Bayreuth pour écouter le Ring, c’est prendre le risque d’être confiné pendant une semaine dans une bulle musicale où plus rien n’existe que la musique de Wagner, ses leitmotive, ses personnages, ses interrogations sur le monde, qui partent de la fascination de l’or au crépuscule des élites pour finir par se consumer dans les flammes qu’elles ont elles-mêmes entretenues.
Sommes-nous en ce moment dans cette bulle qui verra exploser le monde capitaliste ou au contraire fera émerger un monde qui ne doit sa survie qu’à la rédemption par l’amour rencontrée chez Wagner ?
La bulle dans laquelle nous sommes confinées est mondiale.
C’est une première dans l’histoire de l’humanité.
Saurons-nous écouter l’appel de la planète qui appelle au secours avec une tendresse infinie car son virus ne tue que 2 % de l’humanité ?
Saurons-nous déchiffrer la langue de l’oiseau qui n’a plus peur de l’homme enfermé dans sa bulle ?
Et si cette bulle, au lieu d’être une prison n’était pas qu’un énorme message d’espoir et de liberté dont nous allons peut-être commencer à percevoir le sens ?
J’ose l’espérer, je retournerai à Bayreuth et j’écouterai la musique avec d’autres oreilles qui donneront naissance à un autre livre.
Domitille Marbeau Funck-Brentano
Réécouter : https://radionotredame.net/emissions/enquetedesens/31-03-2020/
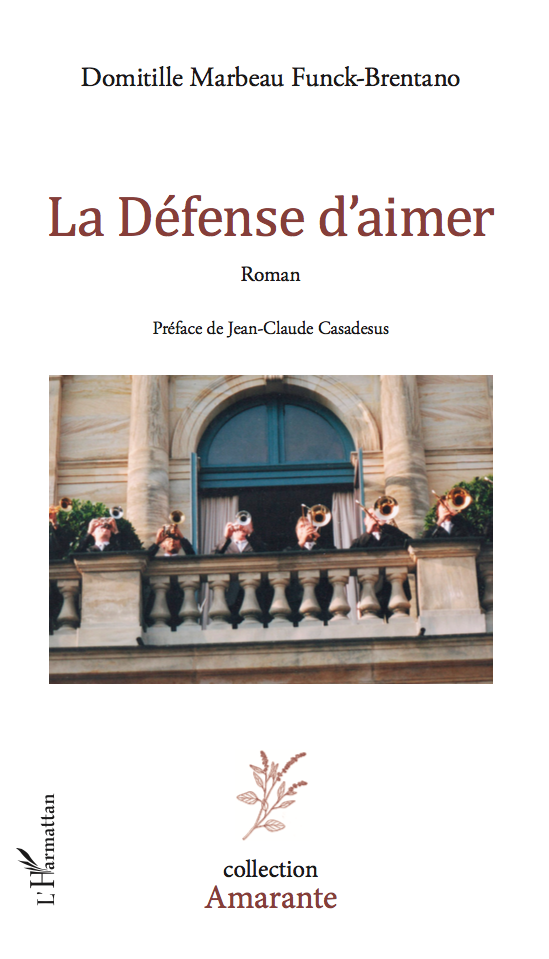 Domitille Marbeau Funck-Brentano : « La défense d’aimer » Collection Amarante. Elle est attachée de presse de presse de l’orchestre de France.
Domitille Marbeau Funck-Brentano : « La défense d’aimer » Collection Amarante. Elle est attachée de presse de presse de l’orchestre de France.
Claire Oppert : violoncelliste professionnelle et soigne par la musique. Elle raconte dans son livre « Le pansement Schubert », aux éditions Denoël, la naissance de cette invention et expérience musicale et thérapeutique qu’est le « pansement Schubert ».
Jean-Marie Gomas : gériatre médecin de la douleur et de soins palliatifs.
Abyale Nan Nguema : chanteuse de jazz à Paris et auteur de « L’art délicieux d’apprivoiser sa voix » (éditions Leduc).
Stéphane Floccari : agrégé de philosophie. Il enseigne au lycée Marcelin Berthelot, à Saint-Maur-des Fossés, et à l’Insep (Institut national du sport) à Vincennes.
Gautier Capuçon : Violoncelliste
 PANDEMIC 1
PANDEMIC 1C’est gentil d’applaudir sur les balcons chaque soir à la même heure. Cela leur fait une belle jambe, à ceux qui sont applaudis. Je ne dis pas celles et ceux car c’est piètre comme expression. Expression répétée à l’envi parce que c’est gentil. C’est gentil d’être gentil. Cela fait paraître beau. Cela fait paraître aimable, dans le sens « qui peut être aimé ». Pendant ce temps, la réflexion est mise au placard. C’est le règne de la belle âme. Et chacun se l’achète à bon compte, car tout s’achète et tout se vend. Ceux qui l’oublient, oublient de penser.
Le déni de la réalité tue autant que le virus mortel. Les gentils s’abreuvent au déni de la réalité. Ils s’en enivrent, s’en repaissent, s’en regorgent. Et chacun y va de son trémolo. Et chacun se met du côté des gentils et rabrouent les méchants. Le déni de la réalité est pourtant là, clair. Le virus n’est pas arrivé en Europe par l’opération du saint-esprit. Il s’est propagé dans le monde en étant transporté par des personnes contaminées qui, non-intentionnellement, l’ont emporté dans leur corps et l’ont introduit en Europe. Parce qu’il ne fallait pas faire de contrôle dans les aéroports. Cela fait tâche. Cela fait négligé. Cela peut déranger ces messieurs-dames qui font des affaires et voyagent. Il ne faut pas fermer momentanément les frontières. Ah ! non surtout pas ! Cela, c’est un crime de lèse-majesté. On se croit en démocratie ? C’est faux. On peut léser sa majesté. C’est donc un royaume. Le pire des royaumes. Il s’appelle « belle âme ». Son drapeau et son modus operandi c’est « déni de la réalité ».
Cela fait longtemps que les infirmiers, les infirmières, les médecins nous le disent. « Si l’état continue de sabrer les budgets, s’il ne remet pas de l’argent dans la santé, il y aura des morts dans les hôpitaux de France ». C’est arrivé. Les gentils le dénoncent, dans les journaux, dans les tribunes. Les belles âmes. Il faudrait qu’ils se demandent aussi, les gentils, pourquoi l’état ne met plus d’argent dans la santé. Pour la même raison que les états ont refusé de contrôler et de fermer momentanément les frontières, dès le départ, parce que ce n’est pas le saint-esprit qui a propagé le virus. Les belles âmes qui s’adonnent au déni de la réalité croient donc au saint-esprit et qu’on vit dans un royaume. Qu’elles continuent à applaudir. Les applaudissements c’est pour un spectacle, que je sache. Je ne savais pas que les gens qui soignent se produisaient sur une scène. Ah ! j’oubliais que tout est spectacle. Et qu’ils continuent donc à se donner en spectacle, sur leur balcon ; car c’est eux-mêmes qu’ils applaudissent dans le fond. Voyez comme on est gentils. Encore faut-il avoir la chance d’avoir un balcon, un domicile, pour le faire. Encore faut-il avoir la chance de ne pas revenir de son travail de caissier et de caissière dans les supermarchés et les commerces de bouche. D’ailleurs, eux, on ne les applaudit pas.
Qu’ils continuent à être gentils, repus d’idéologie. Allant jusqu’à traiter les Portugais de gens dociles. Quelle prétention ces Français ! Le Portugal s’en sort bien mieux parce qu’il n’a qu’une seule frontière. Il suffit de regarder une carte de géographie. Et il l’a fermée très tôt. Il a donné une carte de santé aussi aux migrants pour que tout le monde soit bien soigné et que le virus se propage le moins possible. Les gentils se vautrent dans le déni de la réalité. Les Portugais sont dociles, disent-ils. Et pourquoi pas cons, tant que vous y êtes ? Ils ne sont pas dociles, les Portugais. Leur état a été réaliste, c’est tout. Tandis que les gentils obéissent à leurs états meurtriers parce que les gentils dénient la réalité. Il préfèrent dans le fond qu’il y ait des morts, beaucoup de morts, que les médecins et les infirmières, les infirmiers pleurent parce qu’ils doivent choisir qui va être sauvé et qui va mourir. Ils préfèrent cela, les gentils, parce que leur miroir leur renvoie une image de belle âme. Mais un jour, un jour viendra où ce miroir, tel le tableau de Dorian Gray, leur montrera leur vrai visage, et là ils pleureront sur leur face hideuse. Mais ce sera trop tard, car la fin du monde sera arrivée.
Paris, le 31 mars 2020, 15ème jour de « confinement » parce qu’on a dénié la réalité.
ET SI LA RAISON REPRENAIT LE DESSUS…
 par le Dr Jacques Fiorentino 30 mars 2020
par le Dr Jacques Fiorentino 30 mars 2020
(attachée de presse guilaine_depis@yahoo.com 06 84 36 31 85)
Le monde entier ou quasiment est en voie de s’arrêter ou presque…
Plusieurs milliards de personnes sont confinées chez eux ou travaillent peu ou prou dans des conditions difficiles
La raison : une infection virale
Résumé ainsi on se prend à penser que le monde et particulièrement ceux qui nous gouvernent ont perdu la raison…
Mais l’énoncer ainsi c’est rajouter des braises à toutes les polémiques qui se démultiplient grâce à cette nouvelle langue d’Esope que sont les réseaux sociaux.
Alors reprenons point par point pour essayer d’y voir plus clair (si cela s’avère possible)
UNE INFECTION VIRALE
On prend conscience qu’une infection virale peut avoir des conséquences sanitaires et même provoquer des morts… Quelle découverte !!!
Rappelons que malgré l’existence d’un vaccin chaque année la grippe provoque nombre d’hospitalisations et de décès, décès qui pour l’heure dépassent encore ceux causés par ce nouveau virus…
On découvre qu’une infection virale ne connait ni frontière, ni ethnie… La belle affaire !
Qui pourrait croire le contraire… Sans doute les mêmes qui nous disaient que le nuage de Tchernobyl n’avait pas passé la frontière franco-allemande.
Oui nous sommes exposés à des risques infectieux mais pas seulement…
Rappelons que la canicule de 2003 a tué 17 000 Français en quelques semaines sans que le pays ne s’arrête de vivre, sans même que les vacances ne soient interrompues…
Alors que se passe-t-il ?
Contagiosité plus importante ?
En l’état actuel des données si la contagiosité est importante, elle reste encore inférieure à nombre de maladies virales plus connues et vécues plus simplement (à tort ou à raison) comme la rougeole
Gravité plus importante ?
Il est impossible de le savoir réellement car les mêmes qui réclament à corps et à cris des études « rigoureuses » pour des traitements ne sont pas à même de fournir des données comparatives référencées par rapport à d’autre pathologies virales équivalentes.
Donc où se trouvent les problèmes ???
UN DEPISTAGE NON ENCORE FONCTIONNEL
Sans être un virologiste éminent on sait depuis des décennies que pour s’assurer de l’existence d’une pathologie virale on doit la dépister car
A cet égard, donner des pourcentages de décès ou de formes graves sans connaitre le chiffre de la population réellement atteinte est une hérésie épidémiologique.
Pourquoi ce dépistage n’a-t-il pas été mis en place précocement comme cela a été le cas dans un pays équivalent comme l’Allemagne ?
Pourquoi tant de tergiversations devant ce qui apparait comme une évidence ?
Pourquoi la France, 5èmeou 6ème(selon des évaluations différentes) puissance économique s’est rendue incapable de mettre en place ce dépistage ?
Il faudra bien qu’un jour et le plus vite sera le mieux que l’on réponde à ces questions essentielles
DES INJONCTIONS CONTRADICTOIRES
D’un côté « Restez confinés » et de l’autre « Il faut que le pays continue à fonctionner » …
On vous parle de confinement, on met en place une politique coercitive avec amendes lourdes à la clé et un ministre vient, sans honte, déclarer que les Français doivent aller dans les champs aider les agriculteurs…
On vous demande de rester confiné et on met en place des élections municipales que l’on est bien incapable de finaliser. Rappelons qu’en même temps on culpabilise la population qui, le même jour, prenait un peu l’air dans des parcs ou des forêts…
Et si l’on y rajoutait avec une certaine cruauté le défilement de messages différents et erratiques toutes les semaines, voire tous les jours sur la conduite à tenir…
Et n’oublions les effets du confinement dont nombre d’études ont montré les conséquences médicales et psychologiques qui peuvent être dans certains cas dramatiques.
UNE GUERRE MEDIATIQUE AUTOUR D’UNE THERAPEUTIQUE
Si la situation n’était pas si grave, il y aurait de quoi rire devant cette querelle de cour d’école où s’écharpent des éminents experts… sauf que cela laisse désemparée toute une population, et même nombre de professionnels de santé.
Un médicament utilisé pour la prévention et le traitement du paludisme depuis nombre de décennies et dont on connait largement les risques et les effets secondaires semble – je dis bien semble car je n’ai pas la prétention de clore ce débat a fortiori sans l’ensemble des données – montrer une certaine efficacité.
Or que fait-on ? On continue à débattre sur le « sexe des anges » alors même que l’on n’a rien d’autre à proposer.
Si l’un de mes proches ou moi-même présentaient des signes évocateurs de cette virose, je n’hésiterais pas un seul instant à prescrire ce médicament après avoir pris les précautions d’usage propres à toute décision thérapeutique.
DES MASQUES CACHANT UN SCANDALE D’ETAT
Comment a-t-on pu ne pas se soucier de refaire des réserves de masques alors que l’on puisait larga manudans les réserves ?
Sous des prétextes fallacieux, sans que personne n’accepte d’assumer la responsabilité on a mis en péril une population de soignants qui paie le prix fort de cette incurie.
Comment un pays comme le nôtre a pu se rendre à ce point dépendant sur des secteurs vitaux, bien sûr les masques qui nous préoccupent actuellement, mais aussi les médicaments. Les ruptures de stocks de médications devenues une espèce de réalité acceptée auraient du constituer des alertes et réveiller certaines consciences face à des risques vitaux.
Et on pourrait continuer ainsi longtemps à énoncer ce qui fait que face à cette épidémie devenue pandémie, on a marché cul par-dessus tête…
LA SANTE ? L’OUBLIEE DU SYSTEME
Depuis près de 50 ans on ne parle de la Santé que pour évoquer les dépenses engendrées et les moyens de couper dans ce qui apparait accessoire alors même que plus de la moitié du PIB est consacrée aux dépenses publiques.
On a oublié que la Santé, au même titre que l’Education, la Justice, la Sécurité, est une valeur essentielle qui doit être assurée dans les conditions optimales.
On a oublié que la Santé est un investissement essentiel pour un pays et non pas seulement des dépenses. Ce qui se passe actuellement avec un pays en voie d’arrêt en donne une preuve dramatiquement éclatante.
Cette pensée sur la « Santé dépensière » a formaté plusieurs générations de dirigeants politiques et économiques et voici le résultat.
ALORS ?
Loin de moi la prétention de sortir d’un chapeau des solutions toutes faites ce d’autant que la gestion incohérente de ce problème a rendu trop tardives ou caduques certaines préconisations.
Mais simplement quelques idées simples